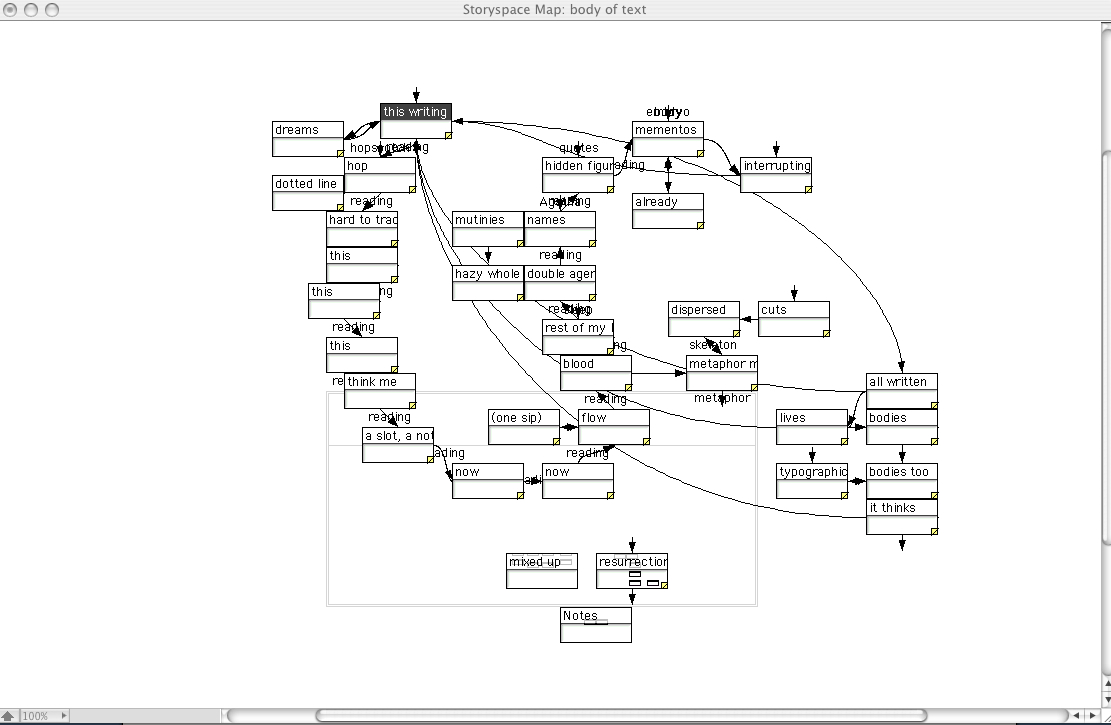Editorial
 Avant d’y venir, il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques définitions d’une notion qui n’a cessé de varier historiquement, comme le souligne le Dictionnaire des notions de l’Encyclopédie Universalis : « Outils, machines, instruments… définir ces trois classes d’objets techniques créés par l’homme pour son usage propre n’a vraiment de sens qu’à un moment donné de l’histoire. […] Les frontières de ces définitions sont perméables ; il est bien souvent difficile de classer tel ou tel objet. »[1].
Avant d’y venir, il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques définitions d’une notion qui n’a cessé de varier historiquement, comme le souligne le Dictionnaire des notions de l’Encyclopédie Universalis : « Outils, machines, instruments… définir ces trois classes d’objets techniques créés par l’homme pour son usage propre n’a vraiment de sens qu’à un moment donné de l’histoire. […] Les frontières de ces définitions sont perméables ; il est bien souvent difficile de classer tel ou tel objet. »[1].
Moins circonspecte, l’Encyclopédie Larousse définit la machine comme un « Appareil ou ensemble d’appareils capable d’effectuer un certain travail ou de remplir une certaine fonction, soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une manière autonome. Toute machine est transformatrice d’énergie. »[2]. Cette définition, qui inscrit la machine dans le paradigme thermodynamique, insiste sur l’idée de travail produit par transformation d’énergie. C’est ce que confirme le Petit Robert qui définit la machine comme un « objet fabriqué, généralement complexe (V. mécanisme), destiné à transformer l’énergie (V. moteur) et à utiliser cette transformation ». C’est ce qui, en principe, distingue la machine de l’appareil ou de l’outil « qui ne font qu’utiliser l’énergie ». D’où une définition de la machine comme « système où existe une correspondance spécifique entre une énergie ou une information d’entrée et celles de sortie ». À l’ère de l’informatique triomphante, ce qui est transformé, ce n’est plus de l’énergie en provenance d’une source naturelle mais de l’information, ainsi qu’en témoigne l’élargissement de la définition auquel procède le Dictionnaire Culturel des Sciences : « Une machine est un ensemble de mouvements, de transmissions et d’informations, ensemble animé et capable de produire un effet désiré ou appréciable ». Si cette définition insiste sur l’effet produit, il faut rappeler deux autres caractéristiques essentielles de la machine, apparues à la Renaissance : « l’automatisme et la régulation, ou contrôle par la machine elle-même de son propre mécanisme »[3].
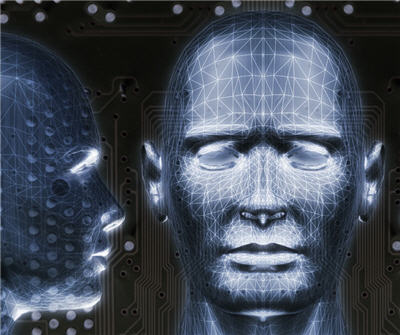 Lorsque la machine devient capable, non seulement de régulation, mais aussi de rétroaction, alors elle commence à s’apparenter au cerveau humain. La rétroaction est la fonction par laquelle une machine peut prendre en compte le résultat de son action passée pour y adapter ses actions futures. Elle suppose un principe d’apprentissage continu, basé sur les échanges d’information entre un système et son environnement, qui permettent à ce dernier d’ajuster son comportement en fonction de l’analyse qu’il fait des effets de son action. L’invention de machines possédant une autonomie suffisante pour analyser des informations en provenance du monde extérieur et pour prendre en permanence des décisions a montré que la rétroaction était non seulement l’apanage des êtres vivants mais, plus généralement, la source de tout comportement intelligent et organisé. Les machines aujourd’hui disposent de capacités cognitives et sociales de plus en plus comparables à celles de l’homme : elles sont capables de manifester le comportement adaptatif et la faculté d’acquisition des connaissances que le système nerveux prend en charge chez les être vivants[4]. L’idée, déjà ancienne, d’une équivalence entre l’homme et la machine a ainsi trouvé de nouveaux arguments. C’est en invoquant le principe de rétroaction que Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, la postule à son tour[5].
Lorsque la machine devient capable, non seulement de régulation, mais aussi de rétroaction, alors elle commence à s’apparenter au cerveau humain. La rétroaction est la fonction par laquelle une machine peut prendre en compte le résultat de son action passée pour y adapter ses actions futures. Elle suppose un principe d’apprentissage continu, basé sur les échanges d’information entre un système et son environnement, qui permettent à ce dernier d’ajuster son comportement en fonction de l’analyse qu’il fait des effets de son action. L’invention de machines possédant une autonomie suffisante pour analyser des informations en provenance du monde extérieur et pour prendre en permanence des décisions a montré que la rétroaction était non seulement l’apanage des êtres vivants mais, plus généralement, la source de tout comportement intelligent et organisé. Les machines aujourd’hui disposent de capacités cognitives et sociales de plus en plus comparables à celles de l’homme : elles sont capables de manifester le comportement adaptatif et la faculté d’acquisition des connaissances que le système nerveux prend en charge chez les être vivants[4]. L’idée, déjà ancienne, d’une équivalence entre l’homme et la machine a ainsi trouvé de nouveaux arguments. C’est en invoquant le principe de rétroaction que Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, la postule à son tour[5].
Or Wiener a consacré plusieurs textes à des ordinateurs, réels et imaginaires, jouant aux échecs. Dans l’étude qu’il publie ici, Pierre Cassou-Noguès confronte ses conceptions avec celles d’Edgar Poe dans « Le joueur d’échecs de Maelzel » et dans d’autres textes mettant en jeu des machines susceptibles d’imiter  l’humain. Il montre que la machine de Poe se situe à mi-chemin entre la machine cartésienne – simple automate conçu sur le modèle de l’horloge et destiné à imiter nos mouvements corporels – et la machine cybernétique, qui est un ordinateur ou une machine à calculer capable de rétroaction et donc susceptible d’imiter la pensée humaine. L’originalité de Poe réside dans l’idée d’un automate conçu comme machine à calculer et non comme simple horloge. Mais cette machine est aveugle : obéissant à un strict déterminisme, elle est incapable d’apprendre car elle est sans rétroaction.
l’humain. Il montre que la machine de Poe se situe à mi-chemin entre la machine cartésienne – simple automate conçu sur le modèle de l’horloge et destiné à imiter nos mouvements corporels – et la machine cybernétique, qui est un ordinateur ou une machine à calculer capable de rétroaction et donc susceptible d’imiter la pensée humaine. L’originalité de Poe réside dans l’idée d’un automate conçu comme machine à calculer et non comme simple horloge. Mais cette machine est aveugle : obéissant à un strict déterminisme, elle est incapable d’apprendre car elle est sans rétroaction.
Sydney Lévy s’intéresse à son tour aux récits de Poe, mais sous un angle légèrement différent, partant de la distinction établie par l’auteur américain entre calcul et analyse (pensée) pour distinguer l’humain de la machine. Profondément conscient de la nature algorithmique de tout calcul, Poe récuse l’idée que l’esprit serait susceptible de mécanisation : si les machines sont capables de calcul, la pensée reste le propre de l’homme. Et la pensée pour Poe, c’est la double faculté d’analyse et d’imagination : non pas un cheminement pas-à-pas relevant d’une procédure algorithmique, mais un phénomène émergent résultant d’interactions nombreuses. En déplaçant le point de vue de l’extérieur vers l’intérieur de la machine, les récits de Poe montrent qu’il ne faut pas confondre la pensée avec l’apparence de la pensée et pointent ainsi par avance les apories de la machine de Turing.
Cette dernière est au cœur de l’étude de Thomas Vercruysse sur Paul Valéry, dont il confronte le premier formalisme aux travaux fondateurs de Hilbert, qui ont imprégné toute l’époque et laissé leur trace dans le projet valéryien d’une mathématique de l’esprit. La question qu’il pose dans son étude est de savoir si les machines de Turing – qui dérivent du formalisme hilbertien – ne fourniraient pas un point de comparaison adéquat pour aborder la machine autopoïétique rêvée par Valéry. En effet, si l’on accepte l’idée qu’un « système formel n’est qu’une liste d’instructions pour une machine de Turing », alors le Système qui fournit son horizon au premier formalisme de Valéry pourrait être vu comme représentation fonctionnelle d’un cerveau conçu comme une machine de Turing. Valéry, toutefois, a rapidement pris ses distances avec le paradigme mathématique et renoncé à la formalisation pour s’intéresser à la thermodynamique qui lui offrait un autre modèle du cerveau : celui d’une machine énergétique fonctionnant par « cycles fermés ».
Avec Hervé-Pierre Lambert, on quitte le domaine des simples analogies entre l’homme et la machine pour aborder le devenir-machine de l’homme dans la fiction. Son étude porte sur Maurice Dantec, représentant de l’un des grands courants de l’imaginaire contemporain, le post-humain, qui explore les conséquences possibles pour l’espèce humaine de la convergence entre biotechnologies, intelligence artificielle et nanotechnologies. Cette convergence a créé les conditions d’une « néo-évolution », déterminée non plus par les lois naturelles mais par les sciences et les techniques qui pourraient concurrencer les mécanismes de l’évolution biologique et conduire à une artificialisation du vivant, à la dénaturalisation de l’homme. L’idée d’un homme-machine n’est pas neuve, elle a de nombreux antécédents littéraires comme en témoigne la large exploitation du thème dans la fiction[6]. L’imaginaire post-humain – ou méta-humain, comme préfère le dire Dantec – s’inscrit dans cette continuité, oscillant entre une tendance catastrophiste et une tendance prophétique qui se sont répandues dans le discours philosophique mais aussi dans la littérature et les arts plastiques. Dans l’œuvre de Dantec, cet imaginaire se construit à travers un « bricolage épistémique » qui, outre les références aux techno-mythes du cyberpunk, opère un croisement entre les thèses de Gilles Deleuze et celles de Jeremy Narby sur l’ADN et le chamanisme. Dantec emprunte à l’anthropologue la théorie des biophotons, l’un de ces savoirs hétérodoxes qui lui sont chers et selon lequel l’ADN émettrait une information génétique sur sa propre structure, savoir auquel les chamanes auraient accès par le biais de plantes hallucinogènes. Se réappropriant cette thèse, Dantec imagine dans Babyon Babies une « neuroconnexion » entre le cerveau et une intelligence artificielle appelée la neuromatrice, qui signale l’émergence du premier phénomène posthumain.
Si la machine est inextricablement liée à la définition de l’humain, c’est qu’elle imite ou supplée des facultés qui sont censées être le propre de l’homme : l’intelligence, la pensée, la mémoire. C’est à cette dernière faculté que s’intéresse Anne Bourse, dans la lecture originale qu’elle propose d’un texte de Jean-François Lyotard daté de 1986, « Si l’on peut penser sans corps ». Le philosophe y pose la question du témoignage et de la transmission en regard de la « fin », envisagée ici à travers l’image de la « mort solaire ». Organisé autour d’un échange polémique entre Technique et Philosophie – incarnés respectivement par les voix anonymes d’un Elle et d’un Lui – le texte affirme la nécessité de s’en remettre à un appareillage pour témoigner de la fin de l’homme, mais il souligne en même temps l’inaptitude des machines à se remémorer, à penser et donc à toucher au propre de l’homme. Car penser, nous rappelle Lyotard, est indissociable de souffrir, ce dont les machines sont incapables. C’est tout l’enjeu du témoignage que cristallise ainsi Lyotard, au terme d’un XXe siècle marqué à la fois par l’oubli génocidaire et par l’hypertrophie mémorielle suscitée par les machines à stocker l’information. Pour parvenir à penser ensemble la mémoire vive, sensible, incorporée de l’homme et la mémoire morte des machines, ce qu’il faudrait arriver à concevoir, nous dit Lyotard, c’est un corps « impropre », un corps proprement inhumain, soit finalement un corps-prothèse. Pour Anne Bourse, l’incarnation la plus propre de ce corps-prothèse pourrait bien être le corpus constitué par les œuvres littéraires, productrices de divers « dispositifs » mémoriels où la technique fait corps avec l’événement sensible pour témoigner du désastre.
C’est à un autre dispositif textuel que s’intéresse Magali Nachtergael dans son étude sur l’autofiction et cette « machine de vision » (Paul Virilio) qu’est la photographie. Dans les œuvres auto-narratives de Roland Barthes, Hervé Guibert et Sophie Calle, elle repère de nouvelles fonctions de l’image mécanique, d’ordre à la fois esthétique et identitaire, qui permettent d’exiber le corps mutant de l’auteur dans des textes eux-mêmes mutants, à la croisée du réalisme photograhique et de la fiction narrative. Témoignant d’un même attrait pour l’invisible et l’absence, pour le fragmentaire et la mise en scène fictionnelle de soi, les textes photographiques de Calle, Guibert et Barthes utilisent le décanteur de l’image pour élaborer des « mythologies personnelles » où la photographie, loin d’authentifier les propos de l’autobiographe, produit une identité en fragments, désindividualisée, voire déréalisée, qui mine à la fois l’illusion référentielle et le pacte de vérité autobiographique. Entrant dans « l’ère de la reproductibilité technique », l’identité de l’auteur se trouve ainsi soumise au même régime que l’œuvre d’art moderne : elle perd sa singularité au profit d’une « aura mythologique » où chacun peut se reconnaître.
La photographie, matrice originelle des médias actuels, s’insère aujourd’hui dans des dispositifs plus complexes, qui combinent texte et image sur des supports multimédias. L’étude d’Arnaud Régnaud (à venir) est consacrée à l’analyse de deux cyberfictions de Shelley Jackson, Patchwork Girl (1995) et My Body & A Wunderkammer (1997), qui articulent de manière originale les rapports corps/esprit/écriture. Dans la lignée de Donna Haraway et de son célèbre manifeste cyborg, Shelley Jackson revendique une forme de cybermatérialisme qui évacue toute composante métaphysique ou mystique de la définition de l’intelligence humaine et qui déstabilise par là-même la dichotomie corps/esprit. Elle envisage les cellules du corps humain comme une intelligence collective de type machinique, dépourvue de conscience de soi et travaillant à la régulation d’un système homéostatique qui détrône la prééminence cartésienne du cerveau. Les processus cognitifs ne sont plus cantonnés aux frontières de l’épiderme mais se prolongent jusque dans son environnement, ce qui brouille les frontières traditionnelles du sujet perçu comme une entité close et autonome. Dès lors, la capacité d’agir ne dépend plus d’un cerveau comparable à une tour de contrôle mais devient une fonction distribuée entre divers actants, dans un processus qui implique la coopération de l’humain avec le non humain. Ne pourrait-on y voir, comme le suggère Arnaud Régnaud, une mise en abyme de la lecture interfacée qu’impose toute littérature électronique ?
[1] Je remercie Danielle Follett pour ces définitions qu’elle a présentées lors du séminaire du Centre de Recherches sur la Littérature et la Cognition du 9 janvier 2010, dans une conférence intitulée : « La machine dans le jardin : la harpe éolienne et l’automatisme ».
[2] Cette définition est aussi celle que donne l’Encyclopédie Universalis : « En tant que réalité technique, la machine est une construction artificielle qui consiste en « un assemblage de parties déformables avec restauration périodique des mêmes rapports entre les parties » (G. Canguilhem, La Connaissance de la vie) ; elle a pour fonction de transformer de l’énergie provenant d’une source naturelle (eau, vent, vapeur, électricité, pétrole, atome, soleil) et d’utiliser cette transformation. In Encyclopédie Universalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/machine/. Consulté le 22 mars 2010.
[3] In Encyclopédie Universalis. Consulté le 22 mars sur : http://www.universalis.fr/encyclopedie/machine
[4] Sur le sujet, voir Philippe Breton, L’utopie de la communication, Paris, La découverte, 1992. Voir également l’ouvrage de Philippe Breton et Serge Proulx, L’explosion de la communication, Paris, La Découverte, 1996 [1989].
[5]<font face="Times
New Roman » style= »mso-element: footnote »> La cybernétique, dont les soubassements ont été édifiés par Norbert Wiener en 1947, est la science de la communication et des processus de contrôle et de régulation dans les machines hautement organisées et les organismes vivants. <font face="Times
New Roman » style= »mso-element: footnote »>
Poe, Descartes et la cybernétique
Il s’agira en particulier de situer l’image de la machine qui ressort des textes de Poe par rapport à deux autres : l’image de l’automate cartésien et l’image du robot cybernétique. J’ai tenté ailleurs de distinguer ces deux dernières [1]. Pour le dire très vite, la machine cartésienne est un automate, qui semble posséder en lui-même le principe de son mouvement, conçu sur le modèle de l’horloge et susceptible d’imiter nos mouvements, alors que notre robot est essentiellement un ordinateur, ou une machine à calculer, qui doit surtout imiter notre pensée. Je voudrais montrer que, dans « Le joueur d’échecs de Maelzel » en particulier, se dessine une image de la machine qui ne se confond ni avec l’automate cartésien, ni avec le robot cybernétique. Si la machine de Poe se distingue de la machine cartésienne en ce qu’elle est déjà en son organe le plus important une machine à calculer, elle est dépourvue d’une fonction essentielle à notre robot et sur laquelle Norbert Wiener a mis le doigt sous le nom de « rétroaction ». Je ne veux pas dire qu’il manquerait à la machine telle que l’envisage Poe une fonction que les savants auraient ensuite mise en évidence. Poe met en place une image de la machine qui a une consistance, une teneur propre et à laquelle, dans cette mesure, il ne manque rien. En pointant sur cette possible « rétroaction », la cybernétique et la science-fiction qui l’accompagne constituent une autre image de la machine qui n’ajoute rien à celle de Poe mais se place à côté d’elle. C’est dans la même perspective que je parle d’image plutôt que de concept ou, de façon plus vague, de conception. Un concept, au sens où on l’entend habituellement, entre dans une proposition, susceptible de vérité ou de fausseté. Or cette question de la vérité et de la fausseté ne m’intéresse pas. On peut dire en effet – j’y reviendrai – que Poe, dans « Le joueur d’échecs de Maelzel », commet des erreurs. Il n’empêche que Poe réussit à donner consistance à un objet de pensée, une certaine version de la machine, et cette consistance se révèle en ce que cette machine peut devenir un élément de fiction. Cette image de la machine me semble par exemple encore jouer dans le poème « Le corbeau » (1845). Je commencerai par discuter de l’analyse de Poe dans « Le joueur d’échecs de Maelzel », de 1836, en confrontant ce texte aux nouvelles « policières », en particulier « Double assassinat dans la rue Morgue » (1841) et « La lettre volée » (1844) [2]. Tout au long de cette première partie, je serai amené à revenir et à m’appuyer sur un article antérieur de S. Lévy dans Epistémocritique : « Poe : l’expérience de pensée, la pensée comme expérience » [3]. J’opposerai ensuite l’image de la machine que Poe met en place à celles que donnent Descartes et Wiener. Norbert Wiener est, on le sait, le père de la « cybernétique » – celui du moins qui a introduit le terme dans son usage actuel. Il publie, à partir de 1948, des textes, articles et livres – notamment Cybernétique (1948), L’usage humain des êtres humains (1950) et God and Golem Inc. (1965) – destinés à un public large et qui ont pour but d’analyser les capacités de ces machines alors nouvelles, les ordinateurs. Wiener consacre plusieurs textes à des ordinateurs, réels et imaginaires, jouant aux échecs. Je m’appuierai enfin sur les analyses qui précèdent pour relire le poème « Le corbeau » et comparer la répétition de son refrain, « Nevermore », à la parole animale, ou mécanique, telle que la définit Descartes. En guise de conclusion, je reviendrai sur la différence, dans les textes de Poe, entre la machine et l’humain, le calcul et l’analyse.
I. Les limites de la machine dans « Le joueur d’échecs de Maelzel »
Poe entend établir que « l’Automate joueur d’échecs », inventé en 1769 par le baron Kempelen et montré ensuite en Europe et aux Etats-Unis par Maelzel, suppose une intervention humaine et n’est pas entièrement mécanique. La machine, représentant un « Turc » assis devant une table sur laquelle est posé un échiquier, semble s’animer pour bouger les pièces. Elle joue des parties entières contre des adversaires choisis dans l’audience. La thèse de Poe, qui a été vérifiée par la suite, est qu’un homme se trouve en réalité caché derrière la table, sous le Turc, et commande les mouvements de celui-ci. Une machine, pour Poe, ne peut pas par elle-même jouer aux échecs. Poe donne une double justification à cette thèse : une preuve générale selon laquelle aucune machine ne peut jouer aux échecs et une analyse particulière du joueur d’échecs de Maelzel qui a pour but d’établir à nouveau, et de localiser dans le dispositif, la présence humaine :
« Il est tout à fait certain que les opérations de l’Automate sont réglées par l’esprit et non par autre chose. On peut même dire que cette confirmation est susceptible d’une démonstration mathématique, a priori. La seule chose en question est donc la manière dont se produit l’intervention humaine. » [4].
La suite du texte entend mettre en évidence, après une description détaillée de l’automate et de son exhibition par Maelzel, la manière de l’intervention humaine. Ce qui précède en revanche doit avoir établi la nécessité de cette intervention. Une question est de savoir dans quelle mesure cette première explication peut en effet prendre la forme, au sens propre, d’une démonstration mathématique.
I. 1. Une démonstration mathématique
Dans ses nouvelles policières, Poe distingue nettement des mathématiques la méthode utilisée par Dupin et qu’il appelle l’analyse :
« Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l’étude des mathématiques, et particulièrement de la très haute branche de cette science qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l’analyse, comme si elle était l’analyse par excellence. Car, en somme, tout calcul n’est pas en soi une analyse. » [5]. Dans l’article déjà évoqué, S. Lévy a bien mis en évidence l’importance de ce passage où Poe distingue l’analyse et le calcul. J’y reviendrai plusieurs fois. Poe, ici, distingue l’analyse, qu’utilise Dupin et qui détermine la façon dont celui-ci résout un problème, et l’étude des mathématiques lesquelles semblent être ramenées au « calcul ». L’analyse, en ce sens, passe par un moment qui n’a pas sa place en mathématiques : celui de l’identification. Les problèmes, ou les jeux comme le jeu de dames ou le whist, qui font appel à cette faculté d’analyse, supposent en effet une identification à l’adversaire : la capacité à prendre la place de l’adversaire pour deviner ses actions et agir en conséquence ou deviner ses faiblesses et l’induire en erreur :
« […] l’analyste entre dans l’esprit de son adversaire, s’identifie à lui, et souvent découvre d’un seul coup d’oeil l’unique moyen – un moyen quelquefois absurdement simple – de l’attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. » [6]
Autre aspect de la méthode et conséquence de cette identification à l’adversaire, l’analyste développe ce talent particulier pour l’observation qui manque toujours à la police parisienne. Parce que, comprenant de l’intérieur pour ainsi dire les gestes de son adversaire, l’analyste dirige son regard de façon appropriée. Il peut « savoir ce qu’il faut observer. » [7]
Or ces deux aspects de l’analyse, qui la distinguent du calcul mathématique, se retrouvent dans cette sorte d’enquête que mène Poe à propos de l’automate de Maelzel. Poe discute des réponses ou des gestes de Maelzel, en se mettant à sa place, pour deviner ses desseins ou son intérêt [8]. L’enquête passe aussi par des observations qui s’appliquent aux aspects les plus excentriques et incongrus du comportement de Maelzel ou des mouvements de son automate : « c’est évidemment de telles excentricités et incongruités que nous devons tirer (si toutefois la chose nous est possible) les déductions qui nous conduiront à la vérité. » [9] Comme le voudra par la suite Dupin : « C’est justement en suivant ces déviations du cours ordinaire de la nature [deviations from the plane of the ordinary] que la raison trouvera son chemin, si la chose est possible, et marchera vers la vérité. » [10]. Les réflexions de Poe semblent donc bien suivre la méthode d’analyse qui sera celle – dans des nouvelles postérieures – de Dupin. Le terme d’analyse est du reste utilisé par Poe [11]. La question reste cependant de savoir si les considérations de la première partie de l’essai, visant à montrer en général qu’un automate ne saurait jouer aux échecs, relèvent du raisonnement mathématique, tel que Dupin le décrit et l’oppose à l’analyse. Dupin donne en effet au raisonnement mathématique un domaine d’application particulier :
« Les mathématiques sont la science des formes et des quantités ; le raisonnement mathématique n’est autre que la simple logique appliquée à la forme et à la quantité. La grande erreur consiste à supposer que les vérités qu’on nomme purement algébriques sont des vérités abstraites ou générales. » [12]
Dupin donne ensuite une série d’exemples dans le domaine moral, la chimie, etc., où les axiomes mathématiques semblent être pris en défaut. Cette définition des mathématiques est au regard des mathématiques contemporaines de Poe, tout à fait discutable, ce que le narrateur fait justement remarquer à Dupin. Cela n’importe pas ici. La question est plutôt de savoir si les considérations initiales relatives à l’automate, dans « Le joueur d’échecs de Maelzel », peuvent relever du raisonnement mathématique en ce sens, c’est-à-dire de « la simple logique appliquée à la forme et à la quantité » ? Un raisonnement portant sur un tel automate – qui ne possède pas un moteur comme une machine à vapeur mais fonctionne comme une horloge que l’on remonte – fait-il intervenir autre chose que des notions de « forme » et de « quantité » ? Rien n’est moins sûr. Ce serait alors, comme c’est le cas dans les mathématiques contemporaines, ramener la théorie des automates dans le cadre d’une théorie mathématique. Ce serait aussi distinguer d’emblée l’automate, qui relève donc d’une théorie mathématique, et l’humain, ou l’esprit, qui exige l’analyse.
I. 2. La « thèse » de Poe et celle de Turing
Suivons maintenant la « démonstration » par laquelle Poe entend montrer a priori qu’un automate ne peut pas jouer aux échecs ou, plus exactement, conduire une partie contre un adversaire humain. Poe évoque la machine à calculer de Babbage et distingue ensuite les capacités requises pour le calcul, qui peuvent être mécanisées, et celles exigées par le jeu d’échecs qui ne le peuvent pas. Arrêtons-nous sur le premier point. Le passage qui est long mérite d’être cité en entier :
Les calculs arithmétiques ou algébriques sont, par leur nature même, fixes et déterminés. Certaines données étant acceptées, certains résultats s’ensuivent nécessairement et inévitablement. Ces résultats ne dépendent de rien et ne subissent d’influence de rien que des données primitivement acceptées. Et la question à résoudre marche, ou devrait marcher, vers la solution finale, par une série de points infaillibles qui ne sont passibles d’aucun changement et ne sont soumis à aucune modification. Ceci étant adopté, nous pouvons, sans difficulté, concevoir la possibilité de construire une pièce mécanique qui, prenant son point de départ dans les données de la question à résoudre, continuera ses mouvements régulièrement, progressivement, sans déviation aucune, vers la solution demandée, puisque ces mouvements quelques complexes qu’on les suppose, n’ont jamais pu être conçus que finis et déterminés. [13]
La « thèse » de Poe est que le calcul est susceptible d’être mécanisé. Pour tout calcul, on peut concevoir une machine qui pourra le réaliser. De là, on peut bien accepter que Babbage ait réussi, sinon à construire effectivement, du moins à concevoir, à dessiner une machine à calculer.
Il est évidemment tentant de rapprocher cette « thèse » de Poe de celle de Turing. Dans le célèbre article de 1937, Turing soutient que tout calcul, tout algorithme, toute procédure suivant des règles univoques est susceptible d’être réalisé par une machine d’une certaine sorte, ce que l’on appelle maintenant une machine de Turing [14]. Par exemple, pour « poser » une multiplication 1267*4578, on apprend, à l’école, des règles qui indiquent à chaque étape les opérations à accomplir – on écrit les deux nombres à multiplier l’un en dessous de l’autre, on multiplie d’abord le dernier chiffre du nombre du dessus par le dernier chiffre du nombre du dessous, etc. Bref, ce calcul suit des règles bien définies et une machine de Turing pourra calculer ce produit.
La proposition de Turing, qui identifie le calcul aux opérations d’une machine, n’est pas susceptible d’une démonstration à proprement parler mais constitue une thèse, une sorte d’axiome, que Turing justifie par des réflexions sur la notion de calcul et que l’on peut dire définir la notion de calcul : un calcul, c’est une procédure qui peut être implémentée sur une machine de Turing.
La « thèse » de Poe évoque d’abord celle de Turing. Il ne faut pas, cependant, se dépêcher d’y voir une anticipation de la thèse de Turing. La « thèse » de Poe – c’est pourquoi je place le terme entre guillemets – comporte une double indétermination. D’une part, il n’est pas facile de savoir ce que Poe entend par ces « calculs arithmétiques ou algébriques », qui peuvent selon lui se résoudre mécaniquement. Il donne certainement une large extension à la notion de calcul puisque dans le passage cité plus haut, Dupin peut résumer la distinction entre analyse et mathématique par cette formule : « tout calcul n’est pas en soi une analyse ». Le calcul semble représenter l’essentiel des mathématiques. Par son extension même, la notion de calcul garde alors un certain vague. C’est aussi le cas de la machine qui doit réaliser ces calculs. En particulier, il est essentiel, dans la thèse de Turing et pour la constitution d’une théorie mathématique des machine de Turing, que les machines de Turing soient des machines discrètes en cela qu’elles ne peuvent prendre qu’un nombre fini d’états internes. Par exemple, un ordinateur est essentiellement constitué d’une série d’interrupteurs. Chaque interrupteur peut être ou ouvert ou fermé. S’il y a n interrupteurs, ou ouverts ou fermés, la machine est selon la position des interrupteurs dans un état défini parmi 2n états possibles. Ou encore une horloge, constituée de roues crantées, est une machine susceptible d’un nombre fini d’états internes : les roues crantées ne peuvent être que dans un nombre fini de positions les unes par rapport aux autres. En revanche, si la machine comporte une roue tournant librement autour de son axe, celle-ci peut prendre tout un continu de positions différentes, et une telle machine sort de la théorie de Turing. La machine qu’envisageait de construire Babbage était bien, par avance, une machine de Turing, possédant un nombre fini d’états possibles. Mais rien n’indique, dans ce texte, que Poe ait connaissance de cette « finitude » de la machine de Babbage et qu’il reprenne lui-même ce caractère dans son raisonnement [15].
Prenons un exemple. Peut-on calculer mécaniquement des logarithmes, log 2, log 3, etc. ? On pourrait comprendre le texte de Poe comme indiquant que, puisque la fonction logarithmique est bien définie, une machine est possible dont le « mouvement » corresponde à la fonction logarithmique et se fasse de telle sorte que, partant sur une échelle graduée du chiffre n, l’index s’arrête à la fin du processus en un point représentant une approximation de log n. Le résultat, log n, est fixé sans ambiguïté par la donnée de n. Il en suit, pour reprendre les expressions de Poe, « inévitablement et nécessairement ». Donc – tirerait-on du texte de Poe – il peut être obtenu par une machine. Mais une telle machine pourrait être tout à fait différente d’une machine de Turing, ou de la machine que Babbage projetait. Elle pourrait fonctionner de façon analogique – plutôt que digitale – en s’appuyant sur un processus physique pour calculer ce logarithme. On serait alors très loin de la théorie de Turing.
Bref, la « thèse » de Poe me semble être trop indéterminée pour que l’on puisse y voir une anticipation de la thèse de Turing. Elle illustre néanmoins une idée que, avant Turing, on rencontre également avec une certaine indétermination dans des textes de logiciens comme Frege ou Gödel, l’idée selon laquelle un « calcul », de façon générale, est une procédure « mécanique ». Par ailleurs, si la « thèse » de Poe est que, en un sens très large de la notion, un calcul est susceptible d’être réalisé par une machine, la thèse de Turing en représente une spécification : certains calculs, en un sens plus étroit, sont en effet susceptibles d’être réalisés par certaines machines, définies par des caractéristiques précises. Ce n’est pas donc de ce côté, dans cette identification entre calcul et machine, que l’image de la machine que dessine Poe se distingue véritablement de la nôtre. Ce n’est pas par ce qu’elle peut faire que la machine de Poe se distingue de la nôtre mais par ce qu’elle ne peut pas faire.
I. 3. La machine et le jeu d’échecs
Considérons la seconde partie du raisonnement de Poe. Pourquoi une machine, que l’on peut imaginer calculer, ne saurait jouer aux échecs, c’est-à-dire, répétons-le, faire une partie contre un adversaire humain ? Poe donne deux raisons. Premièrement, « Aucun coup, dans le jeu des échecs, ne résulte nécessairement d’un autre coup quelconque. […] Supposons le premier coup d’une partie d’échecs mis en regard des données algébriques, le second pas de la question, qui en dépend absolument, en résulte inévitablement. Il est créé par la donnée. Il faut qu’il soit ce qu’il est et non pas un autre. Mais le premier coup dans une partie d’échecs n’est pas nécessairement suivi d’un second coup déterminé. » [16]. Poe oppose le calcul algébrique, dont chaque étape est entièrement définie, au jeu d’échecs dans lequel, à chaque étape, le jouer doit choisir son coup parmi une multiplicité de possibilités. Lorsque l’on « pose » la multiplication 1267*4578, lorsque développe le produit (a+b).(c-d), chaque étape du processus est déterminée par des règles bien définies. En revanche, dans une partie d’échecs, les coups précédents ne déterminent pas forcément les suivants. Le joueur doit choisir, ce qu’une machine, pour Poe, ne peut pas faire. Deuxièmement, « […] même en accordant (ce qui ne peut être accordé) que les mouvements de l’Automate joueur d’échecs soient en eux-mêmes déterminés, ils seraient nécessairement interrompus et dérangés par la volonté non déterminée de son antagoniste. » [17] Bref, il est impossible de parer à la première difficulté en admettant que l’automate ne choisit pas et que ses coups successifs sont entièrement déterminés dès lors que la machine est mise en branle. Car – semble affirmer Poe – une fois le premier coup joué par l’automate, l’adversaire joue à son tour, d’une façon que personne n’a pu anticiper et qui peut ne pas s’accorder avec le second coup que s’apprête à effectuer l’automate et qui est déjà fixé dans son mécanisme. Il est remarquable que Poe refuse, et ne considère pas même, que, à un moment donné de la partie, le coup de la machine puisse dépendre de la position des pièces sur l’échiquier. Poe est convaincu que les coups successifs de l’automate devraient être dès le début de la partie inscrits dans son mécanisme. Les coups de la machine devraient s’enchaîner les uns aux autres comme les notes égrenées par une boîte à musique. Les coups de l’adversaire n’importent aucunement et ne peuvent en rien modifier le cours du jeu de la machine. La machine ne voit pas son adversaire jouer, et c’est pourquoi, en réalité, elle ne peut pas jouer une partie contre un adversaire humain, et imprévisible. Pourquoi cet aveuglement dans la machine ? Dans les pages qui précèdent, Poe évoque un autre automate, un Magicien, qui peut répondre à un certain nombre de questions préparées à l’avance. Les questions sont inscrites sur de petits jetons, qui n’ont pas le même poids. Une question est posée à l’automate quand le jeton est inséré dans un tiroir. De la même façon que nos distributeurs de boissons reconnaissent par leur poids les pièces de monnaie, l’automate reconnaît la question posée au poids du jeton et fournit alors une réponse appropriée. Ne pourrait-on pas imaginer un dispositif analogue pour le jeu d’échecs ? La machine reconnaîtrait la disposition des pièces sur l’échiquier – parce que celles-ci produisent sur l’échiquier une répartition des masses particulière ou que le poids d’une pièce sur une case comprime un ressort et actionne un mécanisme particulier, peu importe – et jouerait son coup en fonction de cette disposition. Comme le magicien répond à la même question toujours de la même façon – ou donne une réponse tirée au hasard parmi un petit nombre de réponses possibles – le joueur d’échecs, confronté à une même disposition des pièces, produirait toujours le même coup, quel que soit le moment de la partie où cette disposition apparaît. L’automate serait peut-être un joueur mauvais mais il pourrait ainsi certainement jouer aux échecs. On pourrait opposer à cette solution que le nombre de combinaisons possibles, les différentes façons dont les pièces peuvent être disposées sur l’échiquier, est immense, et que personne ne réussirait à construire un mécanisme qui les distingue toutes et accomplisse une opération différente pour chacune. Cette objection serait sans doute juste mais elle n’entre pas dans l’argument de Poe. L’argument de Poe dépend tout entier de ce que la suite des coups jouée par un automate est d’emblée déterminée par son mécanisme. L’automate n’agit pas en fonction de la disposition des pièces et ignore entièrement le jeu de son adversaire. Cette image réapparaît du reste à plusieurs reprises, dans la deuxième partie du texte, au cours de l’analyse particulière consacrée à l’automate de Maelzel :
« Les coups joués par le Turc [l’automate] n’ont pas lieu à des intervalles de temps réguliers, mais se conforment aux intervalles des coups de l’adversaire – bien que cette condition (la régularité), si importante dans toute espèce de combinaison mécanique, eût pu facilement être remplie en limitant le temps accordé pour les coups de l’adversaire. » [18]
Poe y voit le signe d’une intervention humaine dans la machine, une présence humaine qui peut alors observer le jeu de son adversaire et s’y conformer. Mais pourquoi un intervalle de temps régulier devrait-il séparer les coups de l’automate ? C’est à nouveau que Poe considère qu’un automate jouerait pour ainsi dire tout seul, réalisant successivement les coups qui sont prescrits par son mécanisme et sans tenir compte des coups de son adversaire et du laps de temps qui s’écoule alors.
II. Poe, Descartes et Wiener
Il se trouve que la démonstration de Poe est erronée. Il faut bien reconnaître qu’elle l’est, puisque Poe entend établir a priori qu’une machine ne peut pas conduire une partie d’échecs, alors que nos ordinateurs jouent aux échecs. Cependant, cette erreur n’importe pas, et le raisonnement de Poe pourrait être aussi bien correct. Il s’agit d’en repérer – plutôt que les erreurs – les biais, de déterminer les images qui l’orientent. Et Poe en effet est prisonnier d’une image : une machine, un automate, une fois mis en branle, exécute un enchaînement qui est entièrement déterminé et ne peut plus être modifié par des données extérieures. Ainsi, la suite des coups d’un automate jouant aux échecs devrait être fixée au moment où la machine est lancée, au début de la partie, comme les étapes d’un calcul algébrique le sont par la donnée du problème. C’est par cette détermination que le calcul peut être implémenté sur une machine et à cause de l’indétermination du cours de la partie que le jeu d’échecs ne le peut pas. Il faut d’abord souligner que cette image de la machine est bien différente de celle qui anime les textes de Descartes et, avec lui, toute une part de la pensée classique. La machine, à laquelle Descartes compare l’homme et à partir de laquelle il veut penser le corps humain, est conçue sur le modèle de l’horloge ou, de façon plus anecdotique, de la fontaine. C’est un dispositif qui, une fois mis en branle, comme l’horloge est remontée ou comme on ouvre les robinets qui alimentent la fontaine, semble posséder en lui-même le principe de ses mouvements. Ainsi, par exemple, « le corps d’un homme vivant diffère autant de celui d’un homme mort que fait une montre, ou autre automate (c’est-à-dire autre machine qui se meut de soi-même), lorsqu’elle est montée et qu’elle a en soi le principe corporel des mouvements pour lesquels elle est instituée, avec tout ce qui est requis pour son action, et la même montre, ou autre machine, lorsqu’elle est rompue et que le principe de son mouvement cesse d’agir. » [19]. L’important, pour Descartes, est que la machine semble se mouvoir d’elle-même, comme le fait une horloge, et que ses mouvements puissent imiter ceux du corps humain. En revanche, lorsque Poe compare la machine à l’homme et discute de ce en quoi la machine peut imiter l’humain, ou évalue les capacités de la machine, ce qu’un mécanisme peut ou ne peut pas, le modèle qu’il invoque n’est plus celui de l’horloge : c’est la machine à calculer de Babbage. Et la question n’est plus celle de savoir si la machine peut reproduire nos gestes et nos fonctions corporels. Elle concerne presque uniquement les comportements humains qui semblent faire intervenir l’esprit : le calcul, le jeu d’échecs. Plus exactement, Poe évoque bien la façon dont l’automate imite les gestes humains mais cet aspect reste tout à fait anecdotique. Poe remarque en effet que « la physionomie extérieure, et particulièrement la gesticulation du Turc, ne sont, considérées comme imitations de la vie, que des imitations très banales. » L’automate ne reproduit qu’imparfaitement l’air réfléchi et les mouvements d’un véritable joueur d’échecs. L’interprétation de Poe est que Maelzel a choisi de donner à son automate des gestes « mécaniques » pour laisser croire précisément que l’automate ne renfermait qu’un mécanisme sans action humaine : « Si l’Automate avait imité exactement la vie dans ses mouvements le spectateur eût été plus porté à attribuer ses opérations à leur véritable cause, c’est-à-dire à l’action humaine cachée. » [20]. L’imitation des mouvements est maintenant secondaire à tel point que Maelzel peut à dessein laisser à son Automate un aspect mécanique. C’est que la question s’est déplacée et qu’il ne s’agit plus tant d’imiter les mouvements que la pensée de l’être humain. Bref, aussi bien le modèle que la problématique qui déterminent la machine en tant qu’elle imite l’humain se sont transformés. En prenant pour modèle la machine à calculer, Poe rompt avec la pensée classique qui, chez Hobbes, Descartes mais aussi Leibniz, garde de préférence celui de l’horloge. Pourtant, l’automate de Poe n’est pas encore le nôtre : le robot qui apparaît dans la cybernétique et la science-fiction qui lui est contemporaine. Il est – je l’ai annoncé – dépourvu de ce que Wiener appelle la rétroaction (feedback). La rétroaction est la fonction par laquelle une machine peut prendre en compte le résultat de son action passée pour y adapter ses actions futures : « La rétroaction est une façon de contrôler un système en réinsérant en lui les résultats de ses actions passées. » [21]. La façon dont le thermostat du four régule la chaleur émise est un exemple de rétroaction. Le thermostat mesure la température obtenue et, si celle-ci est égale, ou supérieure, à la température souhaitée par l’utilisateur, met hors circuit les résistances qui produisent de la chaleur. Ainsi, l’action de la machine – la production ou non de chaleur – dépend du résultat de ses actions passées – la température obtenue. On le voit sur cet exemple, ce n’est pas que Wiener invente un dispositif mécanique ou une fonction logique, qui permette de concevoir, ou de construire, des machines susceptibles de prendre en compte les résultats de leur action. Wiener donne seulement un nom pour, ou constitue en une notion déterminée, une fonction que bien des machines possédaient. L’exemple favori de Wiener est du reste le gouverneur centrifuge de la machine à vapeur, introduit par Watt à la fin du XVIIIe siècle. Et on rencontre dans les textes de Descartes, dans la description des fonctions corporelles – la description du sommeil par exemple [22] – des mécanismes qui relèvent exactement de la rétroaction au sens de Wiener. Cette notion de rétroaction conduit pourtant Wiener à mettre en avant une nouvelle image de la machine : une machine susceptible de s’adapter ou d’apprendre.
« L’organisme [et les machines à rétroaction qui se modèlent sur lui] n’est pas un mécanisme d’horlogerie comme la monade de Leibniz, dans son harmonie préétablie à l’univers, mais cherche toujours un nouvel équilibre avec l’univers et ses contingences futures. » [23] Or l’automate tel que l’imagine Poe, s’il n’est pas une horloge, reste néanmoins une monade dont les actions sont déterminées depuis le commencement. C’est cette image qui exclut que la machine puisse jouer aux échecs, ou à n’importe quel autre jeu, contre un adversaire humain. Inversement, l’idée de rétroaction permet de concevoir des automates qui peuvent non seulement tenir compte de la disposition des pièces pour leurs actions suivantes – et conduire alors en effet une partie contre un adversaire humain – mais même modifier leur stratégie. Wiener distingue plusieurs types de rétroaction. Par une rétroaction simple, de premier type, la machine observe la disposition des pièces sur l’échiquier, telle qu’elle résulte de ses coups et de ceux de son adversaire, pour jouer en conséquence. Dans une rétroaction de type supérieur, la machine retiendra les coups joués dans les parties qu’elle a gagnées, ou perdues, pour les reproduire si l’occasion se présente. La machine garde en mémoire toutes les parties qu’elle a jouées, et elle est programmée de façon à ce que, si la même disposition des pièces est déjà apparue dans une partie antérieure – ou la disposition inverse en interchangeant les blancs et les noirs –, elle jouera le même coup si celui-ci l’avait conduit – ou avait conduit son adversaire dans la configuration inverse – à la victoire, et un coup différent si ce n’est pas le cas. Ainsi, la machine améliore peu à peu ses stratégies. Elle est pour ainsi entraînée par les joueurs avec lesquels elle joue. Et, au bout du compte, elle aura une façon de jouer et une personnalité différentes selon les joueurs ou les écoles par lesquels elle a été entraînée [24].
Wiener discute, dans plusieurs textes, de programmes permettant aux ordinateurs qui commencent à apparaître de jouer aux échecs. Il mentionne en passant l’analyse de Poe dans « Le joueur d’échecs de Maelzel » sans voir dans la solution que Poe propose « aucune originalité » [25] À mes yeux, Wiener manque précisément l’originalité de Poe, qui est d’imaginer l’automate comme une machine à calculer – et non une horloge – mais – à la différence même de Descartes – une machine sans rétroaction. Cependant, Wiener reprend l’idée de Poe que le jeu d’échecs suppose une analyse de la personnalité de l’adversaire. Or la machine, s’entraînant et répétant leurs coups, semble commencer par adopter certains aspects de la personnalité de ses adversaires pour gagner finalement sa propre personnalité et une « inquiétante astuce » [26] : « Il ne sera pas du tout facile pour le joueur humain d’être certain qu’il joue contre une machine et non une personne. » [27].
« Supposons que la machine garde en mémoire les parties précédentes que vous avez jouées, et mesure en fonction de vos résultats antérieurs quelle sorte de stratégie sera le plus vraisemblablement couronnée de succès. Vous commencerez bientôt à sentir que la machine a développé une sorte de personnalité. » [28] Dans ce dernier passage, Wiener esquisse une expérience de pensée curieuse où, la machine étant entraînée par un unique adversaire, « vous », dont elle apprend peu à peu aussi bien à reproduire qu’à contrer les coups, « vous » lui reconnaissez peu à peu une « sorte de personnalité ». Quelle personnalité ? Il est difficile de ne pas penser que cette personnalité que « vous » reconnaissez à votre adversaire, sans savoir forcément que « vous » affrontez une machine, n’est qu’une image en miroir, un double mécanique de « vous »-même. On retrouverait dans d’autres textes de Wiener cette figure d’un double mécanique : la figure, forcément inquiétante, d’une machine créée par l’homme à son image et entrant en concurrence avec celui-ci [29]. Mon but n’est pas de rectifier en référence aux analyses de Wiener les considérations erronées de Poe ou de mettre en évidence leur partialité. Mon but est de distinguer différentes images de la machine. Wiener, comme Poe, met en place une image qui le conduit à des expériences de pensée, hors de l’ordinaire, des sortes de fictions esquissées en quelques lignes – cela, à l’intérieur même de ses essais et sans parler de ses nouvelles de science-fiction et de son roman. Mais l’image de Wiener n’est pas celle de Poe. Le texte de Poe fait intervenir une image de la machine qui ne se réduit ni à celle de la pensée classique et de Descartes en particulier, ni à celle de la cybernétique. La machine de Poe est une machine à calculer dont le mécanisme est entièrement rigide, déterminant des actions successives comme les règles d’un calcul déterminent les opérations à accomplir. C’est cette idée de détermination qui pousse Poe, du même mouvement, à accepter la mécanisation du calcul et à refuser celle du jeu d’échecs. Ces images dépendent d’avancées techniques mais elles ne les reflètent pas de façon adéquate ou ne s’ordonnent pas sur une ligne parallèle à celle d’un progrès technique. Sans doute, Poe peut se référer à l’exemple de Babbage, dont ne disposait pas Descartes, pour adopter un autre modèle de la machine. Wiener peut s’inspirer des ordinateurs et des programmes qui, dans les années cinquante, jouent en effet déjà – mal sans doute – aux échecs ou aux dames. Cependant, la rétroaction, que Poe exclut de sa machine, ne correspond pas à un progrès technique sur lequel Wiener, à la différence de Poe, pourrait s’appuyer. Comme je l’ai mentionné, Descartes pouvait déjà rendre compte des fonctions corporelles en imaginant par avance des mécanismes à rétroaction. L’image ne reflète pas l’état de la technique, bien que celui-ci en soit sans doute un ingrédient.
III. Retour sur Poe : l’homme et la machine
Je voudrais conclure par deux remarques concernant les rapports entre l’homme et la machine. Cette image de la machine, enchaînant ses opérations de façon aveugle, selon un déterministe strict, me semble en effet intervenir en différents points dans les textes de Poe. On la retrouve par exemple dans le poème « Le corbeau », tel que Poe l’analyse dans l’essai « La genèse d’un poème ».
Poe en effet explique avoir d’abord décidé de bâtir le poème à partir de la répétition d’un refrain, « Nevermore », « Jamais plus ». La difficulté alors était d’imaginer une créature et une situation susceptibles de donner lieu et sens à la répétition de ce même mot : « Observant la difficulté que j’éprouvais à trouver une raison plausible et suffisante pour cette répétition continue, je ne manquais pas d’apercevoir que cette difficulté surgissait uniquement de l’idée préconçue que ce mot, si opiniâtrement et monotonement répété, devait être proféré par un être humain ; qu’en somme la difficulté consistait à concilier cette monotonie avec l’exercice de la raison dans la créature chargée de répéter le mot. Alors se dressa tout de suite l’idée d’une créature non raisonnable et cependant douée de parole, et très naturellement un perroquet se présenta d’abord ; mais il fut immédiatement dépossédé par un corbeau, celui-ci étant également doué de parole et infiniment plus en accord avec le ton voulu. » [30]. Le perroquet est, dans les textes de Descartes, l’exemple récurrent d’une machine posant problème : compte tenu de la thèse de Descartes que les animaux sont des machines, le perroquet ne doit recouvrir qu’un dispositif mécanique et, pourtant, il a, dans une certaine mesure, l’usage de la parole et, en cela, peut être comparé à l’être humain. Le perroquet, ou le corbeau, de Poe n’est sans doute pas lui-même une machine. Néanmoins, il se conforme à l’image de la machine qui ressort du « Joueur d’échecs de Maelzel » en ce que ses opérations ou, plus exactement, cette unique opération que constitue l’énonciation du « Jamais plus » doivent être supposées s’enchaîner en vertu d’un principe interne, rigide, et indépendamment des circonstances extérieures, de la même façon qu’un automate enchaînerait ses coups dans l’abstraction de la disposition des pièces sur l’échiquier. Cet aveuglement du volatile est essentiel dans le poème. Le corbeau ne « réfléchit » pas, ne « choisit » pas une réponse appropriée aux questions que lui pose l’étudiant. Il répète en réponse au son de la voix son monotone refrain. Et c’est l’étudiant qui choisit les questions pour lesquelles le cri de l’oiseau prendra le plus de sens :
« […] il est poussé bientôt, par l’ardeur du coeur humain à se torturer soi-même et aussi par une sorte de superstition, à proposer à l’oiseau des questions choisies, de telle sorte que la réponse attendue, l’intolérable jamais plus, doit lui apporter, à lui, l’amant solitaire, la plus affreuse moisson de douleurs. » [31].
Il est instructif de rapprocher des analyses de Descartes la mécanique de la parole animale impliquée dans le poème de Poe. Dans la cinquième partie du Discours de la méthode, Descartes, en effet, distingue de la parole humaine celle dont l’animal est capable, l’animal qui est une machine :
« […] on peut bien concevoir qu’une machine soit tellement faite qu’elle profère des paroles, et même qu’elle en profère quelques unes à propos des actions corporelles qui causeront quelque changement en ses organes ; comme si on la touche en quelque endroit, qu’elle demande ce qu’on veut lui dire, si en un autre, qu’elle crie qu’on lui fait mal, et choses semblables, mais non pas qu’elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés peuvent le faire. » [32]. Ainsi, la différence entre la parole animale, ou la parole mécanique, et la parole humaine tient à l’universalité de cette dernière. L’homme pourra parler et faire sens dans toute circonstance alors que les paroles de l’animal répondent à des circonstances déterminées et des circonstances qui restent en nombre fini. L’animal donc se répète alors que l’homme s’adapte à la situation. Le perroquet ne dispose que d’un vocabulaire fini dont chaque terme s’attache à une circonstance particulière. On pourra par exemple apprendre à « une pie à dire bonjour à sa maîtresse lorsqu’elle la voit arriver » [33] ou qu’elle entend celle-ci lui crier « Bonjour ! ». Cette pie cartésienne qui ferait écho d’un « Bonjour ! » à celui de sa maîtresse ressemblerait, à première vue, au corbeau de Poe, qui répond « Jamais plus » lorsqu’il entend la voix humaine. Il reste pourtant entre eux une différence cruciale. C’est que la machine, ou l’animal cartésien peut distinguer des situations différentes et y répondre différemment, des situations en nombre fini sans doute, alors que l’animal, ou la machine de Poe n’a pas même cette capacité de distinguer des situations différentes.
« Au lieu que la raison est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes [de la machine] ont besoin de quelque disposition particulière pour chaque action particulière ; d’où vient qu’il est moralement impossible qu’il y en ait assez de divers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrences de la vie, de la même façon que notre raison nous faire agir. » [34] La machine cartésienne est bornée : elle répond à un nombre fini de situations différentes, quand la raison humaine est universelle et répond à toute situation. Cela dit, la pie cartésienne peut répondre à différentes questions de sa maîtresse alors que le corbeau de Poe répond « Jamais plus », quelle que soit la question qui lui est posée. Un automate cartésien pourrait tenter quelques coups aux échecs, quelques coups qui seraient adaptés à la disposition des pièces, alors que celui de Poe est perdu dès le premier coup qu’a joué son adversaire et que son mécanisme n’a pas pu prévoir. L’écart entre Poe et Descartes est en réalité immense. Si la machine de Descartes peut répondre à un nombre fini de circonstances différentes, quand la raison humaine peut s’adapter à toute circonstance, c’est seulement à l’infini que l’on pourra être sûr de mettre en évidence les limites de la machine. Les situations prévues dans le mécanisme de l’automate et dans lesquelles celui-ci peut agir avec sens sont en nombre fini mais ce nombre peut être arbitrairement grand. Il n’y a donc pas de test empirique absolument certain qui permette de distinguer l’homme et la machine, et c’est seulement d’une certitude « morale » que l’on sait que les circonstances de la vie sont trop nombreuses pour qu’une machine puisse être conçue qui y réponde. Ce n’est que vraisemblable. Le corbeau, dans le poème de Poe, qui répète ce « Jamais plus », se conforme à l’image de la machine que dessine « Le joueur d’échecs de Maelzel » : un dispositif aveugle qui enchaîne ses opérations sans pouvoir distinguer aucunement les situations dans lesquelles elles s’inscrivent. Cette particularité de l’image de la machine que met en place Poe – au regard même de l’image cartésienne – m’amène à une seconde remarque concernant, dans les textes de Poe, la différence entre l’homme et la machine.
On l’a vu, Dupin distingue le « calcul » et « l’analyse » : « […] en somme, tout calcul n’est pas en soi une analyse. » (« Yet to calculate is not in itself to analyse. »). Or une machine, pour Poe, est susceptible de calculer mais non d’analyser, et c’est pourquoi une machine ne peut pas jouer aux échecs. Le jeu d’échecs est donné par Dupin comme celui qui, au regard du jeu de dames ou du whist, fait la plus grande part au calcul. Néanmoins, les coups de l’adversaire y restent imprévisibles. Il ne suffit donc pas de calculer. Il faut s’adapter au jeu de l’adversaire et l’analyser.
Cependant, cette différence entre l’analyse et le calcul, cette différence entre l’humain qui analyse et la machine qui calcule, suit de l’image de la machine que dessine Poe et qui lui reste particulière. Si la différence entre l’humain et la machine est que celle-ci ne peut pas conduire l’analyse qui sous-tend le jeu, le jeu d’échecs, le jeu de dames, le jeu du whist, alors cette différence s’annule puisqu’il existe, de fait, sur nos ordinateurs des programmes contre lesquels l’on peut jouer à chacun de ces jeux. Mieux, tels que les envisage Wiener, ces automates qui jouent semblent bien suivre une méthode très proche de l’analyse telle que la définit Dupin. La machine, on l’a vu, enregistre les parties jouées contre son adversaire, elle est ensuite susceptible de repérer ses coups favoris et de les réutiliser elle-même ou d’apprendre à y parer. Elle n’est pas loin de « s’identifier » à son adversaire au sens où l’entend Dupin, puisque, à la longue, elle en vient à deviner ses stratégies et jouer précisément pour les contrer. Faut-il dire que la machine cybernétique est capable d’analyse ?
Du moins, il ne faut pas, à mes yeux, donner un sens trop large à cette distinction dans le texte de Poe entre le calcul et l’analyse. On ne peut pas faire de celle-ci la base d’une différence générale entre la pensée humaine et le calcul mécanique. Sans doute – bien qu’avec certaines indéterminations – Poe identifie, comme la logique contemporaine, le « calcul » au « mécanique ». Mais la mise en évidence des limites de ce calcul mécanique et, par suite, la mise en évidence de « l’analyse » comme une faculté proprement humaine dépend d’une image de la machine qui n’est plus la nôtre ou, disons, reste tout à fait particulière : la machine comme un dispositif de calcul, aveugle. C’est cette image de la machine dans les textes de Poe que j’ai voulu cerner en l’opposant à celle de Descartes et à celle de Wiener.
Pierre Cassou-Noguès : « Poe, Descartes et la cybernétique »
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE – (Hiver 2010)
[1] Notamment dans Une histoire de machines, de vampires et de fous, Paris, Vrin, 2007, « Complément 1 ».
[2] in Edgar Allan Poe, Contes, essais, poèmes, tr. fr. Ch. Baudelaire, C. Richard éd., Paris, Laffont, 1989.
[3] Epistémocritique, vol. II, 2008
[4] « Le joueur d’échecs de Maelzel », in Contes, essais, poèmes, op. cit., p.1038
[5] « Double assassinat dans le rue Morgue », tr. fr. C. Baudelaire, in Contes, essais, poèmes, op. cit., p. 517. En anglais : « Yet to calculate is not in itself to analyse » (in Poetry and Tales, New York, Library of America, 1984, p. 397)
[6] Ibid., p. 518. Cf. également l’exemple du jeu « pair ou impair » dans « La lettre volée », in Contes, essais, poèmes, op. cit., p. 827.
[7] « Double assassinat dans le rue Morgue », Ibid., p.518.
[8] Notamment paragraphes VI et VIII, « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1049-1051.
[9] Ibid., p.1055.
[10] « Double assassinat dans le rue Morgue », op. cit., p. 531 ; Poetry and Tales, op. cit., p. 414
[11] « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1046
[12] « La lettre volée », op. cit., p. 829.
[13] « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1037-1038.
[14] « On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem » (1937), repris dans M. Davis, The Undecidable, Hewlett (N.Y.), Raven Press, 1965.
[15] Poe note bien que les mouvements de sa machine à calculer « n’ont jamais pu être conçus que finis et déterminés ». Mais il est difficile de donner un sens précis à ce caractère « fini », qui n’apparaît qu’une seule fois dans le paragraphe.
[16] « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1038.
[17] Ibid.
[18] Ibid., p. 1047. Cf. aussi §III, p.1048, où Poe soutient qu’une machine qui saurait jouer aux échecs devrait toujours gagner ses parties.
[19] Descartes, Passions de l’âme, in Œuvres, Adam et Tannery (éds.), Paris, Vrin, 1996, t..XI, p.331. Sur la fontaine, Traité de l’homme, in Œuvres, op. cit., t. IX, p.130.
[20] « Le joueur d’échecs de Maelzel », op. cit., p.1050.
[21] Wiener, The Human Use of Human Beings (1951), New York, Avon, 1967, p.84.
[22] L’analyse du sommeil et de la veille dans le Traité de l’homme est centrée sur une rétroaction négative : Descartes décrit un mécanisme par lequel les effets du sommeil sur le corps produisent le réveil, et les effets de la veille l’endormissement (Traité de l’homme, in Œuvres, op. cit., t. XI, p.198, à comparer avec Wiener, Cybernetics, Paris, Hermann, 1948, p.115).
[23] The Human Use of Human Beings, op. cit., p. 67.
[24] « Vous pourriez actuellement avoir un jeu entre deux écoles d’échecs dans lequel les deux écoles seraient représentées par des machines qui auraient été éduquées dans la tradition de deux écoles », « L’homme et la machine », in Collected Works, Cambridge (Mass.), MIT Press, t. IV, 1985, p.835
[25] « While his analysis, distinguished by the originality of his dramatic style, makes tense, absorbing reading, no originality characterizes the solution which he offers. » (« Chess-Playing Automata, The Turk, Mephisto and Ajeeb », conférence inédite, archives Wiener, MIT, Boîte 28C, dossier 605). Wiener se réfère également à Poe dans The Human Use of Human Beings, op. cit., p. 239.
[26] « uncanny canninness », God and Golem, Inc, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1965, p.21.
[27] « The Brain and the Machine » in Collected Works, t. IV, p.686.
[28] « Man and the Machine », in Collected Works, op. cit., t. IV, p.714.
[29] P. Cassou-Noguès, « Norbert Wiener dans la presse américaine : une figure du bon savant fou », in H. Machinal (ed.), La figure du savant fou, Rennes, Presse universitaire de Rennes, à paraître.
[30] « La genèse d’un poème », in Contes, essais, poèmes, op. cit., p.1012.
[31] « La genèse d’un poème », op. cit., p.1016. Je souligne.
[32] Descartes, Discours de la méthode, in Œuvres, op. cit., t. VI, p.56
[33] Descartes au Marquis de Newcastle, 23 novembre 1646, in Œuvres, op. cit., t. IV, p. 574
[34] Discours de la méthode, in Œuvres, op. cit., .t. VI, p. 56
Why an Ourang-Outang? Thinking and Computing with Poe
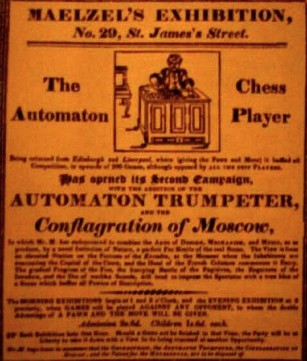 The chess player is an automaton invented by Baron Van Kemplen in the late 18th century. It was subsequently purchased by a certain Maelzel –the inventor of the metronome– who exhibited the machine’s prowess by having it play opponents from the audience at theaters and sideshows on both sides of the Atlantic. In the article, Poe demonstrates, as others by the way did before him, that hidden in the machine was human being who is actually doing the chess playing.
The chess player is an automaton invented by Baron Van Kemplen in the late 18th century. It was subsequently purchased by a certain Maelzel –the inventor of the metronome– who exhibited the machine’s prowess by having it play opponents from the audience at theaters and sideshows on both sides of the Atlantic. In the article, Poe demonstrates, as others by the way did before him, that hidden in the machine was human being who is actually doing the chess playing.

the stage rolling the automaton in front of him while opening and closing compartments and drawers in the machine to show that it contained only mechanical elements. Poe proposes that Maelzel opened and closed these compartments and drawers in a precise order that permitted the person inside to slide an inner panel and move around at the right moment and thus remain hidden. He concludes that, in spite of the mechanics of the machine always in view, there remained always a locked space inside the machine.
— This inner sliding panel constitutes part of Poe’s solution to the hoax in the article. It is transposed to the tale where it becomes a sliding window that also constitutes part of the solution to the locked room mystery for Dupin. 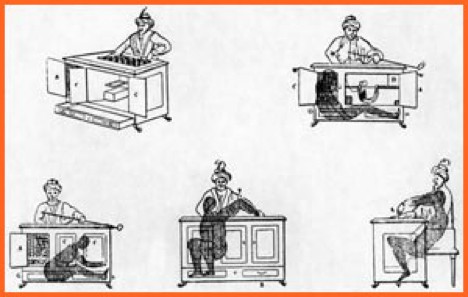 We find out that the ourang-outang enters the apartment through such a window and by chance a nail in the window frame locks the window upon its exit. The animal, in other words, like the supposed person inside the machine, moves around thanks to a sliding mechanism and thus remains hidden to the neighbors who arrive on the scene just as the murder was taking place.
We find out that the ourang-outang enters the apartment through such a window and by chance a nail in the window frame locks the window upon its exit. The animal, in other words, like the supposed person inside the machine, moves around thanks to a sliding mechanism and thus remains hidden to the neighbors who arrive on the scene just as the murder was taking place.
— The structures of the article and the tale are also very similar. Both start with a long, general, abstract, and to a certain extent epistemological discussion which then turns to a concrete description of the automaton in the article and into a narrative in the tale which is supposed to illustrate the epistemological discussion. Moreover, the epistemological discussion in both are precisely on the same topic, but taken from slightly different angles. In the article, Poe distinguishes the functioning of a machine and the nature of human thought. In the tale, which has very much the appearance of an article in the beginning, Poe distinguishes mathematical analysis from human analysis, between the computable and the thinkable. This distinction is summarized by an aphorism that we find in the first few lines of the tale: “Yet, to calculate is not in itself to analyze.” I think that we can read the three Dupin stories as an unpacking of that aphorism. The second tale, “The Mystery of Marie Rogêt,” is labeled clearly as sequel to the first, not in the plot, of course, but in his further development of the aphorism where he will talk mostly about probabilities. In the third tale, “The Purloined Letter,” he will have Dupin pick up explicitly the difference between the thinkable and the computable, to which I will come back.
–In an open letter that was widely published, Charles Babbage, who in 1822 invents a machine to re-calculate the astronomical tables, which he calls the “Difference Engine,” says of his machine that “by the aid of gravity or any other moving power, [it] should become a substitute for one of the lower operations of human intellect.” [4]
–In an anonymous article on that open letter in the British Critic of the same year, Babbage’s modest affirmation that the purpose of his machine would be “a substitute for the lower operations of the human intellect” becomes a “transfer […] from mind and matter –to make the wheel and axle the substitutes of the brain." [5]
–This association of mind and machine lasts a long time. In 1837 John William Draper gives a lecture in the States on recent advances in science, which was published in Southern Literary Messenger a few months after Poe quits his job in that magazine. Draper says of Babbage’s machine “Not only does this system of wheels calculates, as though it was a living and reasoning thing, but even writes down and prints off its labors." [6]
–Around the same time, Ada Lovelace Byron, Lord Byron’s daughter, is getting her training in mathematics from Babbage and is working with him to develop the second generation of his machine, called –note the coincidence—the “Analytic Engine” for which she wrote what is considered today as the first piece of software that was to generate the Bernoulli numbers. She writes a few years later to a friend this exquisite sentence: “I hope to bequeath to generations a calculus of the Nervous System.” [7] Her remark is certainly not as ambitious as her elder’s substitution of mind by matter, but it fits nevertheless within the paradigm because, as we shall see in moment, if there is such a thing as a calculus of the nervous system, that calculus is susceptible to mechanization.
–The preceding year, 1836, Poe publishes “Maezel’s Chess Player” in which we find this remark, astonishing for the accuracy in its description our own computers:
But if Poe invokes the wonder of Babbage’s machine, the most advanced automaton of his time, it is to suggest disbelief in the capacity of a machine to play the much more complicated game of chess and to lead him into a theoretical discussion on the difference between what a machine can do and what human reasoning does. Striking in that discussion is first his thorough understanding of the algorithmic nature of computation:
Le paradigme de la combinatoire chez Valéry, Hilbert et Turing
Le mot signale aussi un but à l’horizon de la recherche, la forme close d’une sphère ou d’un anneau d’idées [4]. Le Système valéryen est alors la représentation de l’ancienne intuition d’un système fermé de la connaissance où chaque élément est « saturé » [5]. » [6] . La comparaison avec l’Ars magna de Lulle, encouragé par Nicole Celeyrette-Pietri, n’est pas sans pertinence, mais nous voudrions nous demander ici s’il est possible de rapprocher la machine autopoïétique, convoitée par Valéry, de modèles qui lui seraient plus contemporains. Umberto Eco, qui évoque justement Lulle dans son étude sur La recherche de la langue parfaite, mentionne le cas, charnière, de Condorcet, qui dans un manuscrit de 1793-1794 cité par l’épistémologue Gilles-Gaston Granger, « rêve d’une langue universelle qui est en réalité une ébauche de logique mathématique, une « langue des calculs » qui identifierait et distinguerait les processus intellectuels, en exprimant des objets réels dont on énonce les rapports, rapports entre objets et opérations réalisées par l’intellect dans la découverte et l’énonciation des rapports. » [7]. Mais le manuscrit s’interrompt avant d’identifier les idées premières et indique que « l’héritage des langues parfaites est en train de se transférer définitivement sur le calcul logico-mathématique, où personne ne songera plus à tracer une liste des contenus idéaux, mais seulement à prescrire des règles syntaxiques. » [8]. Le calcul logico-mathématique et sa visée formaliste nous amène beaucoup plus près du contexte épistémique dans lequel évolue Valéry, marqué par Hilbert dont les travaux fondateurs en mathématiques imprègnent le climat de l’époque et favorisent « l’assurance avec laquelle Valéry se lance dans l’élaboration d’une mathématique de l’esprit. » [9]. Nous étudierons donc ici les convergences entre le premier formalisme de Valéry et celui d’Hilbert, avant d’évaluer si les machines de Turing, qui dérivent du formalisme hilbertien, ne fourniraient pas une comparaison adéquate et chronologiquement plus proche de la machine autopoïétique telle que Valéry peut en nourrir le dessein.
De l’Analysis situs au formalisme axiomatique d’Hilbert
Selon Hourya Sinaceur, spécialiste de la philosophie des mathématiques, l’ancêtre du formalisme, dans bien des aspects, est Leibniz : « il est remarquable que Leibniz ait simultanément mis en valeur l’analyse qualitative des situations géométriques (par son essai d’Analysis situs) et l’analyse symbolique des formes d’expression (dans son insistance répétée sur la nécessité de langues formelles ou « caractéristiques »). » [10]. Comme nous allons le voir, l’analysis situs, ou topologie, est justement sollicitée par Valéry pour mener à bien son projet de topographie mentale : « L’être pensant est un ensemble de systèmes dépendants en acte, indépendants en puissance. Et il y a comme des degrés d’engrenage. […] Le tout dépend de la partie . » [11]. La question est donc de trouver le meilleur moyen de représenter ces « degrés d’engrenage » et c’est ici que le recours à l’analysis situs s’avère opératoire : « La valeur de la topologie pour l’analyse de l’esprit réside dans le fait qu’elle permet d’étudier, en faisant abstraction de toute notion de quantité et de mesure, les rapports de contact et de continuité entre les points et les espaces qui les contiennent. » [12] L’analysis situs est rattachée à la fois à la géométrie non-euclidienne et à la théorie des ensembles qui dégage le primat de l’unité de l’ensemble et, à l’intérieur de celui-ci, celui de la relation, conception qui, comme Judith Robinson le met en évidence, « était parfaitement adaptée à l’idée que Valéry se faisait de l’esprit comme un assemblage d’éléments qu’il faut étudier non pas en eux-mêmes mais dans leurs relations toujours mobiles et fluctuantes avec la structure de l’ « ensemble » mental et de ses innombrables « sous-ensembles ». » [13]. Cantor, dont Valéry lut et discuta longuement avec son ami Féline l’ouvrage Sur les fondements de la théorie des ensembles transfinis [14], développe, dans les années 1870 et 1880, une théorie des ensembles qui fait de l’infini actuel [15] un objet explicite de raisonnements mathématiques. Or, ainsi que le rappelle Pierre Cassou-Noguès, « l’infini actuel suscite une controverse sur les fondements des mathématiques » [16] et c’est dans cette question des fondements des mathématiques que s’inscrivent les travaux de Hilbert, dont l’ouvrage, Les Fondements de la géométrie, « passent pour représenter l’acte de naissance officiel du formalisme axiomatique. » [17]. On pourrait, selon Pierre Cassou-Noguès, présenter l’œuvre d’Hilbert comme une série de problèmes résolus dans différents domaines, le titre de chaque étape étant celui d’un problème. Ce qui pose la question de l’unité de son œuvre. Même si l’activité de Hilbert s’est, contrairement à celle de Léonard de Vinci, limitée à une discipline, elle est présentée par Pierre Cassou-Noguès de la même manière que Valéry présente l’artiste et savant italien dans L’introduction à la méthode de Léonard de Vinci : « Le cheminement de Hilbert n’est pas linéaire. Et l’unité vient plutôt de la méthode. » [18]. Dans sa méthode, la rigueur tient une place essentielle et comparable à celle que tiennent les « gênes exquises » dans la méthode poétique de Valéry. De même que, pour Valéry, la rigueur des « gênes exquises » n’est pas l’ennemie de l’inspiration, la rigueur pour Hilbert n’est pas l’opposée de la simplicité : « la recherche de la rigueur conduit toujours à découvrir des raisonnements plus simples [et] ouvre aussi la voie à des méthodes plus fécondes que les anciennes. » [19]. Lorsque Hilbert explicite les traits que ses travaux mettront à l’honneur, il fait figurer, avec la rigueur, la simplicité et la généralité, qui sont issues d’un même effort d’approfondissement, celui qu’ouvre la méthode abstraite :
« La méthode abstraite, qui émerge en algèbre, décrit les champs mathématiques, non par la nature de leurs objets, mais par leur structure. […] En laissant indéterminée la nature des objets, la méthode abstraite libère les démonstrations des considérations contingentes liées à un champ d’objets particuliers et laisse apparaître le raisonnement dans ses articulations essentielles. » [20] Cette méthode satisfait à la préoccupation valéryenne de faire primer la relation sur la notion. De même que, chez Descartes, savoir, c’est savoir comment on a pu savoir, l’efficacité méthodique que recherche Hilbert cultive la transparence du raisonnement à lui-même : l’indétermination dans laquelle est laissé l’objet facilite la fluidité du raisonnement tel que l’esprit peut se le représenter. Ce qu’il perd en précision sur l’objet, il le gagne en précision sur l’ensemble, dans une économie de type visuel, mettant en évidence la dimension fondamentalement spéculaire de la méthode. La démarche de Hilbert est ainsi comparable à la poétique valéryenne, telle que l’analyse Michel Jarrety :
S’il [Valéry] reproche en effet au langage ordinaire de privilégier la désignation séparée des mots aux dépens de leurs relations, le travail du poème consistera précisément à modifier – parfois jusqu’à la destruction – le sens reçu, qu’il s’agit vraiment d’écarter, en choisissant les termes les plus propres à susciter, par leur association, la substitution qui s’opère par exemple dans le vers de Marceline Desbordes-Valmore, ou qui se rêve par l’ignorance de la réalité dénotée par un mot. [21]
La poétique valéryenne, comme la méthode de Hilbert, font donc subir à la notion une opération de subduction, diminuant son sens pour favoriser sa capacité de mise en relation, de mise en syntaxe et même, dans le cas de Valéry, de substitution. L’appauvrissement du sens singulier des notions que pratique Hilbert ne conduit cependant pas, du moins dans un premier temps, à une perte généralisée et programmée du sens de l’ensemble, substituant, à une sémantique, une mécanique pure : « La méthode abstraite, de l’algèbre puis de l’axiomatique et du formalisme, n’est pas un mécanisme aveugle mais le moyen d’un approfondissement. En ce sens, dira Hilbert, c’est « l’esprit sous-jacent et non pas la contrainte des formules qui produit le résultat attendu. » [22] » [23]. L’approfondissement que réalise la méthode abstraite la mettrait peut-être en contact avec le « sous-sol méthodique » du monde décrit par Bruno Clément dans Le récit de la méthode : « le monde est méthodique, et […] le sous-tendent un certain nombre de principes, de lois, de structures qu’il s’agit seulement de mettre au jour, dans l’abstraction hypothétique d’un sujet quelconque. » [24]. La perte du sens particulier des notions et leur mise en syntaxe les prédisposeraient à entrer en contact avec cette immanence du monde, cet « esprit sous-jacent », qui fonderait alors une forme de « mystique méthodique ». C’est au début de l’année 1898 que Hilbert, qui abandonne ses recherches en algèbre, annonce un cours sur la géométrie euclidienne, qui sera publié sous le titre Fondements de la géométrie, mettant en place la méthode axiomatique des mathématiques modernes. Pierre Cassou-Noguès la présente en ces termes : « Le but d’une axiomatisation, comme celle que Hilbert conduit sur la géométrie euclidienne, est d’isoler des propositions premières, des axiomes, dont les théorèmes suivent par déduction logique. » [25]. À l’instar de la méthode cartésienne, l’on constate ici que c’est l’a priorisme, la méthode déductive qui conduit les raisonnements. C’est précisément cette méthode qui conduit à une réduction du contenu sémantique des objets : « La déduction logique fait abstraction du sens des termes ou du contenu des notions. Or l’axiomatisation ramenant les démonstrations à des déductions logiques partant d’axiomes fixés, nous pouvons dire qu’elle permet de faire abstraction du contenu des notions ou de la nature des objets de la théorie. » [26]. Ce passage à l’abstraction conduit cependant moins à une annulation du sens qu’à sa reconfiguration :
En même temps, puisque tout ce qui sert pour le travail mathématique à l’intérieur d’une théorie axiomatisée est concentré dans l’énoncé des axiomes, nous pouvons dire que les axiomes constituent une définition déguisée des notions. Le mathématicien fait abstraction du contenu usuel des notions, de la nature supposée des objets pour ne considérer que les axiomes, qui suffisent à son travail et suffisent à déterminer les notions de sa théorie. [27]
Ainsi, on serait tenté d’avancer que la déduction logique pratique une réduction fonctionnelle des objets : prélevant de la notion ce qui suffit à son raisonnement, elle remplace l’identité par la fonctionnalité. Ce parti-pris, méthodologique et ontologique, est aussi celui que Valéry dira vouloir appliquer à son Système en 1913, année où il entame véritablement la rédaction de La Jeune Parque :
« Ma « foi » a été dans un système, système de pensée, fondé sur l’équivalence de toutes choses ou de toutes catégories de choses. Et cette équivalence s’oppose à l’identité. J’examine les propriétés des choses diverses au point de vue de leur substitution, dans une structure qui est la connaissance. » [28].
On pourrait probablement voir en Frege le précurseur de ce type de méthode si l’on en croit Ernst Cassirer : « Le rapport qui s’énonce dans l’équation est le seul élément admis ; tandis que les éléments qui interviennent dans ce type de rapport sont encore indéterminés quant à leur signification et ne deviennent peu à peu déterminables que grâce à l’équation. » [29]. Reprenant le projet de Leibniz, Frege construit une langue symbolique, formée de signes précis, interdisant toute équivoque. La recherche de la langue parfaite n’est pas de nature à satisfaire Valéry, car elle signifierait pour lui rien moins que la fin de la pensée. Comme l’analyse Michel Jarrety, citant Valéry : « « si le langage était parfait, l’homme cesserait de penser » [30], parce que la pensée s’appuie sur une parole intérieure où l’individualité de chacun se marque dans le jeu que les pièces du langage, insuffisamment ajustées entre elles et à leurs sens, maintiennent en dépit de tout. » [31]. Mais Michel Jarrety met en évidence la structure des pièces du langage, où l’individualité est subsumée par le « jeu » de l’ensemble, ce qui nous amène au deuxième projet de Frege, conduisant à l’axiomatisation. Il faut donc croire que ces deux projets, celui de la langue parfaite et celui de formalisme, entretiennent une solidarité secrète, pour se croiser à plusieurs reprises dans l’histoire de la pensée pure. Frege analyse ainsi la proposition non plus en termes de sujet et de prédicat, mais de fonctions logiques. Il initie ce changement de paradigme consistant à remplacer la prédication par l’équation. Jacqueline Russ retrace le parcours et les conséquences de cette substitution :
Alors que la logique classique est fondée sur la structure « S est P », Frege s’intéresse à ce que Russell [32] appellera la fonction propositionnelle, c’est-à-dire la formule contenant une ou plusieurs variables. Les travaux de Frege aboutissent ainsi à la première présentation de la logique sous une forme axiomatisée et purifiée (du sensible et de l’empirique), forme permettant de déduire les principes arithmétiques et, d’une manière plus générale, mathématiques [33].
L’entreprise de Frege peut apparaître comme le sommet du rôle attribué à la déduction dans les mathématiques. C’est cette dimension programmatique qui motive la fonctionnalisation des entités : « Notre intention est de constituer le contenu d’un jugement qui se puisse concevoir comme une équation telle que de chaque côté de cette équation est un nombre. Nous allons ainsi…passer du concept déjà acquis d’égalité à ce qui doit être considéré comme égal. » [34]. La tendance méthodologique qui s’exprime ici sous-tend, d’après Ernst Cassirer, « toute la conceptualisation mathématique » : « « la figure » va devoir la totalité de son existence aux relations qu’elle remplit. » [35]. Cette fonctionnalisation a pour corollaire la dimension finie du Système, selon Valéry : « Toute ma « philosophie » est dominée par l’observation du caractère fini – par raison fonctionnelle – de toute « connaissance. ». Ce caractère est réel – tandis que tout non fini est fiduciaire. » [36]. La fiducia désigne la foi naïve dans le commerce des choses, « monnaie mentale ayant cours sans encaisse ni garantie » pour reprendre l’expression de Paul Gifford, qui la met en parallèle avec la bêtise du croire que fustige Valéry : « « croire », dans ce même langage, c’est accepter de donner cours à une telle monnaie sans exiger une conversion possible en or. » [37]. La problématique de la fiducia a partie liée avec celle du signe, au sein d’une métaphore monétaire à laquelle Michel Jarrety a été sensible : « si l’usage ordinaire du langage est de confondre le signe et sa valeur comme le mot et la chose, tout esprit fort doit marquer sa distance avec la monnaie qui a cours » [38]. Il cite alors l’emploi métaphorique de la monnaie chez Valéry : « Le puissant esprit pareil à la puissance politique, bat sa propre monnaie, et ne tolère dans son secret empire que des pièces qui portent son signe. » [39]. Or Valéry voit précisément dans les mathématiques l’empire qui frappe sa propre monnaie, à la mesure de son esprit, le signe étant en relation de quiddité avec sa dénotation ; c’est là que réside sa dimension abstraite, dimension nécessaire à la constitution de son formalisme. On voit donc se dégager chez Valéry une triade : abstraction–fini–formel dont la solidarité est organique. Ce concept d’organisme s’impose ici pour justifier le reproche que Valéry adresse aux physiologistes. Aux physiologistes, il reproche alors de s’occuper beaucoup trop « des éléments individuels dont se composent le corps et le système nerveux, et d’accorder relativement peu d’attention aux rapports réciproques entre ces éléments et à leur rôle dans ce qu’il appelle le « fonctionnement d’ensemble de l’esprit humain » [40] » [41].
Lier formalisme et méthode abstraite implique bien une pensée du signe, chez Valéry comme chez Hilbert. Expliciter les règles de la déduction, qui restaient implicites dans Les fondements de la géométrie, va conduire Hilbert à radicaliser le caractère abstrait du signe : si la formalisation « énonce les axiomes, les prémisses, et les règles de la déduction […] les démonstrations peuvent, en toute rigueur, faire abstraction du sens des termes ou du contenu des notions. Elles sont purement formelles. » [42]. L’abstraction du signe conduit à restreindre son statut, qui devient celui d’un outil de manipulation. La méthode abstraite semble alors se réduire à une mécanique [43] pure, s’il s’agit de « formaliser les théories mathématiques et de les remplacer par des enchaînements de formules, vides de sens, mais conformes à des règles convenues. » [44]. Ainsi Hilbert, passant de l’arithmétique à contenu à l’algèbre formelle et au calcul logique définit-il le fonctionnement de ce mécanisme : « Le résultat est que nous obtenons finalement, à la place de la science mathématique à contenu, science dont l’instrument de communication est la langue usuelle, un stock de formules constituées de signes mathématiques et logiques enchaînés à la suite les uns des autres selon des règles définies. » [45]. Cette manipulation programmée du signe, accomplie au sein d’un ensemble fini tel que Hilbert le conçoit, nous paraît donc assez proche de la combinatoire visée par Valéry. La position de Hilbert, radicalisant la méthode abstraite dans l’élaboration de son axiomatique peut se retrouver dans sa philosophie du signe. Si Hilbert et Brouwer [46], qui proposera une autre doctrine du fondement des mathématiques, reconnaissent tous deux une dualité entre une pensée intérieure – dans l’esprit du mathématicien – et une expression extérieure – sur le papier -, Brouwer ne considère pas l’expression mais seulement la pensée intérieure alors que Hilbert « maintient que la pensée se reflète dans son expression, dans l’enchaînement des formules, de sorte que la métamathématique, qui prend pour objet l’enchaînement des formules, réalise une analyse et, finalement, une fondation de la pensée mathématique. » [47]. La portée de la métamathématique, ou théorie des démonstrations dépend du « reflet », de la relation spéculaire, de l’isomorphisme postulé entre la pensée et son expression. Dans sa conférence au congrès des mathématiciens de 1900, « Sur les problèmes futurs des mathématiques », Hilbert prête une fécondité aux signes, « un effet suggestif, qui, conscient ou non, guide le mathématicien » [48]. L’accent que met Hilbert sur le pouvoir heuristique des signes a un intérêt double : c’est d’abord la suggestion provoquée par les signes algébriques qu’il souligne particulièrement, non celle des figures géométriques dont l’importance est établie, voire convenue. Ensuite, cet « effet suggestif » est relevé par Hilbert au sein d’un processus graphique, évoquant une dynamique d’écriture alimentée par les signes algébriques : « Le mathématicien écrit une formule. Celle-ci demande à être transformée comme une phrase inachevée demande à être complétée. La formule, écrite sur un papier, manifeste des voies que le mathématicien tente de poursuivre. » [49]. Hilbert, sans revendiquer sa place dans ce paradigme, formule une poétique mathématique. Celle-ci doit être rapprochée de la genèse de l’écriture valéryenne telle que Robert Pickering l’a traitée dans son étude sur l’espace de la page et la naissance de l’écriture chez Valéry : « la répercussion d’une conception « motivée » du langage sur l’écriture, entendue dans un sens actif plus large d’initiation et de reflet, mimique des démarches intellectuelles » [50] resterait selon lui à examiner en profondeur chez l’auteur alors que l’œuvre appelle « l’analyse des rapports premiers entre le langage et le réel qui informent la genèse de l’écriture. » [51]. L’étude des régimes scripturaires que conduit Robert Pickering envisage la réalité matérielle du support, de la « feuille » qu’évoque Hilbert, dans son interface avec l’écriture émergente où « la résonance de motivation cratylique comporte un aspect d’ébauche active, de mise en jeu qui brasse les assises du graphisme expressif. » [52]. Il cite ainsi Valéry : « Le son d’un mot fait penser la chose comme le geste du doigt fait voir l’objet » [53]. À côté du cratylisme sonore, qui est distinct de ce que nous voulons observer, c’est cette gestuelle de l’écriture qui nous apparaît frappante et que relaie la phrase suivante : « Les mots forment un système de gestes très nombreux, très divers. ». Le système de pensées aurait chez Valéry pour reflet un système gestuel, chorégraphique même, compte-tenu de sa diversité, mais la relation d’un système à l’autre ne serait pas de la simple réflexion, mais de l’interface dynamique. Les reflets seraient comme des jets de lumière qui se répondraient et se relanceraient ad libitum. Cette portée interactive de la poétique valéryenne restreint la possibilité de la comparer à une combinatoire, dont la mise en œuvre s’effectuerait passivement, et unilatéralement, au risque d’en figer l’intérêt dans une programmatique qui manquerait précisément les richesses de la relance entretenue de la pensée à son support matériel et graphique. Malgré les limites d’une comparaison entre la visée du Système valéryen et le fonctionnement d’une combinatoire, nous allons tout de même proposer un parallèle entre celui-ci et les machines de Turing, pour substituer à l’Ars magna de Lulle un modèle peut-être plus adéquat pour saisir le projet de Valéry mais aussi pour faire entrer sa pensée en résonance avec un champ épistémique plus proche de lui.
Les machines de Turing et le rêve du fini chez Valéry
L’élaboration des machines de Turing fut fortement tributaire du formalisme de Hilbert et s’enracine dans cette pensée du fini. Comme l’écrit Pierre Cassou-Noguès, les machines de Turing répondent à un problème précis : « Qu’est-ce que suivre des règles, des règles qui déterminent nos actions sans ambiguïté et aboutissent réellement à un résultat, réellement, c’est-à-dire en un nombre fini d’étapes ? […] Il s’agit donc de définir la pensée humaine en tant qu’elle est réglée, ou la pensée réglée et finie (puisque le raisonnement humain, s’il doit pouvoir aboutir, semble devoir rester dans le fini : ne mettre en œuvre qu’un nombre fini d’étapes). » [54] Cette idée, ou cet impératif du fini, est au cœur du projet valéryen animant son premier formalisme qui, comme chez Turing, doit pouvoir s’énoncer en un nombre fini d’opérations : « Ma spécialité – Ramener tout à l’étude d’un système fermé sur lui-même et fini. » [55]. Ainsi que l’analyse Nicole Celeyrette-Pietri, « cette « forme du fini, non apparente en général » a donné l’espoir de se rendre maître de l’univers mental par le dénombrement complet de ses opérations. Quelques algorithmes devraient dominer tout le mental comme on parvient à ordonner les décimales de Pi. » [56]. La conception du système replié sur lui-même, et fini, désigne en premier lieu, et désignera probablement jusqu’au bout, comme « sol de nos pensées […] cet ensemble métrique corporel d’actes. » [57]. L’investigation menée par Valéry sur le pouvoir de « l’esprit incarné » va le mener à créer un langage « ne comportant plus que des signes univoques, des termes entièrement convertibles en non-langage – en actes imitables et/ou en sensations – dont les lois de composition, la syntaxe reposent sur le fonctionnement constant de l’Homo. » [58]. Le « Que peut un homme ? » de M. Teste doit se résoudre en « Système fermé, représentatif absolu » [59], faisant écho à la tentative de définition de la pensée humaine de Turing, projets dont le fondement commun est le principe du fini qui, chez Valéry est « posé dès le début » [60]. Le « Que peut un homme ? » lié au « Comment cela marche-t-il ? » donnent lieu à une collusion : « la projection sur les axes de coordonnées de l’agir/sentir et l’animal-machine, modèle de fonctionnement objectif [qui] tentent de collaborer. » [61]. Sonder le potentiel de l’homme pensant revient à le calculer et alors, écrit Valéry, « l’idée-modèle de machine s’impose, et elle n’a pour limite que notre pouvoir de machines » [62]. Etudier l’homme implique de « démonter et remonter des mécanismes dont les pièces et les types sont en nombre fini. » [63]. Le fonctionnement de la machine de Turing, qu’il convient d’exposer dans le détail, correspondrait au dessein valéryen. Nous suivrons ici les explications de Pierre Cassou-Noguès, dans un développement que nous ne reproduirons pas dans son intégralité mais qu’il est difficile de tronquer ou de commenter avant qu’il ne définisse clairement le fonctionnement de la machine de Turing : « Qu’est-ce qu’une machine de Turing ? D’abord, la machine est posée devant un ruban de papier, qui est divisé en cases. Celles-ci ou bien sont vides ou bien portent des symboles (un seul symbole par case) appartenant à une liste finie. La machine peut se déplacer sur le ruban. Elle peut « lire » le symbole sur la case devant laquelle elle se trouve. C’est-à-dire, elle dispose d’une sorte de caméra, de scanner […] braqué sur la case, et ses actions dépendent du symbole qui figure sur cette case (ou du fait qu’il ne s’y trouve pas de symbole. […] Elle est construite avec un programme qui détermine ses actions en fonction du symbole imprimé sur la case devant laquelle la machine est stationnée et de l’état devant lequel se trouve la machine à cet instant. […] Une machine de Turing est un dispositif susceptible d’un nombre fini d’états internes, et dont les actions (se déplacer sur le ruban, imprimer un symbole, changer d’état) sont déterminées par une liste d’instructions […] On suppose également que les symboles que la machine peut imprimer (et reconnaître sur le ruban) appartiennent à un alphabet fini. » [64] Même si la définition des machines de Turing ne dit rien de la nature du dispositif décrit, et seulement qu’il est susceptible d’un nombre fini d’états internes, ceux-ci peuvent être aussi bien matériels que mentaux : « On peut, en effet, considérer que l’esprit humain, si on lui attribue des états internes en nombre fini et qu’il suit un programme, une liste d’instructions, est une machine de Turing. Il en vérifie la définition. » [65]. L’infinité de l’esprit, tel que Valéry se le représente, pourrait se limiter au programme d’une machine de Turing : « Il y a une infinité d’états de connaissance possible, mais ils se résolvent en un nombre restreint de changements et de variations. » [66] Aussi bien pour ce qui concerne le calcul (« tout calcul que nous pouvons réaliser en suivant des règles définies est également susceptible d’être implémenté sur une machine. C’est la thèse de Turing ») [67] que pour les démonstrations formelles, on suppose qu’une machine de Turing est capable de mener à bien ces opérations. Pour chacun des systèmes formels imaginés par les mathématiciens, il est possible de concevoir une machine de Turing « qui écrit, les uns à la suite des autres, toutes les formules prouvables, tous les théorèmes du système. » [68]. L’analogie dégagée entre machine de Turing et système formel, tel que les mathématiciens le conçoivent ou, d’une certaine façon, telle que Valéry rêve de l’élaborer, peut aller jusqu’à l’identification comme le suggère Pierre Cassou-Noguès, ce qui revient à « poser qu’un système formel n’est qu’une liste d’instructions pour une machine de Turing, ou une certaine machine qui déduit les formules que l’on considère comme des théorèmes. » [69]. Pour justifier cette identification, Pierre Cassou-Noguès cite opportunément Gödel, dont la définition du système formel pourrait indifféremment s’appliquer à une machine de Turing : « Un système formel peut simplement être défini comme une procédure mécanique pour produire des formules que l’on peut appeler formules prouvables. [Cela] est requis par le concept de système formel dont l’essence est que le raisonnement y est complètement remplacé par des opérations mécaniques sur les formules. » [70] La mécanique de l’esprit dont Valéry rêve de pouvoir décomposer tous les rouages aurait pour horizon, une fois la définition du Système parfaitement achevée, une fois que tous les éléments du programme auraient été précisés, de fonctionner à la manière d’une machine de Turing. Ses machines ont le mérite de donner « la véritable définition du formalisme » [71]. On voit alors se dégager une triade formel-fini-fonction : formel (la machine de Turing définit le formalisme) – fini (la machine de Turing est susceptible d’un nombre fini d’états internes) – abstraction (la machine de Turing se réduit aux opérations mécaniques sur des formules abstraites), comparable à celle que nous relevions précédemment chez Valéry [72]. Kurt Gödel, logicien dont les résultats tirent les conséquences du programme formaliste de Hilbert, « est convaincu que le cerveau humain est une machine de Turing. » [73]. On peut faire assoner cette définition avec celle du Système valéryen du premier formalisme énoncé par Nicole Celeyrette-Pietri : « Le Système dont la construction fut méthode, aurait épuisé et exactement nommé « les rapports possibles de quelqu’un et de ce qui est » [74] : ni Traité ni Somme, mais fonctionnement réglé [75] d’un cerveau ou d’un Moi réduit à l’intellect, et pensant toutes choses en termes de modèles corporels exprimés par des définitions qui veulent être des équations fonctionnelles. » [76]. Le « modèle corporel » appelle, pour parvenir à raisonner en termes de réglages, un dressage préalable : le Système valéryen, c’est ainsi « un bel organisme, un Gladiator exercé jusqu’à la perfection de son instinct et de sa musculature, et substitué par son animal-machine. » [77]. On serait tenté d’avancer que le « modèle corporel » joue ici le rôle de figure par rapport au « fonctionnement réglé » du cerveau, figure dont Michel Jarrety a montré qu’elle lie Valéry à Descartes : Valéry reconnaît à Descartes un droit à la figure car celle-ci « relève d’une exigence jumelle dans la géométrie et la philosophie : le souci du sensible, qui lui fait admirer chez Descartes l’inventeur de la géométrie analytique qui maintient la puissance perceptive du Sujet que le Cogito pour sa part établit. » [78]. Le pouvoir de Descartes, et ses limites, est inféodé à sa capacité à figurer : « Descartes. Inventeur d’images et de la précision de l’image – maître de l’usage des représentations figurées – et défectueux dès qu’elles sont en défaut » [79]. Ainsi, la fonction d’une figure comme celle du « modèle corporel » n’est pas « ornementale : elle est opératoire, et sert à illustrer, si l’on consent à prendre le verbe au plus près de son étymologie ; ici encore, l’abstraction ne doit demeurer qu’un passage, et la figure vient briser la circularité toujours menaçante de la réflexion : elle conjoint le sensible et l’intelligible. » [80]. La nécessité, l’urgence de recourir à la figure est le signe d’une menace, celui de la circularité décrite par Michel Jarrety, aussi inhérente à la réflexion qu’elle est consubstantielle à tout système formel. Gödel exempte de ce péril l’esprit humain car, selon l’antimatérialisme qui est le sien, il ne se confond pas avec le cerveau : « Ainsi, si l’esprit humain surpasse toute machine de Turing, son fonctionnement est irréductible au mécanisme du cerveau et révèle une autre réalité, une sorte d’âme, elle-même irréductible au monde sensible. » [81] ? Si le « réel de la pensée » est l’unique domaine d’une connaissance « qui ne se paie pas de mots vides », car ces mots sont des formules et qu’elle s’exprime en termes de fonctionnement du corps, donc que sa quantité est « référée » [82], le risque qu’encourt une représentation formaliste est de deux ordres. D’une part, la mécanique manque, comme nous l’avons vu, la dynamique interne que permet le croisement de deux régimes d’écriture et de pensée, entre la dianoia, pensée cérébrale et le graphein, dont nous avons évalué précédemment l’interaction féconde. D’autre part, la mécanique, purement interne tout comme l’analytique [83], risque de s’épuiser comme les machines thermiques en apportent la preuve. La dynamique de la dianoia au graphein échappe par définition à cette mécanique interne de la combinatoire en cycle fermé sinon elle épuiserait vite ses possibilités de relance. On serait tenté de constater ici une limitation de la logique imaginative valéryenne, avant qu’elle ne devienne la théorie des harmoniques [84] : « Dire qu’il y a une logique imaginative, c’est-à-dire que certaines choses étant données ou produites en esprit, d’autres s’ensuivent nécessairement, c’est-à-dire qu’il y a une généralité c’est-à-dire une fixation imaginative. » [85].
De la mathématique pure à la thermodynamique : vers un modèle valéryen de combinatoire
C’est la volonté d’échapper à ce risque de figement, de fixation, qui motive chez Valéry le changement de paradigme, son orientation vers la thermodynamique dont les « images », comme celle que nous proposions avec la machine de Turing, ont, entre autres, le mérite d’être modernes, et de ne pas tirer à elles des cortèges de significations associées, d’implicites, qui en font des outils aussi peu manipulables que le langage commun [86] : « Sur ces notions de « travail », d’ « énergie », etc., que j’emploie sans définitions métriques – je dis que ce sont des images – que j’ai préféré emprunter à la physique moderne (il y a 45 ans) au lieu de me servir des traditionnelles de la philosophie qui sont dérivées de mythologies très anciennes. « Pensée, idée, esprit, âme, intelligence » tout ceci s’entend assez bien quand on ne les met pas sur la table. Mais ce n’est pas fait sur mesure… » [87]. L’emploi du terme « mythologies » entre en contradiction avec la prétention scientifique du Système, quand le refus de recourir à des « définitions métriques » indique le renoncement au paradigme mathématique. Comme le signale Nicole Celeyrette-Pietri, « la recherche des Cahiers ne se fonda qu’un temps bref sur la mathématique pure. Dès 1900 l’infléchissement de la pensée par les concepts physiques se marque dans l’intérêt porté à la thermodynamique. » [88]. Cela s’explique également par la prédilection spontanée qu’une nature comme celle de Valéry, portée à la poésie, pouvait avoir pour une notion comme celle d’énergie [89] mais aussi par l’analyse fine et détaillée que permettaient les mathématiques appliquées : « L’avantage de la théorie de l’énergie est de faire penser à toutes les conditions, circonstances d’un phénomène et de corriger a priori une partie des inconvénients de l’abstraction » [90]. Les mathématiques appliquées offrent l’avantage de prendre en compte un milieu, dont la mathématique pure considère l’action comme nulle. Le fonctionnement du Système valéryen s’éloigne alors du modèle de la machine de Turing, dont Pierre Cassou-Noguès a montré qu’on pouvait la comparer à une horloge [91], congédiant à la fois les paradigme mathématique et mécanique, la mathématique étant trop abstraite, les « analogies mécaniques […] [n’offrant] que des structures très générales » [92]. Le formel pur avoue, tout du moins aux yeux de Valéry, son insuffisance. Nicole Celeyrette-Pietri révèle significativement que, si Valéry connaît Hilbert et le cite, « il n’a pu y trouver les éléments de logique nécessaires à son projet » [93], sans doute, serait-on tenté d’ajouter, parce que celui-ci déborde le cadre de la logique, qui ne pense pas et ne pose pas ses signes en termes d’incarnation. Le milieu ne peut se réduire à une variable de plus de l’équation algébrique. Le fonctionnement du Système s’assimile, dès lors, plus volontiers à un protocole physico-chimique, bien plus apte à saisir « « le modèle vivant – le Seul ! qui est en somme Moi » [94] d’après lequel a voulu se redessiner la philosophie valéryenne, ne peut se réduire à un faire qui serait celui, tout abstrait, du seul formel de la pensée. » [95]. S’intéresser à la thermodynamique n’implique pas, pour Valéry, de renoncer à la fermeture du Système, mais de renoncer à sa formalisation. La dimension finie du Système, dans le vocabulaire de la thermodynamique, s’exprime, comme Judith Robinson le met en évidence, dans les termes de « cycles fermés » : « Il y a un aspect particulier de la thermodynamique qui semble à Valéry convenir parfaitement à l’analyse des processus mentaux : c’est l’idée de « cycles fermés ». On parle, par exemple, du cycle fermé accompli par un système thermodynamique qui passe successivement de la « phase » solide aux phases liquide et gazeuse, pour revenir enfin à la phase solide. Mais, ainsi que Valéry le fait observer, ce même mouvement d’écart et de retour caractérise tout aussi bien l’activité de notre corps, et celle de notre cerveau : « Il faut remarquer dans les êtres vivants, écrit-il, [que] la condition de retour, de cycle fermé est la règle et que toute la notion de fonctionnement l’implique. » [96]. À la triade formel–fini–abstraction se substituerait alors la triade cycle–fini-fonction, le « fini » devant s’entendre comme le milieu, lieu de l’expérience dans son acception double d’expérimentation, et de fait d’éprouver quelque chose, considéré comme un enrichissement de la connaissance. C’est en ce sens que la méthode poétique, conçue simultanément comme réflexion et production des formes, sera appréhendée en tant qu’expérimentation spirituelle : l’esprit, passant par les stades de la pensée (dianoia), de la parole (pneuma) et de l’écriture (graphein) – de même que l’énergie passe par les phases solide, liquide, gazeuse [97] – éprouvant à chaque étape sa quantité référée sur le modèle corporel afin de ne pas exclure son milieu des conditions de l’observation.
En guise de conclusion : la machine thermodynamique de Narcisse
L’une des simplifications adoptées par Valéry pour prendre la thermodynamique comme image de son Système est de « considérer un système isolé, c’est-à-dire sans échange d’énergie avec l’extérieur. » [98]. La « théorie des interventions », qui aurait pu rendre compte de tels apports ne s’est pas encore dotée des instruments permettant de la faire intervenir, elle est donc, d’un point de vue pragmatique « inexistante » [99] et n’autorise pas de transposition. Le mythe de Narcisse, dans son traitement valéryen, lui permettra ainsi d’expérimenter poétiquement le fonctionnement d’un système isolé en circuit fermé.
Thomas VERCRUYSSE : « Le paradigme de la combinatoire chez Valéry, Hilbert et Turing »
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE vol. 6 – (Hiver 2010)
[1] Daniel Oster, Monsieur Valéry, Seuil, 1981. Quand le lieu d’édition n’est pas précisé, il s’agit de Paris.
[2] Nous tenons à remercier Pierre Cassou-Noguès, sur les travaux duquel cette contribution s’appuie largement, d’avoir bien voulu relire une première version de cet article et d’avoir suggéré des modifications.
[3] Paul Valéry, Œuvres, I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 801. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, Valéry et le moi, Klincsieck, 1979, p. 93.
[4] Voir Paul Valéry, Cahiers publiés en fac-similé par le CNRS en 29 volumes, 1957-1961. in Cahiers IV, p. 646.
[5] Paul Valéry, Cahiers, IX, p. 88. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op.cit.
[6] Nicole Celeyrette-Pietri, ibid.
[7] Gilles-Gaston Granger, « Langue universelle et formalisation des sciences. Un fragment inédit de Condorcet », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, VII, 3, p. 197-219. Cité par Umberto Eco, La recherche de la langue parfaite dans la culture, Points-Seuil, 1994, p. 321.
[8] Umberto Eco, op. cit., p. 321.
[9] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 9.
[10] Hourya Sinaceur, « Différents aspects du formalisme », in F. Nef et D. Vernant (dirs.), Le formalisme en question, Vrin, 1998, p. 129.
[11] Paul Valéry, Cahiers III, p. 750.
[12] Judith Robinson, L’analyse de l’esprit dans les Cahiers de Valéry, Corti, 1962, p. 70.
[13] Ibid., p. 69-70.
[14] Ibid., p.69n.
[15] « Si on veut caractériser brièvement la nouvelle conception de l’infini à laquelle Cantor a ouvert la voie, on dira ceci : dans l’Analyse nous n’avons à faire qu’à l’infiniment petit et à l’infiniment grand comme concept limite, comme entité en devenir, en train de naître ou de se produire, i.e. en d’autres termes à de l’infini potentiel. Mais le véritable infini en personne n’est pas là. L’infini véritable, nous le rencontrons au contraire lorsque par exemple nous considérons la collection des nombres 1,2,3,4,… elle-même comme une unité achevée, ou bien encore lorsque nous traitons les points d’un segment de droite comme une collection qui se présente à nous à l’état de totalité achevée. On appelle infini actuel cette sorte d’infini. », David Hilbert, « Sur l’infini », traduction de « Ueber das Unendliche », 1925, traduit, annoté et présenté par Jean Largeault, in Logique mathématique – textes, Armand Colin, 1972, p. 225.
[16] Pierre Cassou-Noguès, Hilbert, Les Belles-Lettres, 2004, p. 23.
[17] Hourya Sinaceur, op. cit., p. 134.
[18] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 36.
[19] David Hilbert, Sur les problèmes futurs des mathématiques, trad. fr. L. Laugel, Sceaux, J. Gabay, 1990, p. 6 (1ère édition allemande 1900). Cité par Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 37.
[20] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 37-38.
[21] Michel Jarrety, Michel Jarrety, Valéry devant la littérature- Mesure de la limite, PUF, 1991, p. 122.
[22] Lettre de Hilbert à Minkowski, citée par Pierre Cassou-Noguès.
[23] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 38.
[24] Bruno Clément, Le récit de la méthode, Seuil, 2005, p.10-11.
[25] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 43.
[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Paul Valéry, Cahiers, V, p. 117.
[29] Ernst Cassirer, « Référence et fonction », in Substance et fonction, Minuit, 1977, [1910], p. 61.
[30] Paul Valéry, Cahiers, V, p. 394. Cité par Michel Jarrety.
[31] Michel Jarrety, op. cit., p. 30.
[32] Frege est l’influence majeure de Russell, dont Valéry était un fervent lecteur comme l’atteste sa lettre à Pierre Honnorat in Lettres à quelques uns, Gallimard, 1952, p. 198.
[33] Jacqueline Russ, La marche des idées contemporaines – Un panorama de la modernité, Armand-Colin, p. 32
[34] Gottlob Frege, Les fondements de l’arithmétique, tr. fr., 1969 [1ère éd. allemande, 1884]. Cité par Ersnt Cassirer, op. cit., p. 61.
[35] Ibid., p. 61-62
[36] Paul Valéry, Cahiers, XXVII, p. 680.
[37] Paul Gifford, Valéry et le dia logue des choses divines, Corti, 1989, p. 22-23.
[38] Michel Jarrety, op. cit., p. 85.
[39] Paul Valéry, Œuvres, II, op. cit., p. 640 sq. Cité par Michel Jarrety, op. cit., p. 86.
[40] Paul Valéry, Cahiers, II, p. 770.
[41] Judith Robinson, op. cit., p. 60. Valéry était un lecteur de Claude Bernard, et de son Introduction à la médecine expérimentale. La démarche de Claude Bernard visait, contrairement à celle de la médecine d’observation hippocratique qui considérait les maladies comme des entités, comme des essences, à agir sur l’organisme en précisant les relations de ses constituants. Canguilhem lui reprochera, à l’instar de Valéry, de ne pas suffisamment prendre en considération le tout de l’organisme. Voir Georges Canguilhem, Le Normal et le Pathologique, chapitre III, « Claude Bernard et la pathologie expérimentale », PUF, 1966, coll. « Quadrige », 1988.
[42] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 50.
[43] « Nous disons qu’elle [la science mathématique] constitue un mécanisme qui, lorsqu’on l’applique à des nombres entiers, doit toujours donner des équations numériques correctes. Mais il faut pousser l’étude de la structure de ce mécanisme assez loin, si l’on veut être capable de reconnaître qu’il en est bien ainsi. ». David Hilbert, « Sur l’infini », op. cit., p. 229. Pousser suffisamment loin l’étude de ce mécanisme conduit effectivement Hilbert, comme on va le voir, à passer de l’arithmétique à contenu à l’algèbre formelle et au calcul logique.
[44] Ibid., p. 51.
[45] Ibid., p. 233.
[46] Luitzen Brouwer développera à partir de 1907 une doctrine originale du fondement des mathématiques : l’intuitionnisme. Comme le précise Jean Largeault, « le formalisme hilbertien et l’intuitionnisme diffèrent sur ce qu’il faut entendre par mathématiques intuitives (des dessins sur le papier pour l’un, des constructions mentales pour l’autre). ». Présentation de « Sur l’infini » de David Hilbert, op. cit., p. 216.
[47] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 142
[48] Ibid.
[49] Ibid.
[50] Robert Pickering, Paul Valéry – La page, l’écriture, Clermont-Ferrand, PUBP, 1996, p. 321.
[51] Ibid.
[52] Ibid.
[53] Paul Valéry, Cahiers, V, p. 864. Cité par Robert Pickering, op. cit., p. 322.
[54] Pierre Cassou-Noguès, Les démons de Gödel – Logique et folie, Seuil, 2007, p. 117.
[55] Paul Valéry, Cahiers, XIX, p. 645.
[56] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 13.
[57] Paul Valéry, Cahiers, XIX, p. 672. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 103. Cette citation des Cahiers date de 1936. Elle est donc postérieure au premier formalisme de Valéry, placé sous le signe de la mathématique pure. Sa recherche s’oriente davantage vers les concepts physiques, notamment vers la thermodynamique, à partir de 1900, comme on le verra en deuxième partie.
[58] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 103. L’Homo, par opposition à l’Ego singulier, désigne l’Homme en général.
[59] Paul Valéry, Cahiers, XXV, p. 341. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit.
[60] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 104n.
[61] Ibid., p. 105.
[62] Paul Valéry, Cahiers, XX, p. 204. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 105.
[63] Nicole Celeyrette-Pietri, ibid.
[64] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 118.
[65] Ibid., p. 119.
[66] Paul Valéry, Cahiers, I, p. 384.
[67] Pierre Cassou-Noguès, op. cit.
[68] Ibid., p. 120.
[69] Ibid.
[70] Kurt Gödel, Collected Works, éd. S. Feferman, J. Dawson et al., Oxford, Clarendon Press, 1934 (Postscript 1964), t.1, p. 370. Cité et traduit de l’anglais par Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 120.
[71] Pierre Cassou-Noguès, op. cit.
[72] Voir infra, p. 7.
[73] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 122.
[74] Paul Valéry, Cahiers, XVI, p. 571. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 108.
[75] Nous soulignons.
[76] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p.108-109.
[77] Ibid., p. 109
[78] Michel Jarrety, op. cit., p. 419.
[79] Paul Valéry, Cahiers, II, p. 517. Cité par Michel Jarrety, ibid.
[80] Michel Jarrety, ibid.
[81] Mais le Système de Valéry, informé par sa poétique qui l’informe en retour, peut-il s’excepter de la circularité uniquement parce que le cerveau s’enracine dans le « Moi-corps » [[Voir Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 102.
[82] L’expression de quantité référée est à mettre au crédit de Nicole Celeyrette-Pietri (Ibid.). On retrouve ici la problématique de la fiducia : les représentations du Système exigent, pour fonder leur valeur, échapper à l’inflation, leur conversion possible, et immédiate, en fonctionnement corporel, comme l’échange monétaire doit être garanti « moyennant échange final contre valeur-or », Paul Valéry, Cahiers, XXII, p. 879. Cité par Michel Jarrety dans la section « La monnaie du puissant esprit » à laquelle nous renvoyons, op. cit., p. 85.
[83] Les limites de l’analytique justifient pour Platon le recours au dialegesthai, à la dialectique. C’est cette clôture qui confine chez lui la mathématique au rang de simple technè.
[84] Voir Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 22.
[85] Paul Valéry, Cahiers, I, p. 896. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op . cit.
[86] Nous rappelons à ce propos à la citation de Michel Jarrety figurant qui définit le nominalisme de Valéry comme la « conscience aiguë de l’inadéquation que les mots maintiennent avec le monde qu’ils ont charge de dire, comme avec la pensée, en raison tout ensemble de l’antériorité et de l’extériorité dont ils se trouvent marqués », Michel Jarrety, op. cit., p. 22.
[87] Paul Valéry, Cahiers, XVIII, p. 303. La citation date de 1935.
[88] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 55.
[89] Le lien entre la notion d’énergie et celle de fini est signalé par Valéry dans une des dernières notations des Cahiers : « Mon premier essai psi (de psychologie ?) fut une idée du fini. Qui devint un point de vue énergétique. », Paul Valéry, Cahiers, XXIX, p. 911.
[90] Paul Valéry, Cahiers, II, p. 663. Le passage est précédé d’une condamnation de la philosophie « dont les inventions explicatives sont plus qu’à moitié des déductions naïves inutiles, vaines – ou bien la simple nomination des difficultés elles mêmes. »
[91] Voir Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 118.
[92] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 56.
[93] Ibid., p. 71.
[94] Paul Valéry, Cahiers, XXVI, p. 826. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 115.
[95] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 115.
[96] Paul Valéry, Cahiers, X, p. 393. Cité par Judith Robinson-Valéry, op. cit., p. 65. Il convient de remarquer que le cycle, comme mesure d’observation, modifie l’appréciation que l’on porte sur la partie. Ce passage met l’accent sur ce point : « Il en résulte que suivant que l’on considère les choses dans un de ces cycles, pendant le cycle, ou bien que l’on envisage la suite sans égard à cette division, à ce pas des choses, – les résultats sont très différents. »
[97] Ce parallèle que nous proposons n’est pas, à notre connaissance, présent chez Valéry lui-même. Il n’est pas non plus superposable : la dianoïa ne correspond pas au stade gazeux, le pneuma au stade liquide et le graphein au stade physique. C’est une analogie métaphorique.
[98] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 58.
[99] « Enfin la théorie des interventions cad des transformations de l’énergie d’un système commandées par un système énergétiquement extérieur au précédent – est inexistante… ». Paul Valéry, Cahiers, III, p. 768.
Dantec et Narby : Sciences, épistémologie et fiction
Sciences et littérature au XXIe siècle selon Maurice Dantec
« L’explosion technoscientifique des cinquante dernières années me semble l’événement historique le plus escamoté par la littérature française de la même période ce qui correspond bien selon moi à l’auto-amnésie à laquelle toute cette nation s’est livrée depuis 1945. » [2]
Une fois établi ce constat d’un déficit scientifique dans la littérature française de la seconde moitié du XXe siècle, Dantec souligne l’existence d’un courant épistémophile, celui de la science-fiction, du moins la science-fiction spéculative qu’il conçoit comme un genre ouvert à toutes les hybridations et transformant la formule de Malraux, il considère que « le XXIe siècle sera scientifique ou ne sera pas. » [3] :
Prendre la culture du XXe siècle là où elle se trouve. Ce monde du XXe siècle a produit sa littérature dans le feu atomique et la suprématie de la technique, pourtant on n’en trouve pas trace dans les académies du bon goût et de l’art officiel. Roman noir, science-fiction, culture underground, c’est des marges qu’il faudra partir pour construire le roman du futur, une machine littéraire synthétique, capable de croiser, au sens générique le thriller, l’anticipation, le roman criminel, le roman d’initiation philosophique, le journalisme de guerre, l’expérimentation psychédélique, le roman d’aventures, de voyages, d’espionnage, sans s’effrayer de privilégier le panoramique au point de vue et sans complexe vis-à-vis des nouvelles technologies, des nouveaux langages, des nouvelles catastrophes 4].
Classer Maurice Dantec comme auteur posthumain n’est pas sans ambiguïté. Cet auteur qui a quitté la France, s’est exilé volontairement – pour reprendre ses termes – au Canada, pays dont il a pris la nationalité, est sans nul doute un écrivain du posthumain, reconnu internationalement et particulièrement aux Etats-Unis ; mais lui-même a développé une pensée critique sur l’idéologie dite posthumaine et lui a substitué l’idéal métahumain. Le posthumain désigne l’un des grands courants de l’imaginaire contemporain qui se manifeste dans la littérature, productrice de techno-mythes, la philosophie, la production artistique : cinéma, arts plastiques, bande dessinée. Cette mouvance de l’imaginaire contemporain, née dans l’univers culturel nord-américain, invente pour un futur proche les conséquences possibles sur l’espèce humaine, de la convergence entre biotechnologies, intelligence artificielle et nanotechnologies. Les capacités d’intervention sur le vivant et la matière, la possibilité de concurrencer les mécanismes de l’évolution créent une potentielle nouvelle démiurgie humaine : l’espèce humaine devient capable de transformer ce qui la définissait, d’où l’expression « posthumain » qui désigne le passage à une nouvelle espèce qui pourrait être produite par l’actuelle et la remplacer. Dans Le Possible et les biotechnologies : essai de philosophie dans les sciences, le philosophe épistémologue Claude Debru introduit ainsi le thème de l’impact des biotechnologies sur la condition humaine : « Les technologies du vivant nous entraînent dans la dynamique d’une néo-évolution, qui pourrait concurrencer les mécanismes établis de l’évolution biologique. En outre, l’artificialisation programmée du vivant a pour conséquence d’élargir le champ imaginable de cette néo-évolution bien au-delà de la vie telle que nous la connaissons sur terre. » [5]
Le « champ imaginable de cette néo-évolution » est le domaine par excellence de l’imaginaire posthumain. Dantec écrit dans Les Temps Modernes en 1997 : « Je suis pour ma part persuadé que le XXIe siècle, et plus encore le suivant vont marquer l’histoire d’une nouvelle révolution anthropologique, sans précédent peut-être ». Ce credo est mis en scène dans les récits de fiction. [6] Ainsi les dialogues didactiques dans cette oeuvre-culte qu’est devenue Babylon Babies :
« – Marie est plus qu’une simple schizo, cher monsieur. Elle est la prochaine étape.
![]() La prochaine étape ?
La prochaine étape ?
![]() Oui, poursuivit Darquandier, sur un timbre de pur métal. La Prochaine Etape. Celle qui vient juste après l’homme. »
Oui, poursuivit Darquandier, sur un timbre de pur métal. La Prochaine Etape. Celle qui vient juste après l’homme. »
Dialogue repris plus loin dans la variation suivante :
« – La mutation ?
![]() La mutation post-humaine. Celle qui sera le produit de l’évolution naturelle et des techniques artificielles. » (BB, p. 551)
La mutation post-humaine. Celle qui sera le produit de l’évolution naturelle et des techniques artificielles. » (BB, p. 551)
Cet univers posthumain, l’historien des sciences Dominique Lecourt le réduit à l’affrontement entre deux variantes dans son Humain, post-humain [7] : le catastrophisme d’une part et le techno-prophétisme de l’autre ou, dit autrement, d’une part le bio-conservatisme et de l’autre le techno-progressisme. Pour Lecourt, ces deux courants opposés sont issus l’un et l’autre d’une même source religieuse, laquelle assigne au projet technologique une mission salvatrice et millénariste. Si l’on devait accepter cette dichotomie, les techno-progressistes se trouveraient aux Etats-Unis, guru–entrepreneur comme Kurzweil, prophète-manager à la William Hasseltine, scientifiques prophétisant comme Eric Drexler, Vernor Vinge, Hans Moravec ou idéologues futuristes comme Fukuyama, sans oublier le mouvement des entropiens ou des transhumanistes. Quant aux bio-conservateurs, Lecourt note qu’ils sont européens, représentés surtout par les philosophes allemands, Jonas et Habermas. En 1979, Le principe de responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique [8] appartenait encore à l’univers de la destruction atomique et de l’eschatologie écologique. S’ajoute, aujourd’hui, un nouvel imaginaire, celui de la dénaturation de l’espèce humaine. Jürgen Habermas est sans doute plus représentatif de ce courant bio-conservateur avec son essai, L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral [9] ; l’ex-cardinal Ratzinger fut l’un de ses lecteurs attentifs.
Il serait néanmoins erroné de voir dans le bio-conservatisme une nouvelle Sainte-Alliance germanique. Le philosophe Peter Sloterdijk a provoqué une polémique considérable en Allemagne, par sa prise en compte de l’imaginaire posthumain, en 1999, avec son Règles pour le parc humain [10], livre auquel Dantec fait référence dans son Théâtre des opérations et qui est à l’origine de celui d’Yves Michaud, Humain, inhumain, trop humain [11] . Le philosophe des sciences, Jean-Pierre Dupuy, après avoir étudié les implications économiques, sociales, politiques, militaires, culturelles, éthiques et métaphysiques du développement prévisible des NBIC [12], les technologies convergentes : nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives, écrivait un article particulièrement sombre, « Le problème théologico-scientifique et la responsabilité de la science » en 2003 : « Ce qui va cependant porter cette visée de non-maîtrise à son accomplissement est le programme nanotechnologique, ce projet démiurgique fait de toutes les techniques de manipulation de la matière, atome par atome, pour la mettre en principe au service de l’humanité ». [13]
L’année précédente, Jean-Pierre Dupuy dans son livre Pour un catastrophisme éclairé exprimait des thèses proches de celles de Dantec critiquant l’idéologie posthumaine. Dupuy citait les arguments pessimistes de l’astronome royal Sir Martin Rees, titulaire de la chaire d’Isaac Newton à Cambridge qui venait de publier un essai au titre emblématique : Our Final Hour. A Scientist’s Warning. How Terror, Error, and Environmental Disaster Threaten Humankind’s Future in this Century — on Earth and Beyond [14]. Pour Sir Martin, l’humanité a une chance sur deux de survivre au XXIe siècle. Ici nous sommes en présence d’un texte écrit par un scientifique mais à contenu spéculatif, nous en verrons un certain nombre plus loin comme les fusées de Crick et le cerveau quantique de Eccles ou l’hypothèse de Narby. Pour Dupuy, la lecture du livre est une confirmation de sa propre vision et il s’attache à montrer que ce pessimisme sur un avenir dit posthumain de l’humanité est partagé par beaucoup [15].
Marina Maestrutti remarque néanmoins que « l’Europe commence à trouver des interprètes “locaux“ d’une certaine vision de l’humain “transhumain“, projeté vers le techno-mythe de la Singularité. Le Suédois Nick Bostrom et le Britannique David Pearce […] obtiennent le soutien et l’intérêt d’institutions comme l’Université d’Oxford, où se trouve le Future of Humanity Institute » [16]. De telles ouvertures, institutionnelles, universitaires, n’existent pas en France, même s’il est apparu dans les dernières années un nouvel intérêt intellectuel pour la science-fiction. En témoigne la publication d’un numéro de Critique intitulé Mutants, où le posthumain abordé sous l’angle américain était défini comme une « entité de mots, d’idéologies, d’imaginations et de fictions qui concerne notre présent encore plus que notre avenir » [17].
L’imaginaire posthumain en France est essentiellement lié à la littérature et aux arts plastiques. Le domaine des arts plastiques comprend les travaux d’art tissulaire d’Art Orienté Objet, les études du zoosystémicien Louis Bec, les biofictions d’Anne Esperet, il a subi l’impact de l‘exposition L’art biotech’ à Nantes en 2003 sous la direction de Jens Hauser et des polémiques associées à la lapine transgénique française d’Edouard Kac. Parmi les écrivains relevant de cette mouvance, nous citerons Jean-Michel Truong, Maurice G. Dantec, Michel Houellebecq, Pierre Bordage, Serge Lehman. Certains viennent de la littérature de science-fiction, comme Bordage et Lehman. Truong est le seul scientifique, spécialiste d’intelligence artificielle. Chez Dantec comme chez Houellebecq et Louise L. Lambrichs, citée pour le traitement particulièrement réusi du thème du clonage humain dans À ton image, le thème posthumain intervient au milieu d’une œuvre déjà avancée, marquée par le roman policier chez Dantec, le roman psychosociologique chez Houellebecq, la tradition intimiste chez Lambrichs [18].
Le récit posthumain de langue française comme littérature spéculative
Dans Possibilité d’une île de Houellebecq, le narrateur désigne ainsi les œuvres de littérature dont ce roman fait justement partie : « La disparition des civilisations humaines, au moins dans sa première phase, ressembla assez à ce qui avait été pronostiqué, dès la fin du XXe siècle, par différents auteurs de science-fiction spéculative. » [19] Babylon Babies met en scène un écrivain de science-fiction, Dantzik, doté d’une biographie analogue à celle de Dantec. Après avoir évoqué dans ses ouvrages les événements en cours il devient lui-même acteur du processus posthumain : « Il faut dire que ce type de prédictions étaient présentes, comme bien d’autres, dans le gros bouquin aux pages écornées que Dantzik avait écrit quinze ans plus tôt. » (BB, p. 628). Le récit posthumain français aime à se définir comme littérature spéculative, le terme provient de l’américain « speculative fiction » – parfois abrégé en « spec-fic » – forgé par Robert A. Heinlein en 1948. Le philosophe Yves Michaud commente ainsi :
[…] la majeure partie des réflexions les plus neuves se développe aujourd’hui non pas chez les philosophes, non pas chez les savants et experts, mais dans la littérature de science-fiction et chez certains artistes […] un livre comme La possibilité d’une île de Michel Houellebecq décrit avec beaucoup de justesse les problèmes posés par le désir d’immortalité, le clonage des humains et la mort des sentiments. [20]
C’est également l’avis de Maurice Dantec :
« Ce sont les auteurs de science-fiction, donc, qui auront donné à voir avec le plus de pertinence les effets et contre-effets de la mutation anthropologique, parmi lesquels la science-fiction elle-même, c’est-à-dire la littérature philosophique fictionnelle de la Révolution Industrielle. » [21]
Dans ses journaux-essais, Georges Dantec analyse le statut de cette littérature de science-fiction spéculative qui remettrait en cause la tradition littéraire française en dépassant la tradition locale de la stricte séparation entre, d’un côté, la littérature générale, « sérieuse […] noble » (ThOp, p. 167), qu’il définit par son obéissance aux canons du réalisme psychologique et du classicisme formel et, de l’autre, la littérature de genre qui « s’enferme avec complaisance dans son rôle de tiers état collabo en continuant de privilégier les mythologies et les narrations traditionnelles, tout en ne sachant pas vraiment faire la différence entre les textes intéressants et les copies de seconde catégorie, quand elle ne sombre pas purement et simplement dans la médiocrité la plus crasse et l’illisible. Entre les deux : territoire zéro. » (ThOp, p. 167).
L’une des différences selon Dantec entre la littérature anglo-saxonne et la littérature française réside dans l’existence en langue anglaise d’une « littérature expérimentale, radicale et futuriste » (ThOp, p. 146), où il compte Burroughs, Ballard, Dick, De Lillo. La tradition française aurait empêché la création d’un tel champ expérimental et aurait ainsi condamné sa production littéraire à rester « superbement isolée dans ce provincialisme chic et passéiste devenu désormais sa marque de fabrique » (ibid.). Cette littérature transgénique anglo-saxonne, « la littérature pop des quatre dernières décennies » (ibid.), représente un modèle pour le récit posthumain de langue française, en constituant « la synthèse accomplie de la littérature d’avant-garde et du roman populaire » (ibid.). Le roman posthumain français créerait un genre jusqu’alors impossible sur les bords de Seine, celui de la littérature pop expérimentale, qui rendrait également caduque l’idée d’une simple opposition entre les deux courants de pensée, catastrophisme ou techno-progressisme :
« Je me retrouve face à l’horripilante dialectique décadente qu’on nous revend depuis des lustres : le cyberoptimisme sauce soja californienne d’un côté, le sociopessimisme mayonnaise exception française, de l’autre, en deux mots : le néant. Nous devons affirmer notre totale insoumission à ces dialectiques mortifères. » (LCG, p. 122)
Le récit posthumain français affiche son intertextualité : La possibilité d’une île est sous l’influence de Demain les chiens de Clifford D. Simak, tout comme Cosmos Incorporated contient des éléments de réécriture des Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de Philip K. Dick, ce que souligne le titre de l’un des chapitres de Dantec : « Les androïdes rêvent-ils de saints catholiques ? » [22]. Cette conception de la littérature comme laboratoire d’idées – l’un des journaux de Dantec s’appelle Laboratoire de catastrophe générale – et comme possibilité d’intervention sur le réel, comme futurologie appliquée, rejoint les observations de Marina Maestrutti au sujet de la fiction – la science-fiction – comme « expérience de pensée » :
La fiction fonctionne alors comme une sorte « d’expérience de pensée », en suivant une logique scientifique et en respectant les canons de la mise en scène expérimentale sans pour autant réaliser pratiquement l’expérience. Cependant, la science-fiction n’est pas une simple anticipation des développements futurs de la science ou des possibles applications des technologies. Il s’agit certainement d’un genre littéraire, créateur, original et autonome ; mais, dans certains cas, sa capacité à construire des mondes sociologiquement et politiquement cohérents joue un rôle fondamental dans l’imagination des « mondes possibles », dans lesquels se projette la réflexion éthique, sociologique et parfois même scientifique. [23]
Après avoir rappelé l’origine de l’idée du voyage dans l’espace, qui fut d’abord un mythe littéraire élaboré par les écrivains du XXe siècle, Dantec ajoute que « désormais, les écrivains visionnaires du XXIe siècle devront accomplir pour les mondes microscopiques, et surtout « neuroscopiques », le même travail de création de mythes, et donc de production de réalité » (ThOp, p. 51-52).
Sciences et paradigmes selon Dantec
« – Avez-vous conscience d’utiliser certains thèmes d’une façon récurrente ? – Oui, bien sûr. La dernière crise de l’Occident , la fin de l’homme, l’héritage du XXe siècle. La thématique des romans s’organise toujours autour d’un même faisceau de théories : l’évolutionnisme, la physique quantique, les sciences du cerveau. » (ibid., p. 78)
Dantec aime à rappeller qu’une partie importante de la science-fiction a été écrite par des scientifiques : Asimov, Arthur C. Clarke et même Frank Herbert, mais aussi qu’une partie des concepts actuels comme « réalité virtuelle » ou « cyberespace » ont été inventés par des auteurs de science-fiction. À l’opposé d’un auteur comme Truong, Dantec en matière scientifique est un autodidacte. Et de l’autodidacte, il garde ou cultive l’image archétypique du dévoreur compulsif de livres et de savoirs. Cette boulimie s’accompagne d’une pratique des stupéfiants, en particulier à base d’amphétamines. Il est tentant de mettre en parallèle telle page du Manuel de survie en territoire zero, où l’auteur décrit sa « boulimie » personnelle de lecture – « Je ne sais quelle énergie, quelle voracité me pousse à lire en une journée de vingt-cinq heures » (ThOp, p. 529) – avec telle page de fiction où les personnages sont des projections de cette épistémophile démesure : « J’étais devenu un appendice de la bibliothèque de Wolfman. Un appendice qui se nourissait de ce qui le dévorait, c’était assez paradoxal tout ça, mais je m’y étais fait, aux paradoxes. » (VV, p. 314) ou encore avec telle spécification de l’être humain comme « l’animal doté de mémoire, incapable de ne pas apprendre, toujours en quête de connaissance, jamais rassasié, jamais fini, imparfait, et imperfectible » (ThOp, p. 18).
Dantec est l’un des écrivains contemporains de langue française les plus engagés dans la promotion de cette double culture littéraire et scientifique prônée jadis par C. P. Snow : « il est clair désormais que la mécanique quantique et la thermodynamique ne peuvent plus être tenues à l’écart de toute tentative un tant soit peu pertinente d’éclairer notre condition. » (Ibid., p. 137). Mais de quel type de sciences s’agit-il en réalité ? L’épistémè de Dantec s’appuie sur trois axes privilégiés : la physique, les neurosciences, les théories de l’évolution. Cette physique se décline sous plusieurs formes : physique quantique, notamment dans son lien aux neurosciences à la suite des textes de Eccles, thermodynamique avec de nombreuses occurrences de l’entropie, théorie du chaos, fractales, théorie des cordes. De manière emblématique, la rencontre personnelle entre Dantec et Narby a lieu lors d’un colloque intitulé « Sciences-Frontières », « consacré aux marges de la recherche scientifique » (LCG, p. 66), aux frontières de la science. En effet, ce qui intéresse Dantec, ce ne sont pas les paradigmes scientifiques dominants mais au contraire, les discours déviants, marginaux ou marginalisés, les écrits spéculatifs à l’écart du courant officiel, en marge ou aux frontières, comme les discours gnostiques – qui le fascinent tant – par rapport aux dogmes religieux. Les discours scientifiques (ou de facture scientifique) dont il s’inspire sont de manière privilégiée et systématique déviants par rapport aux discours dominants : ils traitent de questions controversées ou ont un caractère d’anticipation, comme si la fiction spéculative de Dantec s’appuyait sur des sciences elles-mêmes spéculatives. Cette prédilection pour les hypothèses difficilement contrôlables dans le présent s’accompagne d’une critique du rationalisme positiviste ; mais en même temps, l’élaboration d’un discours épistémologique chez Dantec doit beaucoup à la pensée popperienne et, en particulier, à l’épistémologie qu’il a fondée sur sa théorie de la falsifiabilité [24]… Autrement dit, sur ce qui, par définition, fait défaut aux théories spéculatives. C’est que l’expérience de pensée est l’équivalent, dans la fiction, de la falsifiabilité dans la science :
« Nous n’écrivons pas d’essais philosophiques au sens propre, mais nous tâchons de voir ce qui se produit quand un certain nombre d’idées philosophiques, métaphysiques ou scientifiques sont introduites dans le processus naratif même de l’œuvre de fiction ainsi transmutée. » (PP, p. 111)
La pensée épistémologique de Dantec se réclame de la philosophie de Popper, l’une des grandes références philosophiques de l’écrivain, à côté de Deleuze et de Nietzsche. Le premier élément popperien chez Dantec est la célèbre théorie de la démarcation face à des discours qui se présentent comme scientifiques mais qui ne remplissent pas ce qui, pour Popper, constitue le véritable critère de scientificité, à savoir la réfutabilité. La théorie de la falsifiabilité popperienne telle qu’elle est reprise chez Dantec lui sert d’abord comme argument dans sa critique du discours darwiniste dominant, qu’il décrit au tout début de son premier journal, Le théâtre des opérations, comme un conformisme positiviste et une « obsession téléologiste » (ThOp, p. 18) :
« Croire que l’évolution naturelle ou historique, procède d’une quelconque téléologie, d’un ensemble de causae finalis, qui plus est en tendant vers une amélioration progressive et continue, est encore une foi vivante, quoique désormais bien camouflée sous des discours apparemment inverses. » (Ibid., p. 22)
Le développement épistémologique inaugural du Journal métaphysique et polémique de 1999 est consacré au darwinisme, plus exactement à une critique du darwinisme orthodoxe. « En clair, les darwinistes orthodoxes nient toute téléologie pour mieux imposer la leur, le “but“, le “sens“, étant cette fois l’adaptation la plus parfaite au “milieu“. » (Ibid., p. 16). L’auteur met en exergue à la quatrième partie de Babylon Babies, « Homo sapiens neuromatrix », une phrase célèbre de Popper concernant l’impossibilité de faire passer le test de la falsifiabilité à la théorie de l’évolution : « La théorie de la sélection naturelle n’est pas une théorie scientifique que l’on peut mettre à l’épreuve mais plutôt un programme de recherches métaphysique. » (BB, p. 461). Quant à la critique de l’historicisme chez Popper et à sa vision de l’indéterminisme comme seule leçon de l’histoire, elle est réécrite par Dantec à la lumière de la théorie du chaos et des lois de la thermodynamique : l’histoire est « un chaos évolutionniste » (ThOp, p. 158), « le chaos darwinien que les humains appellent Histoire » (BB, p. 529). S’il applique la notion deleuzienne de synthèse disjonctive à la pensée de Narby – « osons réunir et séparer Jeremy Narby et Gilles Deleuze » (PP, p. 246) -, il accomplit la même opération pour Deleuze et Popper, dans une vision de l’économie à venir qui lie les deux auteurs afin de penser « une révolution générale de l’économie » (ThOp, p. 224).
Mais plus encore, c’est le roman lui-même, Babylon Babies, qui est placé sous la figure tutélaire de la pensée popperienne avec une citation en exergue qui touche à deux domaines clefs de l’imaginaire et de la pensée de Dantec : la conscience (donc les neurosciences) et la théorie de l’évolution. Or, il s’agit ici d’aspects de la philosophie de Popper que sa réception en France n’a pas privilégiés : la théorie des trois mondes et le compagnonnage avec Eccles. Dantec cite et reprend la théorie popperienne des trois mondes : « Mieux, il semble bien que le biotope humain – le plan d’évolution coexensif naturel de l’homme – soit la cognition en tant que telle, en tant que procesus évolutionniste du « troisième monde », tel que conceptualisé par Popper. » (LCG, p.60). Il y voit une légitimation de son idée de la nécessité d’une métaphysique.
Popper a écrit également un livre avec le neurophysiologue John Eccles, Prix Nobel, en 1977, The Self and its Brain. Mais ce sont surtout les livres suivants de John Eccles, à visée plus spéculative encore, Evolution du cerveau et création de la conscience de 1994 et Comment la conscience contrôle le cerveau de 1997 qui sont utilisés par Dantec. Le recours à la physique quantique chez Eccles pour expliquer le fonctionnement du cerveau – hypothèse jugée encore spéculative aujourd’hui – est l’un des fondements de la conception du fonctionnement du cerveau chez Dantec. À partir des hypothèses de Eccles qui se trouvent en dehors du paradigme dominant – « si, comme l’a démontré sir John Eccles, il se produit dans le cerveau un étrange phénomène quantique qui tend à faire émerger la conscience avant même que la machine neurologique humaine soit activée » (Ibid., p. 694) -, Dantec avance ses propres déductions : « alors il faut bien admettre que cette phénoménale rencontre du Néant et de l’Infini forme la topologie d’une physique cognitive, pour laquelle il devient peu à peu évident que le cerveau est une métamachine capable de faire remonter des informations à rebrousse-temps, dans toutes les dimensions du continuum, contre toutes les lois du Monde créé, parce qu’il est parfois -trop peu souvent certes – le royal instrument de l’Esprit créateur. » (Ibid.). Le fonctionnement quantique du cerveau, pris chez Eccles, est l’une des idées récurrentes chez Dantec, souvent développée sans référence à son auteur : « La cognition, la Connaissance, comme l’ensemble des phénomènes naturels, et à la différence de nos nombreuses élucubrations idéologiques (qui marchent par simple accrétion ou par dualisme), fonctionne par « saut quantique », par « crises ontologiques » […] » (Ibid., p. 61).
Pour ce qui est des théories évolutionnistes, son anti-orthodoxie n’empêche pas l’omniprésence du vocabulaire darwinien. L’aspect hétérodoxe de sa pensée se manifeste dans différents domaines, le premier étant l’association établie par l’auteur entre darwinisme et « lois thermodynamiques de l’évolution humaine » (ThOp, p. 357). Si l’application – spéculative par rapport aux paradigmes existants – des lois thermodynamiques à l’évolution humaine implique un développement chaotique, alors les thèses sur l’origine de l’espèce doivent être réévaluées. Dantec oppose la thèse de l’origine africaine de l’homme avec la thèse « dite multirégionaliste […] plus récente, et moins solide » (Ibid., p. 365), mais à laquelle vont ses préférences. Sa conception du développememt chaotique, liée à ce qu’il retient des lois thermodynamiques, vient appuyer sa préférence et son explication d’une origine multiple de l’homme. Cette conception multirégionaliste est présentée comme finalement plus probable que la conception issue du paradigme africain dominant, en vertu de « ce que nous savons des lois d’évolution de la vie » (Ibid., p. 367) ; mais ce mécanisme thermodynamique est-il vraiment un savoir commun reconnu ? La thèse multirégionaliste « penche vers une apparition plus ou moins simultanée en divers points et une évolution en rameaux divergents et convergents qui créent un buisson foisonnant et difficilement déchiffrables. » (Ibid., p. 365).
Dans le domaine des théories de l’évolution, une figure apparaît qui incarne un savoir non orthodoxe, et même gnostique dans tous les sens du terme, Madame Dambricourt-Malassé (Ibid., p. 366), collaboratrice de Coppens et admiratrice de Teilhard de Chardin. La présentation de sa thèse permet à Dantec de reprendre le commentaire qui avait inauguré le journal, la critique du darwinisme orthodoxe, l’« un des bastions de l’athéisme positiviste institutionnel » (Ibid., p. 369) qui, pour lui, s’incarne dans les figures de Wilson, Dawkins et Gould.
L’épistémologie hétérodoxe de Dantec ou « Comment j’ai écrit certains de mes livres »
« Nous sommes des scientifiques… notre confrérie ne prône pas un modèle unique de pensée, c’est tout. » (BB, p. 547)
C‘est moins aux paradigmes scientifiques officiels que Dantec se réfère qu’à des discours extérieurs au courant principal, en dehors d’une légitimation consensuelle, même lorsqu’ils sont écrits par des scienfitiques. Une nette attirance personnelle le porte vers les essais hétérodoxes contemporains, vers les spéculations scientifiques dont le statut est comparable à celui des discours gnostiques par rapport au dogme dominant. Quelques héros, individuels ou collectifs sont ainsi mis en avant dans le pantheon scientifique de Dantec : John Eccles, Anne Dalbrincourt, Narby, un groupe de scientifiques de Princeton auteurs de la théorie de la ’Quintessential Universe. Dantec donne un aperçu de son attitude face aux sciences à partir de l’exemple du fonctionnement du cerveau. Après avoir sélectionné trois héros de l’hétérodoxie scientifique – l’un pour le lien entre le cerveau et la physique quantique, l’autre pour l’évolution, l’autre pour l’ADN, les trois grands axes de l’epistémè de Dantec -, il parle de « lectures croisées » :
À tous les étages de notre « structure » biologique, des informations sans arrêt circulent, notre corps tout entier est une messagerie biocosmique inséparable de son antenne neurospinale, l’ADN lui-même est un phénomène coévolutif à la céphalisation des organismes vivants – comme une lecture croisée d’Anne Dambrincourt, de John Eccles et de Jeremy Narby permet précisément de l’envisager en toute sérénité – (LCG, p. 694)
L’utilisation, le maniement des références scientifiques chez Dantec se fait sous la forme « de lectures croisées » de textes non reconnus scientifiquement ou hautement spéculatifs. La sérénité n’est pas nécessairement le but recherché et la technique du croisement de lectures – comme on croise aussi des espèces – est une variante apaisée de l’une des reprises les plus récurrentes de la pensée deleuzienne dans le corpus dantecien : la synthèse disjonctive. Le croisement des œuvres, des pensées, des domaines – « osons réunir et séparer Jeremy Narby et Gilles Deleuze » (PP, p. 246) – est l’une des pratiques de production du sens les plus développées chez l’écrivain :
« N’en doutez pas, il fallait bien un siècle comme celui qui va mourir pour qu’on ose produire un jour une synthèse hautement disjonctive entre disons Léon Bloy, Nietzsche et Niels Bohr ! Vous n’imaginez pas non plus le rire qui peut s’emparer d’un cerveau lorsqu’il est confronté directement à cette vérité ! » (LGC, p. 706)
L’un des objectifs du roman à venir, écrit Dantec sera de « nous éclairer sur la nature des processus de production. » (PP, p. 117). C’est une opération que Dantec a commencée dans ses essais en l’appliquant à son propre travail, énonçant sa conception de la littérature et d’une certaine manière aussi sa manière de réécrire la science, de la transformer en science-fiction. Sa vision progammatique du roman à venir décrit en fait sa méthode présente, « susceptible de réaliser des synthèses disjonctives mettant en relation des champs de connaissance autrefois séparés. » (Ibid.).
La littérature chez Dantec se veut associée à un réseau lié au monde de la science, celui du laboratoire. On peut noter qu’une semblable association s’est créée au même moment entre les arts visuels et les sciences, le laboratoire devenant l’atelier de l’artiste [25]. L’on trouve aussi parfois un réseau supplémentaire, relié à l’intertextualité deleuzienne, qui est celui de la « littérature comme machine de troisième espèce », « une machine de guerre nomade, mentale et biochimique » (PP, p. 113) [26]. Mais même ce motif deleuzien est inclus dans la métaphore dominante : « Le roman du XIXe siècle sera lui aussi un produit de laboratoire, une arme virale » (PP, p. 117).
A la fin du second tome de ces journaux, dans une partie qui constitue une sorte d’essai cosmologique intitulé « Le cosmos est vivant », et dont la présentation imite le style de l’article scientifique professionnel avec une bibliographie à la fin, l’auteur fait référence à la théorie de certains scientifiques de Princeton appelée Quintessential Universe, théorie hautement spéculative comme les aime l’auteur, qui vise à expliquer le rôle de l’énergie sombre. Avec une jubilation évidente – ce que renforce la note en bas de page : « « Cela aura au moins le mérite de – qui sait ? – faire taire les cuistres, prétendument latinistes d’élite, qui croient que je tire mes informations du Journal de Mickey. » (LCG, p. 764) – le texte problématise et met en scène la relation entre un discours scientifique – à vrai dire déjà spéculatif – et sa transformation en science-fiction. Dantec généralise alors le processus de production du sens tel qu’il se réalise chez lui aux écrivains de science-fiction :
Un écrivain, s’il se saisit de telles découvertes, doit impérativement les projeter dans son espace de création/destruction, son cosmos à lui, son théâtre des opérations mental. Sa synthèse ne peut se borner à la traduction-compilation des faits et des théories de la science moderne. Il faut, c’est son travail, qu’il en fasse d’authentiques machines de la pensée-action.[…] Mais il lui faut cependant examiner par l’écriture en mouvement ce dont il s’agit, ou plutôt en retracer mentalement la topologie avant de laisser à l’intuition visonnaire le choix de conclure. Et certes nos précautions ne sont pas tout à fait du même genre que celle que doivent prendre les académies scientifiques. (Ibid., p. 758)
Le bricolage est élevé à une dimension cosmique puisque si dieu ne joue pas aux dés, la vie – « le cosmos est vivant » (Ibid.) -, « c’est elle qui aujourd’hui entreprend de “diriger“ l’évolution du cosmos. Ou disons de “bricoler“ avec le trope génésique de l’univers. » (Ibid.). Que le cosmos soit vivant est une intuition obsédante de l’auteur, qui est liée à sa conception de la diffusion de l’ADN : « le cosmos est une forme de vie. Ou plutôt : qu’il est la métaforme de la vie. ». Il l’explicite dans le troisième tome des Journaux : l’origine de la pensée liée à l’ADN et plus exactement au « junk-DNA » [27] est l’équivalent pour le génome de l’énergie sombre, the dark energy dans le cosmos. Le cosmos est une « métaforme de la vie » (LCG, p. 759) comme il l’écrit dans Laboratoire de catastrophe générale, idée qu’il reprend dans American Black Box lorsqu’il écrit que le « code génétique n’est pas un code. C’est une forme de vie. La métaforme de la vie. » (ABB, p. 267).
Ce traité intitulé « Le cosmos est vivant » se présente d’abord comme un résumé d’énoncés scientifiques, à vrai dire déjà spéculatifs, qui propose ensuite un développement personnel reposant sur une intuition : « Or c’est très exactement ce à quoi notre “intuition” de simple “auteur de science-fiction” nous avait conduit, sans que toutes les étapes nécessaires de la science aient été franchies. Mais maintenant, osons dire que grâce aux chercheurs de Princeton et d’ailleurs, c’est fait. » (LCG, p. 771). Cette intuition, Dantec précise qu’il l’avait eue avant même qu’il déploie, pour l’exemple, une transformation du discours « scientifique » de Princeton en une thèse de science-fiction, thèse qui peut être résumée comme suit : la mathématisation de l’univers ne saurait rendre compte de la réalité de l’univers qui n’est pas seulement physique mais biologique, il existe « une activité consciente de l’univers » (Ibid., p. 759) qui « reste cachée aux formes de vie qui ne possédent pas encore les instrumentations conceptuelles et matérielles capables de la percevoir. » (Ibid., p. 773). Il en va du discours des scientifiques de Princeton comme du discours de Narby : ils sont présentés comme venant confirmer une intuition personnelle de l’auteur : « j’avais plus ou moins intuitivement deviné l’existence » (LCG, p. 67) [des données récoltées chez Narby] et l’idée du cosmos vivant serait née de « notre intuition de simple auteur de science-fiction » (Ibid., p. 771). Cette intuition du cosmos vivant est de même nature que celle qui aurait préfiguré les idées de Narby, l’anthropologue du Serpent cosmique et du « réseau global de la vie » (LSP, p. 116).
Bricolage et boîte à outils
Le théâtre des opérations consacre un long paragraphe à des commentaires contre le livre de Sokal, « un minable pamphlet positiviste » (ThOP, p. 459). Le positivisme, le rationalisme universitaire, voilà l’ennemi. Dans un texte du tome suivant, Dantec rappelle les aveuglements épistémologiques du positivisme qu’il relie finalement aux aveuglements politiques totalitaires : d’abord les « nombreux universitaires rationalistes » qui démontrent l’impossibilité de voler aux débuts de l’aviation, puis leurs successseurs qui s’acharnent contre Einstein et ensuite la physique quantique « puis des universitaires – idéologues vinrent clamer du haut de leurs chaires syndicalisées que l’ADN et la théorie de la sélection naturelle étaient de vieux « fantasmes bourgeois », quand il ne s’agissait pas de vulgaire fascisme » (LCG, p. 732). Dantec met de l’avant le critère de falsifiabilité popperien mais dans son plaidoyer, qui est aussi pro domo, pour l’actuelle « polysémie créatrice » (ThOp, p. 454), avec la libre importation de concepts des sciences dures dans les sciences humaines, il est sans doute plus proche de Kuhn qu’il défend contre les attaques des « petits laborantins de la sociologie positiviste. » (Ibid., p. 457) :
Pourquoi accuser ainsi de débilité ceux qui pensent que certains concepts venus de la physique quantique, des maths, de la cybernétique ou de la biologie pourraient être en mesure de mieux nous faire comprendre l’homme, et ses productions sociales ou culturelles, alors qu’un sir John Eccles, prix Nobel lui, met au même moment en lumière les phénomènes d’ordre probabiliste et quantique qui ne cessent de se produire dans le cerveau, ces phénomènes qui ne cessent de produire la pensée ? (Ibid., p. 455)
S’il ne manifeste pas à l’égard de Kuhn l’allégeance qu’il ne cesse de souligner à l’égard de Popper, la pensée de Kuhn est néanmoins présente dans cette conception de « la polysémie créatrice » – où coexistent des paradigmes différents – qui cherche en effet à dégager ses principes et ses objets de métaphysiques millénaires toujours présents. » (ThOp, p. 454). Cette conception épistémologique, à la fois popperienne et libertaire, réemploie aussi une notion que Lévi-Strauss avait mise en avant, celle du bricolage : « La vie est un immense bric-à- brac », « ce bricolage transfini […] est précisément ce qui caractérise le mieux l’homme et ses créations » (Ibid., p. 452). Et ce bricolage, qui caractérise aussi le travail de l’auteur de science-fiction, nécessite « une petite boîte à outil d’urgence » (Ibid., p. 441).
Dans Babylon Babies, l’explication donnée à Toorop de la connaissance chamanique selon Narby, comme le souligne l’un des personnages, est associée de manière lapidaire à d’autres contextes : « Ça rejoint les intuitions de Deleuze, de Butler, et de bien d’autres, et sans doute jusqu’à Spinoza lui-même. » (BB, p. 556). Une idée que l’on retrouve dans son discours de Cavaillon : « Osons l’alchimie du futur, osons réunir et séparer Jeremy Narby et Gilles Deleuze » (PP, p. 246). Et qu’il développe ensuite davantage dans le premier tome des journaux, sous la forme d’une liste de noms dans une « petite boîte à outils d’urgence à destination de ceux qui parmi les écrivains seraient éventuellement désireux de transmettre l’héritage humain de ce siècle aux mutants du prochain » (ThOp, p. 441). Karl Popper y est nommé pour une « approche quantique et évolutionniste de la connaissance humaine », Nietzsche, Teilhard de Chardin et Bergson pour l’épistémologie, Deleuze, Butler et Bateson « pour comprendre notre condition de neuromachine biologique aux mutations internes continuelles. » (Ibid.). La référence à Butler, dans Babylon Babies comme dans Laboratoire de catastrophe générale, n’est pas explicitée par l’auteur [28]. En revanche, la troisième partie de Babylon Babies, « Amerika on ice », propose en exergue une citation de Donna Harraway – auteur culte d’un A Cyborg Manifesto : Science, Technology and Socalist-Feminism in the Late Twentieth Century – qui est tirée de Simians, Cyborgs and Women : The Reinvention of Nature ; dans le roman, la question du genre est en effet présente à travers une machine neuromatrice bi-sexuée et deux robots homosexuels.
Un texte de Dantec établit un rapport encore plus direct entre son invention de la neuromatrice et la vision du schizophrène chez Deleuze, assimilant la schizophrénie à « une machine matricielle primordiale qui tente de se répliquer à travers toutes les productions de l’homme et qui aujourd’hui y est parvenue, au point que nous ne savons plus ce qu’est le monde en dehors de ses pseudopodes noosphériques. » (ThOp, p. 266). Bien entendu, le réseau sémantique de la schizophrénie est étroitement lié aux écrits deleuziens. Dans ce dialogue fortement didactique entre le personnage principal et le savant, ce dernier reprend l’idée d’un lien entre schizophrénie et capitalisme, lien qui est soutenu par une référence plus générale à Deleuze : « tout est agencement machinique et désirant, comme disait Gilles Deleuze, au-delà du vitalisme et du mécanisme. » (BB, p. 558). Deleuze et Guattari sont encore cités dans un texte consacré justement à l’« économie générale du monde comme processus schizophrénique » (ThOp, p. 47). Dantec place son personnage schizophrène entre deux équivalents, tous deux « aptes à épouser plusieurs personnalités » (BB, p. 557) : le chamane, version héritée – mais contestée – de l’ethnopsychiatrie et la neuromatrice, version cyberpunk. La capacité, attribuée aux chamanes par le savant, de voyager dans l’ADN des êtres vivants est rapprochée de la possibilité, pour le schizophrène, de changer de personnalité. Le savant reprend à son compte l’association entre chamanisme et schizophrénie : la neuromatrice étant leur version technologique, elle peut elle aussi changer de personnalité et s’adapter aux phénomènes de causalité inverse.
Les techno-mythes du cyberpunk , Dantec et le traitement des neurosciences
« La philosophie cyborg considérait la chair et le silicium comme les deux pôles d’un nouveau tao » (Ibid., p. 504).
L’un des grands thèmes de l’imaginaire cyberpunk fut l’implant neuronal, l’insertion et l’association entre neurone et silicone, comme en témoigne le déjà classique Neuromancer de Gibson. L’actualité scientifique contemporaine montre que l’implant neuronal est en train de quitter le domaine de la science-fiction avec les travaux pionniers sur les prothèses neurosensorielles. Cette association entre le neuronal et le silicone que l’on trouve dans Grande Jonction – avec les « neurologiciels » et les « biochips » de Babylon Babies, l’« implant cortical lumière flux/neuronexion avec le triple cerveau/le Livre des Livres s’injecte directement en nous » (VV, p. 790) de Villa Vortex -, trouve son pendant théorique dans des propos maintes fois répétés. Ainsi au début du Théâtre des opérations :
À terme le processus évolutionniste des machines de troisième espèce conduira à l’intégration poussée des puces électroniques et des systèmes nerveux, à tel point que les différences stables et univoques entre les deux genres s’estomperont, et que des nanocomposants informatiques épouseront la structure et le fonctionnement des cellules nerveuses, tandis que les neurones cérébraux, activés par des pharmacopées de pointe et/ou des manipulations transgéniques pourront agir temporairement comme de vugaires mémoires DRAM. (ThOp, p. 52)
« L’implantation de composants informatiques au cœur de notre système nerveux central n’est plus qu’une question d’affinements technologiques […] » (LCG, p. 227), écrit encore Dantec dans le tome suivant des journaux. D’ores et déjà, l’art contemporain, sous la forme du bio-art, art de laboratoire lui-même, a matérialisé ce thème [29]. Les installations de Robin Meier constituent une première recherche esthétique dans le domaine de l’artificialisation des processus cérébraux et une forme pionnière d’équivalent, dans le champ artistique, des textes cyberpunk. Comme l’écrit Marcin Sobieszczanski :
Dans Experiments in Fish / Machine Communication (2007), le réseau de neurones artificiels catégorise les signaux électriques émis par les poissons, apprend leur « grammaire » élémentaire et reverse dans la niche écologique les résultats de son apprentissage catégoriel sous forme des signaux engageant avec les poissons une chaîne de biofeedback où l’entrée sensorielle de l’animal initie la dynamique de la chaîne, au-delà de l’arc réflexe simple, jusqu’à la sphère de la production communicationnelle. [30]
La nouvelle « THX BABY » est fondée sur l’imaginaire de l’implant neuronal, hérité de Gibson et Sterling : « Les divers biologiciels et neuro-univers en provenance de Là-Haut sont des nano-machines vivantes, des sortes de virus programmés pour faire tel type de boulot à l’intérieur de votre système nerveux, appuyer sur tel ou tel bouton, ouvrir telle porte, exciter tel groupe de neurones » (PP, « THX BABY », p. 124). Ce thème est est aussi développé dans Grande Jonction dans sa verson nano-machine. Dans Babylon Babies, Dantec propose une expérience de pensée érotique, sado-masochiste et humoristique de l’utilisation de composants informatiques. Et l’un des grands moments du livre est la jonction entre la culture psychédélique et la culture cyberpunk : « Primo, vous allez prendre une drogue. Deuzio, on va brancher votre cerveau à cette machine, un ordinateur appelé neuromatrice. […] » (BB, p. 541), neuromatrice dont le nom même doit beaucoup à la Neuromachine de B. Sterling [31]. Le thème des neurosciences, l’un des éléments constitutifs de l’univers de Dantec, trouve l’une de ses origines dans la littérature de science-fiction américaine, l’imaginaire cyberpunk avec ses prothèses, ses circuits implantés, la neurochimie, l’interface cerveau-ordinateur.
Par ailleurs, Dantec – et c’est devenu l’une des spécificités de son œuvre – mêle les thèmes scientifiques avec des thèmes religieux d’origine judeo-chrétienne, notamment gnostique. Mais c’est une autre histoire, qui dépasse les limites de l’étude actuelle [32]. La bibliographie à la fin de Villa Vortex se fait un malin plaisir de multiplier les références à des textes issus de la tradition religieuse judeo-chrétienne – Saint-Jean de Patmos, Maître Eckart, le Zohar, etc. – mais ne renvoie à aucun texte scientifique.
Le métahumain et la nécessité des valeurs : l’imaginaire politique
« Créer une nouvelle espèce humaine – une nouvelle biophysique- implique de créer au préalable une nouvelle métaphysique. » (ThOp, p. 502)
Il existe un malentendu sur l’appartenance de Dantec à la mouvance dite posthumaine. Les thèmes traités par l’auteur dans ces livres depuis Babylon Babies et dans certaines nouvelles auparavant, font partie sans conteste de cet imaginaire. Mais contrairement aux cyberpunks et à la mouvance posthumaine américaine, et de manière plus générale en opposition à ceux qui se recommandent du posthumain, Dantec a une vision critique de l’idéologie posthumaine, comme en témoigne la notion de métahumain qu’il a créée pour mieux s’en démarquer. Si Babylon Babies semble un roman posthumain par excellence, l’auteur dans sa présentation du livre se distance de cette idéologie :
Avec Babylon Babies, j’ai essayé de mettre en scène les formes les plus voyantes des nihilismes contemporains. Ces nihilismes représentent toute la gradation que la pensée humaine est en mesure de produire en ce début de XXIe siècle : individualisme hyperconsumériste, mass-médiation générale, désagrégations nationales, tribales et maffieuses, sectarisme néoreligieux, positivisme eugéniste, traçage biotechnologique des individus, anarchisme cybernétique, posthumanité cyborg, percée quasi accidentelle d’une science émergente (rencontre de Dantzik et de Darquandier, et production cataclysmique d’une nouvelle branche évolutionniste d’Homo, (avant que toute réelle ontologie, toute véritable métaphysqiue anthropologique ait pu même former les rudiments d’un projet susceptible d’éduquer un tel être supérieur […] (LCG, p. 349)
L’auteur dresse tout d’abord un « diagnostic » tragique. Il oppose la notion niezstchéenne de surhumain à celle de posthumain. Les conditions d’impréparation psychologique, éthique et métaphysique de l’actuel homo sapiens sont « proprement désastreuses » (Ibid., p. 121) et loin d’être à la hauteur de « ce moment tragique » (Ibid.) qu’est l’avénement posthumain. Dans son style ironique et imprécateur, Dantec voit dans l’homo sapiens contemporain un simple « sursinge capable très bientôt d’interconnecter les cellules de son cerveau avec des machines logiques à hautes performances. Bref un chimpanzé jouant avec une machine à écrire. » (Ibid.). Face aux positivismes, aux logiques économiques et étatiques – et à la différence d’un Sloterdjick qui « semble se résigner à ce que les technosciences soient asservies aux objectifs du capitalisme marchand du troisième type » (Ibid., p. 226) -, l’auteur présente un programme de résistance à ce qu’il considère comme la possibilité d’une nouvelle forme de servitude volontaire : « Qui sait sous quelle nouvelle aberration sociale et métaphysique les hommes ploieront leur volonté et leur conscience, qui sait à quelle tyrannie ils se seront eux mêmes enchaînés ? » (ThOp p. 501).
La version de la mutation anthroplogique que Dantec propose est celle, non pas d’un posthumain dystopique, mais celle du métahumain qui, selon lui, sura apporter des réponses à la hauteur des enjeux épistémologiques, éthiques mais aussi métaphysiques du futur : « Il est donc crucial qu’une pensée alternative, réactive et futuriste se structure immédiatement en prévision de ces temps plus si futurs que ça » (Ibid., p. 502). Les essais de Dantec contiennent ainsi une sorte de politique-fiction du « parc humain » où s’organise une résistance, celle mise en scène dans Grande Jonction ou chez les hackers canadiens de Babylon Babies. Le posthumain est à subir, le métahumain à inventer. Nombreux sont les textes de Dantec qui évoquent la nécessité de dépasser la vision dystopique d’un « Nouveau Monde Très Brave en effet » (LCG, p. 51). Si la mutation anthropologique est inéluctable et déjà à l’œuvre, un « programme d’hominisation supérieur » (ThOp, p. 48) s’impose. « À nous d’œuvrer, dès maintenant pour en faire surgir de nouvelles libertés, à nous d‘inventer les horizons métaphysiques à la mesure, et les contraintes morales à la hauteur. » (Ibid., p. 50).
Alors que « le cyberpunk reste englué dans son ignorance métaphysique » (LCG, p. 34), Dantec tient au contraire que « créer une nouvelle espèce humaine – une nouvelle biophysique- implique de créer au préalable une nouvelle métaphysique. » (ThOp, p. 502). L’auteur tient donc un discours éthique et politique qui est marqué par l’influence de nombreux penseurs de la synthèse disjonctive : Nietzsche, Deleuze, mais aussi la tradition imprécatrice antimoderne française. Discours qui joue d’effets dramatisants face à l’« ère des barbaries terminales » (LCG, p. 237).
Le Laboratoire de catastrophe générale se termine par des salves critiques contre le posthumain, « contre-part tragique à l’émergence du futur. Tragi-comique serait d’ailleurs une expression plus appropriée » (Ibid., p. 849), monde où « la servitude volontaire devient transfinie » (Ibid., p. 851). Et plus tard, American Black Box prend acte de l’heureuse impossibilité, non seulement technique du clonage humain, mais d’abord conceptuelle : « Le clonage n’existe pas. Le clonage est une fiction. » (ABB, p. 265). Il prend acte de la nouvelle prise de conscience de notre ignorance devant la plus grande partie du génome, appelé le « junk-DNA » mais que Dantec, dans un nouvel élan vitaliste, considère comme « une forme de vie. La métaforme de la vie » (Ibid., p. 267).
Un programme de recherche : l’expérience de laboratoire esthétique
Affirmer que l’expérience littéraire est aussi une expérience de laboratoire esthétique implique un programme de recherche. Il existe chez Dantec le projet de faire en sorte que « que le livre épouse dans sa forme les théories scientifiques sur lesquelles il était établi. Transférer dans la forme le sujet. Faire en sorte que sujet et forme ne fassent qu’un. Que des relations s’établissent entre les différents niveaux de narration du livre. » (PP. p. 70).
Au journaliste qui lui demande s’il est d’accord avec le qualificatif de « livre fractal » qui a été conféré à Babylon Babies, Dantec répond en récusant le terme, il écarte l’interprétation dite fractale du roman et s’explique, en termes désenchantés, sur le projet de création d’analogies ou de correspondances entre le thème et la structure : « Fractal ? Pourquoi pas… Mais encore faudrait-il s’entendre sur la définition. Peut-être parce qu’il y avait une volonté mystérieuse de ma part de faire en sorte que la structure générale du livre se retrouve dans certaines de ces microstructures. Et encore, cette chose-là n’a pas été vraiment menée à terme. » (Ibid.) Puis il ajoute : « Ce sont des phénomènes thermodynamiques que j’essayais de mettre en forme, avec encore beaucoup de ratés, à mon avis. […] Vraisemblablement, les narrations linéaires ne sont pas en mesure de présenter une topologie cohérente de cette chose-là » (Ibid.). Le thème fractal existe bien pourtant dans Babylon Babies mais il se réduit à un réseau de récurrences du terme fractal, comme dans cet exemple de « la nervure fractale particulière des plantes héliotropes » (BB, p.153), qui n’est pas sans faire penser à la théorie des analogies et des correspondances dans la pensée dite ésotérique. Dans Villa Vortex, la volonté de correspondance entre le thème du vortex et la forme du récit est un motif dominant du récit, commenté dans le texte même : « Observez le basculement de la narration. C’est comme si tout un monde s’effondrait, comme si tout un univers était aspiré en son centre, tel un trou noir constitutif » (VV, p. 631). La volonté d’élaboration analogique entre le texte de Villa Vortex et la polysémie du terme scientifique de vortex s’exprime d’abord dans les commentaires répétés sur l’existence d’une telle relation, comme si la répétition était l’un de ces actes performatifs dont parle l’auteur, qui « auront produit ce qu’ils disent » (VV, p. 631). Le grand moment de l’analogie dans Villa Vortex se trouve dans le récit de la découverte du lieu exact du crime : « la maison du tueur était un vortex. Elle était la configuration spatiale de son psychisme. Et bien sûr, je fis ce qui devait être fait : descendre directement au sous-sol. […] Je venais ici avec une Théorie. Et cette théorie, c’est un trou. […] » (VV, p. 483). Auparavant, le motif du fractal avait été associée au même lieu : « C’était en quelque sorte le lieu le plus représentatif de la maison. Il s’agissait de son condensé structural, une fractale » (Ibid., p. 473) et le titre de la partie « Le trou noir automne 2001 » (Ibid., p. 585) illustre aussi le vortex psychologique . Ce désir d’analogie chez Dantec repose sur une idée cybernétique à l’image du monde d’aujourd’hui qui « se configure comme une écologie hyper-virale, c’est-à-dire une dynamique performative où code et langage, sans cesse, “permutent“ leur “sens“ et leur “action“ » (ABB, p. 621). L’analogie entre structure du récit et thématique scientifique reste encore du domaine de l’inachevé. La littérature est avant tout un produit de recherche, de laboratoire et sa forme reste encore difficilement envisageable, « se définissant moins par ce qu’elle est que par ce qu’elle n‘est pas, ou pas encore. » (PP. p. 117). Et l’auteur dresse un portrait de ce que cette littérature à venir ne saurait être, qui est aussi une description ironique de certaines techniques propres à l’auteur :
Le tout ne se résumera pas à trouver de brillantes métaphores inspirées peu ou prou de telle ou telle science, ou telle ou telle instrumentation technique, pas plus qu’à simplement produire des modules de jeux formels plus ou moins mathématiques dans lesquels des abaques stylistiques passeraient en revue le champ couvert par la littérature des quinze cents dernières années (Ibid., p. 120)
« Le roman du futur », le « récit à venir » – les références à Blanchot sont explicites dans « Le quatrième monde » de Villa Vortex – sont présentés selon essentiellement deux réseaux métaphoriques, le cybernétique et le neuronal, association que la culture cyberpunk avait explorée en pionnière. Mais là encore ce programme de recherche a pour loi fondamentale la technique du bricolage : « Pour résumer, se pourrait-il que la littérature puisse montrer ainsi, par un bricolage en forme de réseaux, comment fonctionne la matrice même de sa production, à savoir le cerveau humain ? » (Ibid.). Le projet hante l’auteur, semble-t-il, condamné à la frustration. D’où un épisode dépressif à la découverte de Cryptonomicon de Neal Stephenson, « au moment même où j’élabore lentement les deux parties de mon prochain ouvrage de fiction Liber Mundi, “neuromicom“ et “metacortex“, basées sur la structure de l’ADN et les processus de cryptage à l’œuvre dans le « métaprogramme cosmique » (ThOp, p. 214), ouvrage qui ne verra d’ailleurs jamais le jour.
De l’hypothèse Narby à l’effet Narby
Babylon Babies commence littéralement par le nom de Jeremy Narby : Babylon Babies est aussi un « Babylon Narby ». En effet la « Spécial dédicace » [sic], placée avant les citations en exergue et la dédicace aux membres de sa famille, commence ainsi : « À Jeremy Narby, pous ses études sur l’ADN et les rites chamaniques (cf. Le Serpent cosmique, éditions Georg, 1995) ». La réécriture des thèmes du Serpent cosmique, un réseau essentiel du récit, constitue une dette que l’auteur ne cesse de reconnaître. Dans son journal-essai, Dantec célèbre sa rencontre avec Narby, parlant du livre de l’anthropologue comme « une des pierres angulaires » de son roman. Cette réécriture inclut en effet des références à l’auteur du Serpent cosmique et à l’œuvre : « Que connaissez-vous des rites chamaniques d’Amérique du Sud ou de Sibérie ? Que connaissez-vous de Jeremy Narby ? Que connaissez-vous du Serpent Cosmique, monsieur Toorop ? » (BB, p. 552). Par un procédé didactique peu employé dans la technique romanesque, mais ici il est vrai répété pour une autre référence intellectuelle, l’auteur ajoute une note en bas de page dans laquelle il semble répondre à la question citée plus haut : « Anthropologue de l’université de Standford, auteur de la thèse sur l’ADN et les processus cognitifs et leur rapport avec les rites chamaniques, vers 1995. » (Ibid., p. 562).
Né en 1959, Jeremy Narby a été élevé au Canada et en Suisse, il a étudié l’histoire à l’université de Canterbury et obtenu un PhD d’anthropologie à l’université de Standford. Dans le cadre de la préparation de ce doctorat, Narby a passé à partir de 1985 deux ans dans l’Amazonie péruvienne, chez les Ashnaninca, faisant l’inventaire des usages autochtones des ressources de la forêt vierge, avec une visée politique personnelle : aider les Indiens à combattre la destruction écologique programmée par certains secteurs sociaux du pays. Cet engagement politique marque le choix professionnel de l’anthropologue, qui travaille depuis 1989 comme directeur de projets pour l’organisation non gouvernementale « Nouvelle Planète ». Ses deux premiers livres reflétent sa préoccupation première : le premier, intitulé Indigenous People : Field guide for Development de 1988 et le second, Amazonie, de 1990 : l’espoir est indien. Ses livres, écrits en général en français, sont pour la plupart traduits en anglais. C’est en 1995 qu’est publié Le serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir qui rompt, à son corps défendant, l’image de pur acteur social engagé. En 2001, Narby dirige avec Francis Huxley une anthologie dédiée au chamanisme, Chamanes au fil du temps, dans laquelle trois auteurs écrivent sur l’ayahuasca et le thème du serpent cosmique. Parmi ces auteurs figure l’anthropoplogue Luis Leonardo Luna, dont l’article porte sur un concept central du chamanisme d’Amazonie péruvienne : « les plantes qui enseignent ». Le dernier livre de Narby, Intelligence dans la nature : en quête du savoir, écrit en 2005, est une enquête sur la capacité de la nature à transmettre de la connaissance et s’inscrit dans la lignée des enseignements du Serpent cosmique.
Au début de cet ouvrage, Narby faisait allusion à Carlos Castaneda, auteur de livres-culte de la contre-culture comme L’Herbe du diable et la petite fumée paru en 1968 et le Voyage à Ixtlan de 1972, comme dans un rituel pour éloigner le mauvais sort [33]. Connaissant le discrédit associé au nom de Castaneda, il espérait que son sort serait différent, mais il fut comparable : succès public et discrédit de la part des anthropologues et des biologistes. Après la publication du livre de Narby, la question de l’ayahuyasca, virtuellement ignorée durant les trente dernières années dans l’édition française non spécialisée, se met à proliférer. On le retrouve dans la biographie de Manuel Cordova-Rios, écrite par Frank Bruce Lamb [34] en 1971 et traduite en 1999, qui inclut le fameux récit du séjour chez les Huni Kuin qui inspira des scènes de la Forêt d’Emeraude de John Boorman. L’ouvrage classique de Michael Harner, Hallucinogens and Shamanism [35] de 1973 est traduit en 1993. Dans son livre de 1992, Food of the Gods, Terence McKenna [36], essayiste influent de la contre-culture et psychonaute aux marges de l’ethnobotanique, relie l’ayahuasca à la thèse avancée par Robert Gordon Wasson de l’origine enthéogène des religions [37].
La thèse centrale de Narby dans Le serpent cosmique – l’existence d’un lien entre les conceptions chamaniques et le code génétique – est devenue influente dans l’imaginaire contemporain, comme en témoignent son exploitation et ses réécritures par Dantec dans Babylon Babies et d’autres textes, de même que les nombreux sites internet consacrés à ce sujet ou encore les commentaires que lui consacre Roy Ascott. Le succès du récit de Dantec, qui fut traduit en anglais dans la célèbre collection Semiotext(e) (Cambridge, Massachussets, 2005) a contribué à la diffusion des idées de Narby. Le succès de Babylon Babies a relancé les ventes du Serpent cosmique.
Les experiences personnelles de Narby avec l’ayahuasca n’avaient plus à l’époque le moindre caractère pionnier. De nombreuses publications avaient vu le jour, dont le fameux Yage Letters de William Burroughs, co-écrit avec Allan Ginsberg [38] en 1953. En 1968-1969, la grande anthropologue Marlene Dobkin de Rios passa un an en Amazonie péruvienne, près d’Iquitos, étudiant l’utilisation de la plante hallucinogène dans la médecine traditionelle, notamment pour traiter les désordres psychologiques et affectifs. Parmi ses écrits son Visionary Vine : Hallucinogenic Healing in the Peruvian Amazon [39] de 1972, est devenu un ouvrage de référence. L’ethnologue Gerardo Reichel-Dolmatoff dans les années soixante-dix a raconté également ses visions et ses états altérés de conscience liés à l’absorption d’ayahuasca. La liste des spécialistes de l’ayahuasca et du chamanisme amazonien est particulièrement riche : elle compte entre autres les écrits de l’anthropologue ethnobotaniste Richard Evans Schultes [40] – considéré comme le fondateur de l’ethnobotanique moderne – qui jouent un rôle éminent. Le livre des frères Terence and Dennis McKenna [41] , Invisible Landscape, qui raconte leur voyage en Amazonie, s’inspirant des Yage-Letters, exerça une influence sur la connaissance de l’ayahuasca aux États-Unis, en particulier dans les milieux de la contre-culture. Il existe maintenant une forme de tourisme voué à la recherche de la consommation d’ayahuasca.
Le terme « ayahuasca » désigne à la fois une plante et une boisson, la liane et la potion. Cette potion contient, outre la liane appelée ayahuasca, d’autres éléments végétaux [42]. Frédérick Bois-Mariage, psychologue spécialisé en neuropharmacologie souligne le double sens du mot :
« Le terme ayahuasca – qui signifie « liane des esprits ou des morts » dans la langue véhiculaire amérindienne quechua (Incas) – désigne à la fois une plante précise, une liane, pour les botanistes (Banisteriopsis caapi Spruce [ex Grisebach] Morton) et la préparation aqueuse dont elle est toujours l’ingrédient, soit unique soit principal. » [43]
C’est en fait l’autre plante combinée avec la liane dans la potion – généralement des feuilles de chacruna – qui contient les éléments hallucinogènes, essentiellement de la dimethytryptamine (DMT). Consommés seuls, les alcaloïdes de la Chacruna n’ont quasiment aucun effet car ils sont inhibés dans le système digestif digestif par une enzyme, la mono-amine-oxydase (MAO). Et c’est alors qu’intervient la chimie de la liane qui, elle, désinhibe cette enzyme, ce qui a pour effet de laisser la DMT déployer tous ses effets, en stimulant de manière intense l’imagerie mentale. La connaissance des effets de ce mélange remonte chez les Indiens d’Amérique du Sud à environ cinq mille ans, alors qu’aujourd’hui des mouvements religieux fondés sur l’utilisation de l’ayahuasca se sont répandus sur la planète, les plus fameux étant le Santo Daime et le União do Vegetal. Luna a observé qu’au moins soixante douze peuples amazoniens, séparés par la distance, le langage et les différences culturelles, possédaient pourtant une même connaissance de l’ayahuasca et de son utilisation. Narby fait sienne une réflexion de l’ethnobotaniste Richard Evans Schultes : « On se demande comment des peuples de sociétés primitives, sans connaissance ni de chimie ni de physiologie, ont réussi à trouver une solution à l’activation d’un alcaloïde via un inhibiteur de monoamine oxydase. » [44].
Une égo-histoire épistémologique
Le serpent cosmique appartient au genre de l’ego-histoire et comporte deux récits : le premier relate l’enquête anthropologique de terrain en Amazonie péruvienne, le second constitue une auto-analyse de la découverte de l’hypothèse qui porte son nom. Pour l’obtention de son doctorat, Narby cherchait à démontrer comment les Ashaninca utilisaient les ressources de la forêt de manière rationnelle. Mais la découverte des effets de l’ayahuasca et le fait que les propriétés médicales des pantes puissent être enseignées en ingurgitant cette concoction hallucinogène viennent parasiter le projet initial. Cette étrange révélation lui cause de tels soucis épistémologiques qu’il préfère au départ l’ignorer. En effet, pour sa thèse, il jugeait contre-productive l’idée d’une origine hallucinogène des connaissances indiennes alors même qu’il voulait démontrer que les Indiens utilisaient de manière rationnelle les ressources naturelles du bassin, contrairement à l’opinion des autorités publiques péruviennes et des experts étrangers, tous partisans de la déforestation : « En réalité, dans l’arrogance de ma jeunesse, je considérais que l’étude de la mythologie était un passe-temps inutile, voire “ réactionnaire“. » (Le serpent cosmique, p. 33).
Le second récit constitue encore une histoire personnelle, celle de la découverte compliquée de son hypothèse, durant les rigueurs d’un hiver suisse. Narby a en effet réussi – et c’est aussi l’une des clefs du succès de ce livre – à faire d’une enquête de terrain et d’une recherche scientifique un récit autobiographique jouant avec le code du suspens, bref de la littérature : « En racontant ma propre histoire, j’ai voulu créer un récit accessible et compréhensible » (Ibid., p. 151). Cette stratégie d’écriture avec « une approche autobiographique et narrative » (Ibid.) est expliquée par l’auteur à la fin de son livre. Il la légitime en énonçant plusieurs justifications épistémologiques. La première est que l’anthropologie contemporaine se conçoit davantage comme « une forme d’interprétation plutôt qu’une science » (Ibid., p. 150), le regard réflexif sur sa propre activité scientifique était devenu à l’époque une pratique inclue dans la recherche elle-même. S’engageant dans des considérations épistémologiques hostiles au « regard éloigné » de Lévi-Strauss, il se recommande des analyses de Bourdieu : « comme l’a dit Pierre Bourdieu, l’objectivisme omet d’objectiver sa relation objectivante » (Ibid., p. 20), ce qui explique sa conception du travail de terrain : « La plupart du temps, j’écrivais le soir, couché sur ma couverture, juste avant de dormir. Je notais simplement ce que j’avais fait au cours de la journée et les choses importantes que les gens avaient dites. J’essayais même de réfléchir à mes a priori, sachant qu’il était important d’objectiver ma relation objectivante (Ibid., p. 41). La seconde grande raison invoquée en faveur de ce mode de présentation est l’exemple du chamanisme. Comme si Narby cherchait à renouer avec l’idée parfois avancée des origines chamaniques du fait littéraire.
Cette décision s’inspire aussi des traditions chamaniques qui affirment invariablement que les images, les métaphores et les histoires constituent le meilleur moyen de transmettre le savoir – les mythes étant précisément des sortes de « récits scientifiques » ou des histoires à propos du savoir (le mot « science » venant du latin scire, savoir). (Ibid., p. 151).
L’auteur a de facto divisé le livre en deux parties : la partie narrative, suivie d’une partie scientifique, la seconde, celle des notes, extrêmement abondantes, et qui, avec la bibliographie et l’index, représente plus du quart du livre. Le livre ainsi conçu permet deux types de lectures séparées : la lecture d’un récit d’aventure et celle d’un traité de sciences humaines.
Le chapitre initial est consacré à la narration de la première expérience faite avec l’ayahuasca par le jeune anthropologue. Le cerémonial consiste dans l’absorption d’un liquide si âcre qu’il oblige l’auteur à d’autant plus de vomissements qu’il n’a pas daigné suivre la diète préparatoire. Tout en écoutant des mélodies sifflées par le chaman, il perçoit les premières images :
« Je me suis trouvé entouré par ce que je percevais comme deux gigantesques boas d’une taille approximative de soixante-dix centimètres de haut et de douze à quinze mètres de long. J’étais totalement terrifié. » (Ibid., p. 14)
Le récit de l’expérience est mis entre guillemets, ce qui laisse supposer la simple transcription de notes de terrain. Ces notes sont écrites dans un style d’une simplicité d’autant plus frappante qu’elles relatent tout d’abord des faits inouïs – les serpents lui parlent de manière télépathique, lui expliquant qu’il n’est qu’un être humain – puis son effondrement émotif : « Je sens mon esprit craquer, et dans la faille, je vois dans l’arrogance sans fond de mes a priori. » (Ibid.). Le récit des hallucinations est finalement assez bref, moins de deux pages, et ne comporte aucune comparaison avec des narrations d’expériences personnelles similaires vécues par d’autres anthropologues (lesquelles sont en revanche abondamment évoquées dans l’appareil critique). Les informations données plus tard par le chaman, qui est aussi son informant majeur, rejoignent les propos transcrits par l’anthropologue Luna, auteur en 1984 d’un article intitulé « The concepts of plants as teachers », dans lequel il évoque les « plantes enseignantes » : « Ils disent que l’ayahuasca est un docteur. Il posséde un puissant esprit. On le considère comme un être intelligent avec qui l’on peut établir un rapport, et duquel il est possible d’acquérir de la connaissance et de la puissance. » (Ibid., p. 24). Dans son travail de recherche, l’apprenti-ethnologue bute sur l’origine, pour lui irrationnelle, du savoir des autochtones, alors même qu’il cherche à montrer l’utilisation rationnelle des ressources de la nature par ceux-ci. Le livre commence sur ces mots : « La première fois qu’un homme ashaninca m’a dit que les propriétés médicinales des plantes s’apprenaient en absorbant une mixture hallucinogène, j’ai cru qu’il s’agissait d’une plaisanterie. » (Ibid., p. 9). À la fin du séjour, Narby constate qu’il n’a pas « résolu l’énigme de l’origine hallucinatoire du savoir écologique des Ashaninca. » (Ibid., p. 40).
C’est plus tard, alors que l’anthropologue travaille depuis plusieurs années dans le secteur humanitaire de la défense écologique du Bassin amazonien, qu’il est amené, suite à la déception provoquée par la Conférence de Rio de 1992, à réexaminer cette énigme de l’origine du savoir indigène. Dans les rigueurs de l’hiver suisse, il se consacre à des lectures extensives sur le chamanisme occidental. C’est alors qu’il découvre, dans le récit des expériences de Michael Harner, un rapprochement entre les visions serpentines de l’ayahuasca et la structure de l’ADN. Une phrase, à la lecture du texte The way of the shaman, aura des répercussions majeures sur son esprit, parce qu’elle associe les créatures de l’hallucination – dragons, serpents – à une image de l’ADN : « Rétrospectivement, on pourrait dire qu’elles étaient presque comme de l’ADN, excepté qu’à l’époque, en 1961, je ne savais rien au sujet de l’ADN. » (Ibid., p. 61). Cette association fascine l’auteur qui raconte comment naît en lui l’idée d’un lien entre l’ADN et le serpent cosmique rencontré dans les visions de l’ayahuasca :
« Personne n’avait remarqué les liens possibles entre les « mythes » des peuples « primitifs » et la biologie moléculaire. Personne n’avait vu que la double hélice symbolisait depuis des milliers d’années et dans le monde entier le principe vital, ni que les hallucinations regorgeaient d’information génétique. » (Ibid., p. 76)
Le livre décrit longuement le processus de découverte par l’anthropologue de cette vérité paradoxale, de cette conviction qui s’impose par paliers dans un climat d’intensités psychologiques et de lectures boulimiques sur un mode à la Dantec. En effet, il est étrange de voir à quel point Narby semble être un personnage de Dantec : frénésie de savoir, recherche mettant en cause son équilibre psychologique personnel : « J’étais dans un état émotionnel étrange. […] je sentais une sorte de fébrillité intellectuelle […] » (Ibid., p. 77). Analogies avec les autoportraits de Dantec dans Théâtre des opérations ou avec des personnages conçus comme projections de l’écrivain, tel le Kernal de Villa Vortex. L’énoncé de la découverte de Narby inclut le récit de cette découverte dans un style proche du journal – là aussi un journal laboratoire – avec un enjeu qu’il résume dans son dernier livre Intelligence dans la nature :
« J’ai fini par découvrir des liens entre le chamanisme et la biologie moléculaire, dans mon livre Le serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir. J’ai présenté une hypothèse selon laquelle les chamanes accèdent dans leurs visions à des informations relatives à l’ADN, qu’ils appellent « essences animées » ou esprits » [45]
Une fois énoncée cette première conclusion – « les peuples chamaniques affirmaient l’unité cachée de la nature, confirmée par la biologie moléculaire, parce qu’« ils avaient accés, par voie indirecte, précisément à la réalité de la biologie moléculaire » (LSP, p. 85) -, il reste encore à la justifier. Dès le début, Narby – héros et victime de l’épistémologie – a problématisé l’enjeu cognitif et culturel, les dilemmes, paradoxes et impasses de sa recherche : « Assez rapidement, j’ai accepté l’idée que les hallucinations pouvaient constituer une source d’information vérifiable. Ainsi, dès le début, je savais que ma démarche contredisait certains principes de base de la connaissance occidentale. » (Ibid., p. 134).
Narby va avancer une seconde hypothèse pour expliquer le fonctionnement de cette transmission dans le chapitre « Récepteurs et émetteurs », seconde phase du montage intellectuel. Cette hypothèse, celle de l’émission de photons par l’ADN, est largement reprise par Dantec et constitue l’un des réseaux majeurs de Babylon Babies. Se fondant sur des études récentes de Popp, Gu et Li [46], Narby écrit que toutes les cellules des êtres vivants émettraient des photons et que l’ADN serait la source de ces émissions. Il découvre avec stupeur que la longueur d’onde à laquelle l’ADN émet ces photons correspondrait à celle de la lumière visible. Plus encore, l’émission de ces photons d’origine biologique, les « biophotons », se ferait comme dans un laser, sous la forme d’une matière cohérente, source de couleurs vives et de sensations de profondeur holographique, donc pouvant expliquer l’aspect luminescent des images produites par la potion et la sensation tridimensionnelle. Ces travaux cités sur les biophotons font également partie de la zone grise du savoir scientifique, hors des paradigmes dominants :
Cette connexion me permettait désormais de concevoir un mécanisme neurologique pour mon hypothèse : les molécules de nicotine ou de diméthyltryptamine, contenues dans le tabac ou l’ayahuasca, activent leurs récepteurs respectifs à l’intérieur des neurones, aboutissant à l’excitation de l’ADN et stimulant, entre autres, son émission d’ondes visibles, que les chamanes perçoivent sous formes d’“hallucinations”. [47]
Narby importe donc un élément, la théorie des biophotons, qui relève d’un savoir encore hétérodoxe, hors-paradigme, selon un mouvement analogue à ce que Dantec appelle son “bricolage” : « […] les chercheurs dans ce nouveau domaine auront certainement encore du travail pour convaincre la majorité de leurs collègues » [48]. Narby soumet son hypothèse – l’importation de la théorie des biophotons pour expliquer le fonctionnement cérébral du chamane amazonien en état d’hallucination -à l’un des auteurs de la théorie qu’il a exportée hors de son contexte originel, Fritz-Albert Popp, dans une recherche de légitimation scientifique, de feedback épistémologique :
Au cours de cet entretien, où il confirma la majeure partie de mes impressions, je lui demandai s’il avait considéré la possibilité d’un lien entre l’émission de photons par l’ADN et la conscience. Il répondit : « Oui, la conscience pourrait être constituée par le champ électromagnétique formé par l’ensemble de ces émissions. Mais comme vous le savez, nous comprenons encore très peu de choses concernant les bases neurologiques de la conscience. » [49]
De fait, chamans et biologistes sont d’accord sur l’existence d’une unité cachée derrière la diversité de la vie et associent cette unité avec la forme à double hélice – les deux serpents entrelacés des chamans et le ruban d’ADN – mais il existe une différence épistémologique que Gregory Escande, spécialiste des effets psychologiques de l’ayahuasca, commente :
« La proposition qu’a développée l’anthropologue J. Narby va à l’encontre des énoncés de la science occidentale pour qui (et selon lui) : 1) la nature est inerte et non-intentionnelle et 2) les hallucinations ne sont pas une « source d’information authentique », mais « au mieux illusions, et au pire phénomènes morbides » (Narby, 1995, p. 48). Son hypothèse, qui s’accorde avec le point de vue indigène – à savoir que l’ayahuasca est un « être intelligent avec qui l’on peut établir un rapport, et duquel il est possible d’acquérir de la connaissance et de la puissance » (Luna, cité par Narby, 1995, p. 24) – est celle-ci : le chaman parvient en ingérant l’ayahuasca à acheminer sa conscience au niveau moléculaire pour lui permettre d’entrer en dialogue avec l’ADN. L’anthropologue considère que le « serpent cosmique » (l’une des médiations culturelles utilisée par les autochtones pour s’approprier ce qui surgit – entre autres – dans les visions, à savoir en l’occurrence une forme double spiralée), dont lui parlent les ayahuasqueros (chamans ingérant l’ayahuasca), pourrait être ce que les occidentaux appellent acide désoxyribo-nucléïque (ADN). Les Indiens lui disent en effet que leur savoir botanique provient de leurs sessions avec l’ayahuasca, que c’est la plante elle-même qui leur communique et leur enseigne les propriétés de la flore amazonienne. » [50]
Personnage à la Dantec, l’auteur va souffrir lui aussi de la dépression consécutive au surmenage, à l’insomnie, vivant aussi une évolution personnelle vers ce qu’il appelle la spiritualité : « Toutefois, il y a eu un prix à payer. En m’impliquant de la sorte dans mon propre travail, j’ai perdu des plumes et des nuits de sommeil. En réalité, l’écriture de ce livre et l’élaboration de l’hypothèse qu’il raconte m’ont profondément bouleversé. […] Ainsi je ne dirai pas dans le détail l’impact de mon travail sur ma propre spiritualité et je ne dirai pas aux lecteurs ce qu’ils doivent penser des connexions que j’ai établies. » (LSP, p.151). Si l’hypothèse de Narby lui a coûté un nombre certain de critiques, Dantec est loin d’être le seul défenseur de la thèse. Roy Ascott, artiste pionnier des nouveaux media et acteur majeur sur la scène internationale des relations entre arts et sciences, fait de Narby un emblème de la pensée du XXIe siècle. Il commence par présenter ses thèses, soulignant que le savoir des chamans et le savoir biochimique étudient le même phénomène par différents canaux. Bien que le savoir chamanique provenant de l’ayahuasca, c’est-à-dire d’une modification volontaire de la neurochimie du cerveau, s’exprime à travers un langage chargé de symbolisme mythologique, une telle connaissance produit une compréhension du même monde interne que celui atteint par les discours conceptuels de la biologie. Il souligne que dans la conception de Narby, les chamans peuvent amener leur conscience jusqu’au niveau moléculaire et avoir accès à de l’information liée à l’ADN, qu’ils nomment « essences animées » ou « esprits », ajoutant que de toutes façons, nous ne connaissons pas la fonction de la majeure partie de l’ADN. L’artiste futurologue écrit :
Je pense qu’il vaut la peine de faire ce compte-rendu de l’œuvre de Narby car elle amplifie l’intuition qu’il y a beaucoup à gagner à la fois dans les sciences biologiques et les arts d’une recherche qui cherche des correspondances et des collaborations entre les deux technologies des machines et des plantes à l’intérieur d’un espace natrificiel des Trois Vs, virtuel, validée et végétal. Sur ce nouveau terrain de la connaissance, la planète se contracte pour rendre la forêt vierge brésilienne voisine de la SicilonValley. [51]
Ascott fait de l’ayahuasca la drogue emblématique du XXIe siècle. Un spécialiste de pharmacologie confirme l’universel attrait que l’ayahuasca possède pour les sciences naturelles et humaines :
Cette capacité qu’a l’ayahuasca de surprendre, interroger, solliciter et révéler, de l’échelle individuelle à l’échelle sociétale en Occident, trouve un écho particulier dans les sciences. En effet, peu d’objets de connaissance ont la capacité de mobiliser un éventail de sciences et pratiques affiliées aux sciences aussi large que l’ayahuasca. De la biochimie quantique à la science des religions en passant par l’ethnobotanique, la phytochimie, l’ethnopharmacologie, la neuropharmacologie, la psychopharmacologie, la psychophysiologie, les sciences et pratiques cliniques (médecine, psychologie), l’ethnologie et l’anthropologie. [52]
Le monde du biophoton s’est considérablement élargi depuis sa découverte par Fritz Albert Popp en 1976. Les spécialistes canadiennes Louise Poissant et Ernestine Daubier s’en font l’écho dans leur présentation des relations contemporaines entre art et biotechnologies. Elles voient dans la biophotonique un paradigme nouveau dans la physique et un élément essentiel de créativité dans les arts médiatiques, ceux qui sont marqués par les moistmedia et la technoétique mis de l’avant par Roy Ascott. Mais l’on reconnaîtra aussi l’allusion à la pensée de Narby :
La recherche sur la biophotonique et les champs électromagnétiques revêt une importance particulière pour le développement des moistmedia. On ne trouvera plus paradoxal que notre pensée scientifique fasse appel à des modèles de la conscience et de l’identité humaine fondés sur les traditions spirituelles de cultures jusque là considérées comme étrangères ou marginales. L’art se teintera de plus en plus de nuances psychoactives et l’on trouvera utile de faire le lien entre des modèles archaïques de la conscience comme ceux qu’on trouve en Amazonie ou chez les Tsogho du Gabon, par exemple, et les idées sur la cohérence quantique qui sont exprimées en biophysique et dans la recherche sur la biophotonique. [53]
L’importation de Narby par Dantec
En juin 1994, paraît dans Drunk, une nouvelle de Dantec intitulée THX BABY, qui repose sur l’imaginaire cyberpunk de l’implant neuronal avec « un neuro-lecteur. C’est une simple broche biocompatible, une sorte d’implant, qu’on fixe soi-même, généralement sur la nuque. » (PP, THX BABY, p. 125). Et le texte d’ajouter : « De cela procède la connaissance, un serpent de verbe pur se déroule en moi, comme un ancien code génétique brutalement réveillé, et décrypté à toute vitesse par des enzymes de lumière. » (Ibid., p. 127). Cette phrase résonne de manière éminement narbienne sauf qu’elle a été écrite un an avant la parution du Serpent cosmique et deux ans avant sa lecture par Dantec. L’on comprend mieux le commentaire de l’écrivain sur le livre de Narby, qui « avait été un tel choc, révélant des données scientifiquement collectées dont j’avais plus ou moins intuitivement deviné l’existence (coexistence métamorphique de l’ADN et du cerveau), que je devais en faire une des pierres angulaires de ce premier “roman d’anthroplogie métahumaine“ que fut Babylon Babies. » (LCG, p. 67).
Cette intuition dans Drunk indique l’émergence d’un réseau métaphorique : celui du thème du code génétique traité comme texte. La métaphore textuelle de l’ADN, qui a été étudiée dans The poetics of DNA de Judith Roof, est développée et explicitée par Dantec dans un article de 1997 intitulé « La fiction comme laboratoire anthropologique expérimental ». Mais cette fois l’intuition a perdu son innocence, se déployant en plusieurs réseaux, dont celui de l’ADN comme texte, comme Poetics de l’ADN : « L’ADN lui-même est un roman » (PP, p. 132). Un autre réseau, déjà présent dans l’article de 1994, déploie les virtualités du « verbe » en soulignant cette fois la dimension religieuse de l’expression : « Au commencement était le Verbe » (Ibid.). Le « verbe pur » de THX BABY est devenu le Verbe de la Genèse judéo-chrétienne, avec une majuscule et en italiques. Mais l’intuition se renforce d’un nouveau réseau où est introduite une référence à Narby, la première dans l’œuvre de Dantec :
Au commencement était le Verbe. […] Le grand Verbe Cosmique créa le monde, car celui-ci n’est pas le produit du hasard, il répond selon moi à une conjonction de nécessités « narratives », emboîtées dans une géométrie fractale (donc un chaos déterministe) que les biochimistes détectent jusque dans l’organisation de notre ADN, et que les aborigènes de l’Amazonie testent avec bonheur depuis des millénaires, grâce à des substances aujourd’hui illicites, mais qui sont d’ores et déjà les ferments de la prochaine révolution biotechnologique. […] (PP, p. 133) [54].
L’idiosyncrasie de l’imaginaire de l’ADN chez Dantec inclut aussi un traitement deleuzien, que l’expression « métamorphique » sous-entendait et où le code génétique, le cortex, l’univers et le vivant s’unissent dans l’analogie formelle du pli. En général, l’influence du philosophe est affichée dans le texte même par le biais d’une référence nominale :
[…] le processus paradoxal de la vie même, ce surpli dont parlait Deleuze, ce retournement de la vie, et dont les fondements les plus intimes, la double hélice du code génétique, apparaissent en tant que modèlisation structurale : pliée, repliée, surpliée, hyperpliée sur soi, codex sauvage avalant la chair du monde pour la consumer dans le luxe de la pure beauté,de la pure cruauté, matrice-processeur de tous les possibles. (ThOp, p 54)
La référence deleuzienne dans cet imaginaire de la « connaissance métamorphique » – où se retrouve aussi, comme dans un texte de Caillois, une rêverie sur des formes archétypiques [55] – est encore soulignée plus loin, avec l’allusion directe au titre même d’une oeuvre du philosophe qui, de son côté, avait plusieurs fois fait allusion à Castaneda et aux enseignements du sorcier yaqui.
Comme l’ADN, comme le cerveau, comme la pensée, l’univers macrocosmique est plié, replié, surplié, hyperplié sur lui-même ; repliez à l’infini une spirale sur elle-même et vous obtenez sans doute le plus beau système d’information qui se puisse concevoir : linéarité et circularité sublimées par un « principe n » de leur annulation, de leur équilibre dynamique, dans lequel la vie s’exprime comme articulation paradoxale de la « différence » et de la « répétition. (ThOp, p. 686)
Un autre thème récurrent de Dantec se trouve exprimé dans la nouvelle « THX BABY », celui de l’association entre le thème biblique du verbe et celui de la métaphore du code ou du texte pour désigner le « code » génétique, l’ADN. La nouvelle fait référence à la tradition religieuse judéo-chrétienne de deux manières, tout d’abord par le biais d’une référence aux noces de Canaan mais aussi et surtout par une citation de l’Evangile selon Saint-Jean :
« oui, au commencement de tout, il y avait le Verbe qui est la parole de dieu, le Verbe était avec Dieu et le Verbe était dieu… Saint Jean… le seul des évangiles qui fait remonter le Christ aux origines divines de l’univers et il a sûrement raison. » (PP, THX, p. 126)
Ce rapprochement entre le code de la vie dans l’ADN et la notion de Verbe dans la pensée judéo-chrétienne n’avait pas échappé non plus à Narby dans Le Serpent cosmique : « C’est en écrivant mes notes sur le rapport entre les esprits hallucinatoires faits de langage et l’ADN , que je me rappelai le premier verset du premier chapitre de St Jean : “Au début était le logos – le mot, le verbe, le langage“ » (LSP, p. 77). Plus tard, Dantec développe davantage le lien entre l ’ADN et le texte, non plus seulement biblique mais sous la forme plus laïque de la littérature :
L’ADN est un roman. C’est le roman de notre vie biologique, il est composé de trois milliards de signes, avec un alphabet de quatre lettres, formant environ cent mille paragraphes ou chapitres chacun, un gène, codant l’histoire d’une protéine necessaire […] Vous êtes, je suis, nous sommes le produit d’un texte dupliqué à des millions d’exemplaires dans notre corps, un par cellule. Un roman génétique par personne. (PP, p. 133)
Dans le domaine des arts plastiques, Kac présentait en 1999 une oeuvre intitulée emblématiquement Genesis, autre variation sur le rapprochement entre l’ADN et le Verbe, qu’il décrit ainsi sur son site : « « Genesis » (1998/99) est une oeuvre transgénique qui explore les relations complexes entre la biologie, les systèmes de croyance, les technologies de l’information, les interactions dialogiques, éthiques et l’Internet. L’élément clef de l’oeuvre est un « gène d’artiste », un gène synthétique que j’ai inventé et qui n’existe pas dans la nature. Pour le créer, un verset du livre de la Genèse a été traduit en morse, puis le code morse a été converti en paires de base ADN selon un algorithme de conversion spécifiquement développé pour cette oeuvre. Le verset (Gn 1, 28) dit : « Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ! ». Cette phrase a été choisie pour ses implications au regard de la notion équivoque, approuvée par dieu, de la suprématie de l’Homme sur la nature. » [56]
Dantec avait déjà développé ce lien entre ADN et la Bible, avant la lecture de Narby, chez lequel le lien reste seulement mentionné. Mais à la lecture de Narby, il ajoute les notions de chamanisme et de connaissance par l’hallucination. Il existe encore un réseau lié à l’ADN où le texte de Narby vient confirmer les intuitions de Dantec, celui du cosmos vivant. Les recherches de Narby se concluent par l’idée que « les peuples chamaniques affirmaient l’unité cachée de la nature, confirmée par la biologie moléculaire, parce qu’ils avaient accès, par voie indirecte, précisément à la réalité de la biologie moléculaire. » (LSP, p. 85).
La question de l’origine de l’unité moléculaire du vivant avait conduit Francis Crick, l’un des découvreurs de la structure de l’ADN, à des spéculations sur l’origine cosmique de la vie sur terre, déjà dans un article de 1972, puis dans son livre de 1981 Life itself : its Origin and Nature, où il reprend la thèse de la panspermie, qu’il adapte en une « panspermie dirigée ». Cette thèse de Crick relève d’ailleurs de la science-fiction, puisqu’il fait intervenir des fusées et des voyages interstellaires. Lorsque Narby découvre le scénario de science-fiction de Crick, il y voit d’abord une confirmation de l’unité du vivant mais il repousse ce scénario de Crick au profit de ce qu’il considère comme l’hypothèse chamanique. Le destin du texte de Narby est paradoxal. Il réfute l’hypothèse de science-fiction d’un savant, au nom de la plus grande vraisemblance reconnue à la thèse chamanienne, alors même que sa propre thèse va devenir le sujet d’un roman de science-fiction, Babylon Babies. C’est en tant que concept de science-fiction que son hypothèse qui, pourtant, récusait la science-fiction, sera en effet principalement diffusée :
« De mon nouveau point de vue, le scénario de « panspermie dirigée » proposé par Crick – une fusée spatiale transportant de l’ADN sous forme de bactéries congelées à travers les immensités du cosmos – semblait moins probable que celui d’un serpent cosmique d’une puissance inimaginable, omniscient, fluorescent et terrifiant. » (Ibid., p. 82)
L’unité moléculaire du cosmos, sujet récurrent chez Dantec, traité selon des modes stylistiques différents dans sa Poetics de l’ADN, est décrit et célébré comme un « système fondamental sur lequel s’ appuie et s’édifie l’économie générale biologique du cosmos. L’ADN, présent dans tous les êtres vivants connus à ce jour, est un fluide informatif qui irrigue l’univers […] système d’informations, d’échanges et de lutte contre l’entropie, l’ADN est donc bien avant toute chose un procédé d’écriture, au sens économique pur ; l’ADN, c’est le dollar du cosmos. » (ThOp, p. 109). Dans ce qui relève à la fois de l’intertextualité et d’une communauté d’inspiration vitaliste, Narby appelle « réseau global de la vie » (LSP, p. 116) ce que l’auteur de Babylon Babies nomme « le réseau biologique cosmique » (BB, p. 695). L’évocation du thème de l’unité de la nature donne lieu chez Dantec à une belle envolée lyrique, une sorte de Chant du monde cyberpunk, dont certains éléments ne sont pas sans faire penser aux dernières phrases de Tristes Tropiques de Lévi-Strauss :
Son propre métabolisme, cette machinerie de viande, de sang et d’électricité de bas ampérage n’étant plus qu’une manifestation particulière d’un processeur cosmique dont elle avait toujours soupçonné l’existence, mais dont la présence était désormais manifeste dans chaque iridescence d’atomes ionisés en provenance de l’ampoule halogène, dans chaque grain de poussière, dans chaque grain de poussière, dans chaque rêve d’un chat de passage. Tout autour d’elle vibrait maintenant sur des champs de fréquence biologiques, tout était vivant, tout était lumineux, tout était prodigieusement possible, tout était prévisible, car tout était réel. (Ibid., p. 314)
Ces « champs de fréquence biologique » qui expriment l’unité du vivant peuvent relever sans doute d’une forme de rêverie cosmogonique vitaliste – de fait c’est une intuition première, un phantasme de Dantec au fondement de ses importations et confirmations théoriques – mais cette intuition renvoie d’abord au texte de Narby : à l’image du « réseau global de la vie, à base d’ADN » qui « émet des ondes ultra-faibles » – les « champs de fréquence biologique » chez Dantec – « actuellement à la limite du mesurable, que nous pouvons néanmoins apercevoir en état de défocalisation : hallucination, rêve, etc. » (LSP, p. 116).
Dans Babylon Babies, la référence principale à Narby se fonde sur la théorie des biophotons. Là encore, il existe sinon un paradoxe, du moins une ambiguité. Pour Narby, la théorie des biophotons – plus exactement l’utilisation qu’il fait de cette théorie pour expliquer les techniques chamaniques – constitue une certitude même si elle reste à démontrer scientifiquement. Mais cette théorie, dès lors qu’elle entre dans un roman de science-fiction, devient elle-même un élément de science-fiction, changeant par là de statut. Au mieux une sorte d’expérience de pensée que l’écrivain Dantec met en scène, tout en parsemant le récit de traces quasi-ludiques de sa lecture de Narby. La contre-partie de la publicité considérable faite à la thèse de Narby par la réécriture de Dantec sera sa transformation en une idée de science-fiction, facilement associable à la catégorie particulièrement vivante aujourd’hui du chamanisme cyberpunk. La scène initiale du récit de Narby se passant en Amazonie, une touche d’exotisme vient colorer les textes de Dantec, avec la présence incongrue de l’anaconda. Dans son discours de Cavaillon prononcé devant Narby en 2000, il imagine « l’écrivain à venir » à l’exemple du poète-philosophe nietzschéen, sur le modèle même de ce serpent, version amazonienne des figures philosophiques que sont les animaux dans le Zarathoustra de Nietzsche :
un écrivain d’aujourd’hui se devra donc être toxique, comme le sont tous les grands révélateurs de vérité – ce que Jeremy Narby et Ricardo Tsaquimpq nous ont lumineusemnt démontré hier -, l’écrivain de fiction du troisième millénaire sera un poète-philosophe d’une espèce hautement dangereuse – il sera Anaconda et machine de troisième espèce, intelligence schizo-opérative […] il se devra d’être un authentique saboteur métaphysique. (PP, p. 245)
Dans Babylon Babies, la présence ophidienne amazonienne donne une couleur humoristique au récit : les deux anacondas du vivarium sont dénommés Crick et Watson… et ils s’enroulent comme l’ADN : « Robicek vit apparaître comme un ruban de couleur s’entortillant sur lui-même, il s’était rapproché et avait vu que le ruban était double, et qu’il ressemblait à une échelle se mouvant en spirale. » (BB, p. 348). La symbolique ophidienne – celle du serpent cosmique ruban ADN – associée à la présence du personnage de Marie par qui la mutation anthropique va avoir lieu entre ainsi dans le récit :
« Le sang-message avait formé un double serpent dans le sable. […] Marie savait que c’était un signe de la plus haute importance. […] Sous le serpent chamanique en deux ondes croisées, un texte rudimentaire s’était formé. » (Ibid., p. 116)
Dans le récit de Narby, une scène analogue était racontée, celle de la stupeur de l’anthropologue découvrant une photographie dans La voie du sacré de Huxley : « d’une peinture du serpent d’Arc-en ciel réalisée sur une paroi rocheuse. Je regardai l’image de près et vis deux choses : des espèces de chromosomes, en forme de « u » renversé, tout autour du serpent, et en-dessous, une sorte d’échelle double. » (LSP, p. 84). Le texte de Dantec se fait également réécriture de l’expérience personnelle avec l’ayahuasca que Narby avait racontée :
Je me suis retrouvé entouré par ce que je percevais comme deux gigantesques boas de taille approximative de soixante-dix centimètres de haut et de douze à quinze mètres de long. J’étais totalement terrifié. Ces serpents énormes sont là, j’ai mes yeux fermés et je vois un monde spectaculaire de lumières brillantes, et au milieu des pensées brouillonnnes, les serpents commencent à me parler sans mots. (Ibid., p. 14)
Dans Babylon Babies, la protagoniste vit dans une hallucination une scène analogue, que Dantec réécrit ainsi : « […] deux serpents de cristal vivants s’enroulant sur eux-mêmes […] comme une paire de reptiles jumeaux en pleine mue, flottant au-dessus de la tombe. Elles tenaient des petits serpents d’or dans leurs mains, des ondes enroulées sur elles-mêmes tournoyaient autour de leurs têtes, en anneaux de Möbius quasi vivants. » (BB, p. 364-365). Les ophidiens ribeonucleiques sont aussi des avatars de l’ange de l’annonciation pour la protagoniste appelée Marie et mère porteuse d’enfants mutants dans une intertextualité entre Saintes Ecritures et science-fiction postmoderne : « Un messager ARN viendra de temps en temps te visiter. » (Ibid., p. 365).
Dans l’île de l’utopie, « l’îlot expérimental » (Ibid., p . 713) en plein Pacifique peuplé en partie de d’Amazoniens volontaires, se trouve transplanté le monde de Narby : « Ici, nous cultivons l’ayahuasca et toute une panoplie d’hallucinogènes. » (Ibid., p. 638). La rencontre avec Narby à Cavaillon fin janvier 2000 incite Dantec à faire un voyage en Amazonie, mais ce dessein semble avoir été abandonné. Apparemment Dantec ne s’est jamais encore rendu sur place, du moins n’en a-t-il pas fait état ultérieurement.
Ce jour-là, face à Jeremy qui m’exposait calmement ses aventures dans l’Amazonie chamanique, il me devint évident que mon destin venait à nouveau de percuter un météore de pure transfiguration. Désormais, mes pas me conduiraient directement au cœur de l’Amazonie péruvienne sur ses traces, à la rencontre de l’Ayahuasca. Rendez-vous fut pris pour septembre de cette année. (LCG, p. 66)
Le rôle essentiel de la drogue dans le processus de connaissance et de communicaton dans Babylon Babies, s’il est une immédiate reprise du rôle joué par l’ayahuasca chez Narby, entre dans une conception plus ample de l’auteur psychonaute confirmé : celle des « technologies neurotropiques, autrement dit des drogues » (PP, p. 140). La description d’une situation du futur dans le même texte de 1997, « La fiction comme laboratoire anthropologique expérimental » correspond exactement à la situation décrite dans Babylon Babies, à l’utilisation de drogues – la culture personnelle de Dantec est liée au LSD – « afin de permettre la neuronexion entre cerveaux et intelligences artificielles » (Ibid.). Chez Narby, le processus de connaissance est lié à la connexion entre le cerveau du chaman et l’ADN par le biais du psychotrope naturel. Chez Dantec, le processus est traduit en termes scientifiques et de science-fiction, la neuroconnexion s’établissant entre le cerveau et non pas l’intelligence de la nature – terme cher à Narby – mais l’intelligence artificielle.
L’un des indices de l’émission des biophotons dans le roman se manifeste dans le regard de Marie, animé d’« une lueur qui vibrait aux limites de l’ultraviolet, non pas sous l’effet du tube cathodique, mais de l’état mutagène de l’ensemble de son ADN » (BB, p. 315). Ce texte fait penser aux expériences menées par Edouardo Kac au sein du laboratoire français de l’INRA du professeur Houdebine, qui mena à la création d’Alba, alias GFP Bunny, le lapin né en janvier 2000, dont certains élément du corps deviennent fluorescents quand ils sont soumis à des rayons ultra-violets [57]. L’« aspect luminescent » (LSP, p. 126), l’« état de lumières vives et colorées » (ibid.) est aussi la marque des serpents dans l’hallucination de Narby. Il est possible de suivre à la trace la lumière des biophotons dans Babylon Babies. Ainsi, la machine neuromatrice « détectait depuis quelques jours cette radiation de biophotons en provenance de l’ADN de Marie, mais aussi de celui des bébés, le scanner était formel : en plein dans la fréquence de l’ultraviolet » (BB, p. 642). Or cette radiation est la signature du « Serpent cosmique » : « […] Pour Joe-Jane, le Serpent cosmique correspondait à un état mutant du code génétique, dans lequel les informations stockées dans les milliards de gène accédaient directement au neocortex. » (ibid., p. 643). Pour le chamane amazonien, le serpent cosmique est la médiation qui permet l’accès à la connaissance donnée par les plantes. Pour Narby, le serpent cosmique est une métaphore de l’ADN. Dans Babylon Babies, l’expression « serpent cosmique » désigne un nouveau phénomène où le cerveau a directement accès à la connaissance des informations contenues dans l’ADN, sans avoir à passer par l’hallucination de l’ayahuasca. Ce déréglement signale l’émergence du premier phénomène posthumain. Une autre version encore de la vision chamanique amazonienne se retrouve chez Dantec, qui la transforme non sans humour cette fois en vision amérindienne canadienne : huronne. La transposition est d’abord celle qu’effectue Dantec de la mythologie amazonienne dans la mythologie huronne – exercice de style structural – qui repose sur la sauvegarde du même principe du double pour signifier l’ADN : double serpent/ double éclair/ double hélice : « D’abord apparaît le Faucon-Messager de la mythologie huronne. Il tient dans ses serres un faisceau d’éclairs, à la mode militaire américaine. Ce signe chamanique est très puissant, d’après le centre ADN le double éclair est une transcription directe de la double hélice, cela signifie qu’il est d’une importance cruciale pour toi et la survie du programme anthropique. » (BB, p. 529) Enfin, une véritable leçon sur la thèse de Narby est donnée dans le récit, qui a trait au mythe récurrent dans les cultures chamaniques – même celles où les serpents n’existent pas – d’un « animal monstrueux en forme de double serpent, émettant une très violente lumière » (Ibid., p. 554). Les questions présentées rhétoriquement par le savant retrouvent l’ordre de celles auxquelles Narby s’est confronté : « Pour être clair, exemple : […] les Indiens Ahayuasqueros de l’Amazonie péruvienne […] comment connaissent-ils aussi finement les délicates interactions entre plusieurs pharmacopées très complexes, notamment dans le domaine des plantes psychotropes ? […] La description de la radiation qui émane du Serpent Cosmique est lumineuse, si je puis dire ; il s’agit bien d’une fréquence bleue à dominante ultraviolette se situant dans la plage des biophotons […] Le Serpent Cosmique est double, comme je vous le disais. Les descriptions les plus précises coïncident toutes : il a la forme d’une double hélice enroulée sur elle-même. […] Vous avez compris. Il s’agit très exactement de la structure de l’ADN. » (Ibid., p. 554) Et le personnage termine cette présentation en nommant explicitement l’auteur deces thèses : « C’est précisément ce que Jeremy Narby a découvert dans les années quatre-vingt dix, mais comme il n’était qu’un “vulgaire“ anthropologue, aucun biologiste digne de ce nom n’a accordé foi à ses élucubrations » (Ibid., p. 556). Le roman met en scène un romancier de science-fiction, double de l’auteur, Dantzik, ce qui permet des mises en abyme ironiques sur son propre compte. Liber mundi est le titre du livre que Dantec voulait écrire sur sa poétique de l’ADN : « C’est pour ça que les métaphores de notre ami Dantzik ne sont que des métaphores d’écrivain, Liber Mundi, la puissance du Verbe, tout ça on est d’accord, mais il faut bien comprendre que nos cerveaux sont au livre ce que le cortex des jumelles Zorn est au méganet mondial. » (Ibid., p..614). Le serpent cosmique est de 1995. « La fiction comme laboratoire », premier texte de Dantec, où se trouvent des allusions à Narby, date de 1997, Babylon Babies de 1999, Le laboratoire de catastrophe générale, où Dantec parle de sa rencontre avec Narby, paraît en 2001. L’effet Narby continue. Dans la dernière parution de Dantec à ce jour, Comme le fantôme d’un jazzman dans la station Mir en déroute (2009), on peut lire : « […] La double hélice du code génétique, c’est ça ? […] – Alors c’est ça. Lui il appelle ça le Serpent du Verbe. Il est le code cosmique, il mute tout le temps, il peut prendre une infinité de formes…Par exemple, la Séquence du Dragon est une transcription particulière de ce code, une transcription verbale, symbolique et digitale, ce sont ses propres mots, quelque chose qui court-circuite les réseaux neuroniques de celui pour lequel c’est codé. » [58] À propos du Serpent cosmique de Narby, Dantec parlait de son intuition confirmée de la coexistence métamorphique de l’ADN et du cerveau. Babylon Babies en donnait une version high tech. Le laboratoire de catastrophe générale, une version conceptuelle : « L’ADN est donc une plate-forme hautement mutable, dont le « sens » ne peut être donné que par sa coextension métamorphique à travers le cerveau-conscience avec lequel il établit les hyperrelations paradoxales […] » (LCG, p. 524). Expérience de pensée et fantasme vitaliste, la notion de coexistence métamorphique se situe à la convergence des domaines les plus en pointe de la recherche contemporaine, neurosciences, génétique et nanotechnologies. Elle entre aussi dans le grand réseau de la fréquence « méta » chez Dantec : métahumain bien entendu, mais aussi métaforme, métafiction, métacrise, metakrisis, métaprogramme, métamorphique. Metaverse a été la première dénomination du monde virtuel. L’onde méta de la pensée Dantec traversera-t-elle les concepts pour créer du devenir ?
Hervé-Pierre LAMBERT : Dantec et Narby : Sciences, épistémologie et fiction
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE – (Hiver 2010)
[1] L’on désignera dorénavant par des abréviations les livres les plus cités : BB : Babylon Babies, Paris, Gallimard, folio SF, 1999. ThOp : Le théâtre des opérations, Journal métaphysique et polémique, 1999, Paris, Gallimard [Folio, 2000]. ThOp : Laboratoire de catastrophe générale, Journal métaphysique et polémique 2000-2001, Paris, Gallimard, folio, 2001 : LCG ; American Black Box, Le théâtre des opérations, 2002-2006, LGF, coll. Le Livre de Poche, 2009. VV : Villa Vortex, Paris, Gallimard, La Noire, 2003. PP : Périphérique, Paris, Flammarion, 2003. LSP : Le serpent cosmique. Les intiales M.G.D. désigneront Maurice G. Dantec et J.B., Jeremy Narby. Ouvrages de Narby discutés : Intelligence dans la nature, Buchet-Chastel, Paris, 2005 (trad. Intelligence in the Nature, Tarcher, N.Y. 2005) ; Narby Jeremy et Huxley Francis, Chamanes au fil du temps, Paris, Albin Michel, 2002 ; Narby Jeremy, Dubochet, Jacques, Kiefer Bertrand, L’ADN devant le souverain : Science, démocratie et génie génétique, Genève, Georg éditeurs, 1997 ; Narby Jeremy, Le serpent cosmique : L’ADN et les origines du savoir, Genève, Georg éditeurs, 1995 (trad. The Cosmic Serpent : DNA and the Origins of Knowledge, Tarcher, 1999) ; Narby Jeremy, Amazonie, l’espoir est indien, Paris, Favre, 1990 ; Narby Jeremy, Beauclerck John, Townsend, Janet, Indigenous Peoples : A Fieldguide For Development, Oxford, Oxfam, 1988.
[2] « La fiction comme laboratoire anthropologique expérimental », PP, p. 135. (initialement paru in Les Temps Modernes, N° spécial Roman Noir, n°595, août-septembre-octobre 1997).
[3] « La fiction comme laboratoire anthropologique expérimental », PP, p. 139.
[4] « La littérature comme machine de troisième espèce », PP, p. 119.
[5] Claude Debru, Le Possible et les biotechnologies : essai de philosophie dans les sciences, Paris, PUF, 2003, p. 2.
[6] « La fiction comme laboratoire anthropologique expérimental », PP, p. 137.
[7] Voir Dominique Lecourt, Humain, post-humain, Paris, PUF, 2003.
[8] Hans Jonas, Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, trad. J. Greisch, Paris, Flammarion, 1990 (éd. originale 1979).
[9] Jürgen Habermas, L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral ?, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 2002.
[10] Peter Sloterdijk, Regeln für den Menschenpark, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999. Trad. fr. Règles pour le parc humain, trad. O. Mannoni, Paris, Mille et une Nuits, 2000.
[11] Yves Michaud, Humain, Inhumain, Trop Humain : « Réflexions sur les biotechnologies, la vie et la conservation de soi à partir de l’œuvre de Peter Sloterdijk », Paris, Flammarion, 2006.
[12] Acronyme américain pour les « Converging technologies », les Technologies Convergentes
[13] Jean-Pierre Dupuy, « Le problème théologico-scientifique et la responsabilité de la science », 2004. Consulté sur http://www.formes-symboliques.org/a…
[14] Basic Books, New York, 2003. Notre traduction : « Notre dernière heure. L’avertissement d’un scientifique : comment la terreur, l’erreur et la catastrophe écologique menacent l’avenir de l’humanité dans ce siècle — sur la Terre et au-delà ». Dupuy fait remarquer que la première version anglaise avait un titre plus exact : « Our Last Century », notre dernier siècle.
[15] Voir Jean-Pierre Dupuy, « De la limite suprême : l’autodestruction de l’humanité », in Les limites de l’humain, Rencontres internationales de Genève, XXXIX, 2003. Lausanne, L’Âge d’Homme, 2004.
[16] Marina Maestrutti , « La singularité technologique : un chemin vers le posthumain ? », Vivant, L’actualité des sciences et débats sur le vivant. Sur http://www.vivantinfo.com/index.php…. Consulté le 2 mars 2006.
[17] Joseph Fahey, « Nous, posthumains : discours du corps futur », Critique n° 709-710 : Mutants, juin-juillet 2000, p. 542. « Automates intelligents » est un site remarqué d’informations en langue française sur les questions du posthumain.
[18] La liste ne saurait être exhaustive. Le choix s’est fait à partir de l’importance actuellement reconnue de ces œuvres.
[19] Michel Houellebecq, La possibilité d’une île, Paris, Fayard, 2005, p. 446.
[20] Yves Michaud, Humain, Inhumain, Trop Humain, op. cit., p.123.
[21] Ibid., p. 146.
[22] Maurice G. Dantec, Cosmos Incorporated, Paris, Albin Michel, 2005., p. 98. D’autres titres contiennent des d’allusions au groupe de musique électronique Kraftwerk et à son « Radioactivité » tandis que « Contraction du domaine de la lutte » est un jeu de mots, dans American Black Box, sur le titre du premier roman de Houellebecq.
[23] Marina Maestrutti, « Le pouvoir de la fiction, ou comment les nanotechnologies sont entrées en débat », Vivant, L’actualité des sciences et débats sur le vivant, http://www.vivantinfo.com/index. Consulté le 02/03/2006.
[24] Après avoir été longtemps traduit par falsifiabilité, le concept popperien de falsification est maintenant traduit par réfutation ou réfutabilité. Dantec utilise le terme falsifiabilité.
[25] Voir Hervé-Pierre Lambert, « Le laboratoire comme atelier d’artiste » in « Le lieu », Recherches en esthétique, (dir) Dominique Berthet, Revue du C.E.R.E.A.P, n°13, décembre 2007.
[26] PP, « La littérature comme machine de troisième espèce » , p. 113.
[27] Narby récuse ce terme de « junk » dans lequel il voit un réflexe péjoratif vers quelque chose d’inconnu et lui substitue le terme de « ADN mystère », in LSP, p. 138.
[28] Si la trace de Butler reste non explicitée , en revanche, la boîte à outils contient le nom de Korzybsky qui fait l’objet de fréquentes références dans les essais et dans la fiction, notamment dans Villa vortex. À vrai dire, la référence à Alfred Korzybsky concerne surtout l’argument de la diffférence entre la carte et le territoire. Dantec ne manque pas de rappeller également la fortune des écrits de Korzybsky dans la science-fiction avec le monde des  de van Vogt.
[29] Voir Hervé-Pierre Lambert : « Les Manifestes dans le courant de l’imaginaire posthumain », Revue Itinéraires LTC (Littérature, Textes, Cultures) : « L’art qui manifeste », Centre d’Etude des Nouveaux Espaces Littéraires, Paris13 – Paris Nord, LCG, 2008. Voir également « L’art posthumain », in Rencontres, Actes du colloque, Berthet D. (éd), Paris, L’Harmattan, 2009.
[30] Marcin Sobieszczanski, « Problèmes philosophiques et esthétiques soulevés par les prothèses neurosensorielles », Archée, novembre 2009. Consulté sur http://archee.qc.ca/
[31] Voir B. Sterling, Neuromachine : The Cyberpunk Anthology, Arbor House 1987
[32] Il n’est d’ailleurs pas le seul. Jean-Michel Truong a écrit Le successeur de Pierre, qui mélange gnose et posthumain. Le catholicisme dont finit par se réclamer l’auteur n’est pas le sujet ici. Il suffira de rappeler que, pour l’auteur, conversion signifie subversion.
[33] Carlos Castaneda, L’herbe du diable et la petite fumée (pour la traduction française : Paris, Le soleil noir, 1972). Du même auteur, Voyage à Ixtlan (pour la traduction française : Paris, Galimard, 1974).
[34] Frank Bruce Lamb, Wizard of the Upper Amazon : The Story of Manuel Córdova Rios, Boston, Houghton Miffin Company, 1971.
[35] Michael Harrner (ed), Hallucinogens and Shamanism, Oxford, Oxford University Press, 1973. Du même auteur, voir The way of Shaman, New York, Harper and Row, 1980.
[36] Terence Mc Kenna, Food of the Gods, New York, Bantam Books, 1992.
[37] Voir l’ouvrage de Robert Gordon Wasson, Stella Kramrish, Jonathan Ott, Persephone’s Quest : entheogens and the origins of religion, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1986.
[38] Allan Ginsberg, William Burroughs, Yage Letters, San Francisco, Cty Lights Books, 1971.
[39] Marlene Dobkin de Rios, Visionary Vine : Hallucinogen Healing in the Peruvian Amazon, Illinois, Waveland Press, 1972.
[40] R. E. Schultes, R. F. Raffauf, Vine of the Soul : Medicine Men, their Plants and Rituals in the Colombian Amazonia, Oracle, Synergetic Press, 1992.
[41] Terence et Dennis McKenna, The invisible Landscape : Mind, Hallucinogens and the I Ching, NewYork, Seabury Press, 1975.
[42] La composition chimique de l’ayahuasca a été étudiée à partir des années cinquante et établie par Claudine Friedberg et Jacques Poisson dès 1965. Narby, pour l’histoire de la composition chimique, se réfère aux travaux de Schultes et Hofmann en 1979.
[43] Frédérick Bois-Mariage, « Ayahuasca : une synthèse interdisciplinaire », Psychotropes, vol. 8, n°1, 2002, p. 79-113.
[44] Cité par J. Narby, Le serpent cosmique, p. 17.
[45] Jeremy Narby, Intelligence dans la nature, op. cit., p. 13.
[46] Voir Popp, Fritz-Albert, Qiao Gu, Ke-Hsueh Li, ”Biophoton emission : experimental background and theoretical approaches”, Modern Physics Letters B 8 (21-22):1269-1296r : 1994.
[47] (Ibid., p. 126.)
[48] Ibid., p. 127.
[49] Ibid., p. 127.
[50] Gregory Escande, « L’usage de psychotropes : entre sauvagerie et enculturation », Psychotropes, Paris, Vol. 7, 2001/1.
[51] Roy Ascott, “When the Jaguar lies down with the Lamb : Speculations on the Post-Biological Culture”, Artnodes, CAiiA-STAR Symposium : « Extreme parameters. New dimensions of interactivity » (11-12 july, 2001). Voir : http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art…, nov. 2001 [Notre traduction] : “I think it is worth reciting this account of Narby’s work because it amplifies the intuition that there is much to be gained in both biological sciences and the arts from research which seeks correspondences and collaborations between the two technologies of machines and plants within the natrificial space of the Three VRs, virtual, validated and vegetal. In this new knowledge terrain, the planet shrinks to make the Brazilian rain forest contiguous with Silicon Valley”. À l’opposé, sans vouloir entrer dans les controverses et les détails des critiques faites à l’hypothèse, il peut paraître utile de signaler au moins une réaction venant du domaine des neurosciences. Depuis les études pionnières de Heinrich Klüver sur les motifs géométriques des hallucinations, se sont aussi développés les travaux mathématiques de J. Cowan sur la géométrie des images hallucinatoires comme effet du cortex visuel. Les visions des chamanes constitueraient un phénomène relevant d’une étude interdisciplinaire où jouent notamment les mathématiques et la neurologie. Voir sur la question Bressloff P. C., Cowan J. D., Golubitsky M., Thomas P. J., Wiener M. C. : « Geometric visual Hallucinations, Euclidean symmetry and the functional architecture of striate cortex”, Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci., 2001, Mar 29 ; 356 (1407) :299-330. Voir également Ermentrout G. B., Cowan J.D., “A Mathematical Theory of visual hallucination patterns”, Biol Cybern., 1979 Oct, 34 (3):137-50.
[52] Frédéric Bois-Mariage, « Ayahuasca : une synthèse interdisciplinaire », Psychotropes, Paris, 2002/1 , op. cit., p. 84.
[53] Louise Poissant, Ernestine Daubner, Art et biotechnologies, coll Esthétique, Université de Saint-Etienne, 2005. Ce livre est en partie accessible sur books.google.com
[54] « La fiction comme laboratoire anthropologique expérimental », 1997
[55] Voir les développements sur la spirale du langage : « la spirale du langage, c’est la danse derviche de l’esprit » et celle de la pensée, LCG, p. 424-425.
[56] http://www.ekac.org/genfren.html Voir aussi : http://www.fondation-langlois.org/e…
[57] Voir http://www.ekac.org/genfren.html. Voir également H. P. Lambert, « L’art posthumain », Rencontres, 2009, op. cit.
[58] M. Dantec, Comme le fantôme d’un jazzman, Paris, Albin Michel, 2009, p. 91.
Les prothèses de Mnémosyne
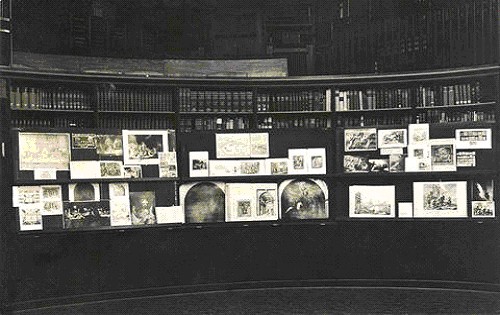
Figure 1 : Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne (1927-1929). Londres, Warburg Archive.
Toute la mémoire du monde
Au livre I de L’Ève future, Villiers de l’Isle-Adam fait s’exclamer ainsi le personnage de Thomas Edison, peu avant que l’inventeur ne se lance dans la fabrication de l’andréide « Hadaly » :
C’en est fait ! nous ne verrons plus, nous ne reconnaîtrons jamais, en leurs effigies, les choses et les gens d’autrefois, sauf dans le cas où l’Homme découvrirait le moyen de résorber, soit par l’électricité, soit par un agent plus subtil, la réverbération interastrale et perpétuelle de tout ce qui passe […], l’éternelle réfraction interstellaire de toutes choses.[1]
À la déploration de la perte se mêle l’ambition d’une conservation sans limite, (reprise par Alain Resnais dans son magnifique documentaire sur la Bibliothèque nationale[2]), au constat irrévocable de la disparition d’un passé glorieux répond malgré tout la nécessité d’un travail de mémoire. Comme le souligne Edison, ce rêve d’impossible totalité ne peut advenir qu’à la seule condition d’en passer par des moyens techniques. Mélancolie contre « machination », authenticité de l’expérience vécue contre artificialité de la remémoration, fugacité de l’instant contre labeur « en-duré » du souvenir : Villiers de l’Isle-Adam synthétise en ce court extrait d’un impressionnant monologue l’ensemble des contradictions habituellement nouées par toute réflexion sur les conditions matérielles d’archivage de la pensée. Que l’on se réfère à la théorie du pharmakon platonicien ou à l’actuelle numérisation de nos fonds patrimoniaux, en passant par les analyses de Walter Benjamin sur le « déclin de l’aura » et la nouvelle « transmissibilité » des œuvres d’art à l’époque de leur reproductibilité mécanique, l’héritage du passé requiert toujours la médiation d’un appareillage :
De jour en jour s’affirme plus impérieusement le besoin de posséder l’objet d’aussi près que possible, dans l’image ou plutôt dans la reproduction. Et il est évident que la reproduction […] se distingue de l’image. En celle-ci l’unicité et la durée sont aussi étroitement liées qu’en celle-là la fugacité et la reproductibilité. Dégager l’objet de son enveloppe, détruire son aura, c’est la marque d’une perception qui a poussé le sens de tout ce qui est identique dans le monde au point qu’elle parvient même, au moyen de la reproduction, à trouver de l’identité dans ce qui est unique.[3]
Sous l’égide conjointe du « Sorcier de Menlo Park » fabulé à la fin du XIXe siècle par Villiers de l’Isle-Adam et de ce premier penseur de l’appareil photographique qu’est Walter Benjamin, on tâchera d’exposer certains des liens qui unissent la figure de Mnémosyne à ses « prothèses ». Partant de la lecture d’un étonnant texte de Jean-François Lyotard, daté de 1986 (100 ans après la publication du roman de Villiers[4]) et énigmatiquement intitulé « Si l’on peut penser sans corps », on examinera la relation établie par Lyotard entre les « machines de mémoire » et la « mort solaire » de toute chose, afin d’aborder la manière dont ces affinités entre la mémoire et la technique qui la rend possible affectent la création littéraire, tout particulièrement à l’aube du XXIe siècle.
I – Penser sans corps ?
L’impropre de l’homme
« Si l’on peut penser sans corps » est un texte écrit par Jean-François Lyotard à partir de l’enregistrement d’une séance de séminaire tenu à l’Université de Siegen en novembre 1986. Il s’agit donc d’une communication volontairement adressée. Reprise deux ans plus tard dans le recueil L’Inhumain, celle-ci conserve une forme très oralisée, une tonalité générale d’injonction ainsi qu’une « disposition » rhétorique extrêmement rigoureuse. Premier texte d’un ouvrage réunissant près d’une vingtaine de conférences et d’exposés de commande à propos du temps, de la mémoire et du vivant, « Si l’on peut penser sans corps » semble ainsi donner le ton d’une inquiétude ou d’un soupçon porté sur « le »propre’’ de l’homme » :
Et si les humains, au sens de l’humanisme, étaient en train, contraints, de devenir inhumains […] ? Et si le »propre’’ de l’homme était qu’il est habité par de l’inhumain ?[5]
Revendiquant d’emblée – et en termes clairement psychanalytiques – la nécessité d’affronter cette « angoisse » à l’égard du « plus familier des hôtes »[6], Lyotard commence par examiner l’Autre de l’humain sous son aspect le plus radicalement étranger : celui de la machine. Pour traiter ce rapport « unheimlich » de l’humain à l’inorganique, le texte « Si l’on peut penser sans corps » – dont il faut souligner l’ambiguité du titre, au croisement de l’interrogation (« est-il seulement possible de penser sans corps ? ») et de la proposition conditionnelle (« Si l’on peut penser sans corps, alors… ») –, s’organise en deux temps, autour de deux morceaux d’éloquence portés par deux orateurs anonymes, respectivement dénommés « Lui » (première partie du texte) et « Elle » (seconde partie du texte et conclusion). Les deux discours se répondent point par point, à l’argument et à la formule près : le « vous, philosophes » lancé en guise d’exorde par celui qu’on suppose être la figure paradigmatique du Technicien est ainsi repris par « Elle » au tout début de son plaidoyer : « Il y aurait là de quoi nous satisfaire, nous philosophes […] »[7].
C’est dans le cadre de cet échange polémique entre Technique et Philosophie que se déploie la réflexion de Lyotard sur l’absolue nécessité des appareils techniques à la survie du vivant en même temps que sur leur paradoxale incapacité à toucher au « propre » de l’humain ou, autrement dit, sur l’inaptitude des machines à penser – puisque pour Lyotard, la pensée constitue une expérience sensible et « non machinable », défiant dans l’absolu toute « programmation »[8].
Vivants et machines face à la « mort solaire »
Après avoir dénoncé en exorde l’habituel mépris des philosophes à l’égard de la technique (« Vous, philosophes, vous posez des questions sans réponse et qui doivent le rester pour mériter le nom de philosophiques. Une question résolue, elle n’est selon vous que technique »[9]), le premier des rhéteurs présente son argument. À la Philosophie qui prétend pouvoir régler par elle-même le problème de la finitude, le Technicien objecte que seule la technique, parce qu’elle extériorise la mémoire sur des supports, parce qu’elle programme des banques illimitées de données, parce qu’elle « assure [ainsi] au software [le langage humain] un hardware indépendant des conditions de vie terrestre », est capable de répondre à l’un des plus importants défis de la philosophie : celui de la transmission et de la survie de la pensée au-delà de la « fin ».
Vous savez, la technique n’est pas une invention des hommes. Plutôt l’inverse. Les anthropologues et les biologistes admettent que l’organisme vivant même simple, l’infusoire, la petite algue synthétisée au bord des flaques il y a quelques millions d’années par la lumière, est déjà un dispositif technique. Est technique n’importe quel système matériel qui filtre l’information utile à sa survie, la mémorise et la traite, et qui induit, à partir de l’instance régulatrice, des conduites, c’est-à-dire des interventions sur son environnement, qui assurent au moins sa perpétuation. [10]
Lyotard appuie cette thèse technologiste sur une vision tout à fait apocalyptique de la « mort solaire », désastre cosmique qui fait signe en direction de toute une tradition cinématographique – que l’on se souvienne de l’explosion fatale sur laquelle se conclut le film Kiss Me Deadly de Robert Aldrich[11] ou du très bel essai de Chris Marker, Sans Soleil[12] :
En attendant, le soleil vieillit. Il explosera dans 4,5 milliards d’années […]. La terre disparaissant, la pensée cessera, laissant cette disparition absolument impensée. C’est l’horizon même qui s’anéantira et votre transcendance dans l’immanence. La mort, si comme limite, elle est par excellence ce qui se dérobe et se diffère, et par là, ce avec quoi la pensée a affaire constitutivement, cette mort-là n’est encore que la vie de l’esprit. Mais la mort du soleil est la mort de l’esprit, parce qu’il est la mort de la mort comme vie de l’esprit. Il n’y a pas de relève, ni de différer, si rien ne survit.[13]

Figure 2 : Robert Aldrich, Kiss Me Deadly (1955).
C’est tout l’enjeu du témoignage que cristallise ainsi Lyotard, au terme d’un XXe siècle qui combine de façon inédite le plus grand anéantissement mémoriel que l’humanité ait jamais connu et la plus grande augmentation des capacités de stockage des données. À l’aune de ce paradoxe contemporain (oubli génocidaire et vertigineuse hypermnésie), comment la « vie de l’esprit », pour reprendre la belle expression de Hannah Arendt, pourrait-elle résister à l’explosion programmée du soleil ? Davantage, comment pourrait-elle attester de cette inéluctable disparation ? Comment garder une trace de la pire des catastrophes, celle que représente « la mort des pensées inséparables du corps », autrement qu’en ayant recours à des appareils techniques d’enregistrement ?
Après la mort du soleil, il n’y aura pas de pensée pour savoir que c’était la mort. Telle est à mon sens la seule question sérieuse posée aux humains d’aujourd’hui. Auprès d’elle, tout me paraît futile […]. Le reste qui reste après l’explosion solaire, il n’y aura pas un humain, un vivant, terrien, intelligent, sensible et sentimental, qui puisse en témoigner, puisqu’il aura brûlé avec son horizon de terre.[14]
Le Technicien finit ainsi par focaliser l’objet de toute recherche scientifique (« depuis la diététique, la neurophysiologie, la génétique et le tissu de synthèse, jusqu’à la physique des corpuscules, l’astrophysique, l’informatique et le nucléaire ») sur un unique enjeu : « simuler les conditions de la vie et de la pensée de telle sorte qu’une pensée reste matériellement possible après le changement d’état de la matière qu’est le désastre. »[15]
La deuxième partie du texte de Lyotard met en scène la réponse de la Philosophie. Tout en admettant ses objections, celle-ci rappelle au Technicien l’« imbrication du penser et du souffrir »[16] qui s’opère en chaque corps humain et qui fait intrinsèquement défaut aux machines : « L’horizon de la pensée, son orientation, la limite illimitée et la fin sans la fin qu’elle suppose, c’est à l’expérience corporelle, sensible, sentimentale et cognitive d’un vivant très sophistiqué mais terrien que la pensée les emprunte et les doit. »[17] Affirmant ainsi la prééminence « inépuisable »[18] de l’organique, Lyotard en vient à remettre en cause la pertinence des aide-mémoires mis à notre disposition par la technologie moderne : comment le hardware, la machine, l’inorganique par excellence, pourraient-ils en effet répondre au défi de l’é-motion vers le « non-encore-pensé » et expérimenter la « souffrance du temps » qui caractérise la « vraie » pensée ?
La douleur de penser n’est pas un symptôme, qui viendrait d’ailleurs s’inscrire sur l’esprit à la place de son lieu véritable. Elle est la pensée elle-même en tant qu’elle se résout à l’irrésolution, décide d’être patiente, et veut ne pas vouloir, veut, justement, ne pas vouloir dire à la place de ce qui doit être signifié. Révérence faite à ce devoir, qui n’est pas encore nommé. Ce devoir n’est peut-être pas une dette, c’est peut-être seulement le mode selon quoi ce qui n’est pas encore le mot, la phrase, la couleur viendra. De sorte que la souffrance de penser est une souffrance du temps, de l’événement. J’abrège : vos machines à représenter, à penser, souffriront-elles ? Que peut être le futur pour elles, qui ne sont que mémoires ? [19]
Avant d’en venir plus précisément à la manière dont certaines œuvres littéraires contemporaines ont choisi de répondre à ces questions philosophiques, posées par Lyotard en guise de péroraison avec un usage tout rhétorique du pathos et des apostrophes[20], il est essentiel de revenir en détail sur l’ambivalente conception de la mémoire qui sous-tend ce texte.
Hériter du futur : une double définition de la mémoire
Dans l’extrait précédent, la mémoire nous est présentée comme un attribut exclusif des machines (« vos machines […], que peut être le futur pour elles, qui ne sont que mémoires ? »), comme le pouvoir absolu, quoique restreint, d’un archivage qui consisterait à « décrire la pensée sous la forme d’une sélection des données et de leur articulation »[21]. À l’exact opposé de cette première définition de la mémoire – qui n’est pas sans rappeler celle que donne Platon de l’hypomnésis et des hypomnèmata dans le Phèdre : non pas « la » mémoire mais les signes et les supports extérieurs de la remémoration[22] –, la notion de témoignage, en tant que mémoire vive, urgente et sensible, s’impose comme l’unique moyen de résister à la mort solaire. Comment articuler ces deux visions antinomiques de Mnémosyne ? Comment concilier cette mémoire « morte », machinale et machinique, répétitive et automatique, « sans affect ni auto-affection » des appareils techniques et cette autre mémoire organique, fragile et essentiellement « humaine », de la catastrophe ?
Le problème posé par leur agencement détermine l’ensemble de « Si l’on peut penser sans corps » ainsi qu’il oriente toute la réflexion « grammatologique » de Derrida. Dans « La pharmacie de Platon », ce dernier a fort bien montré que l’écriture-pharmakon dont le Phèdre instruit le procès est beaucoup plus qu’un simple accessoire ou « excédent » de la mémoire vive (mnêmê). Elle remet profondément en cause la hiérarchisation axiologique qui fonde l’épistémè occidentale des rapports entre tekhnè et écriture, machine et pensée, organique et inorganique : la mnêmê intériorisante, capable de répéter l’Idée (eidos) et d’accéder à la connaissance authentique grâce à l’anamnèse, se trouve « engourdie » et « supplantée » par l’hypomnésis, mémoire secondaire qui ne peut que s’aider de l’artifice des empreintes (tupoi) et des archives[23]. En brouillant les frontières qui séparent habituellement le dedans du dehors, la vie de la mort, l’écriture-pharmakon révèle la nécessaire interdépendance des deux mémoires :
Si le pharmakon est « ambivalent », c’est donc bien pour constituer le milieu dans lequel s’opposent les opposés, le mouvement et le jeu qui les rapportent l’un à l’autre, les renverse et les fait passer l’un dans l’autre (âme/corps, bien/mal, dedans/dehors, mémoire/oubli, parole/écriture, etc.) […]. Le pharmakon est le mouvement, le lieu et le jeu (la production de) la différence. Il est la différance de la différence.[24]
De même que tout désir de conservation est intimement lié à une pulsion inverse (la menaçante et destructrice « anarchive »[25]), Derrida insiste sur le fait que la conjonction entre mnêmê et hypomnésis est l’ultime condition de saisie de l’événement. Penser cette contradiction ou, plus précisément, cette hybridation, telle est la tâche « monstrueuse » que Derrida fixe à la philosophie :
Pourrons-nous un jour, et d’un seul mouvement, adjointer une pensée de l’événement avec la pensée de la machine ? Pourrons-nous penser, d’un seul et même coup et ce qui arrive (on nomme cela un événement), et, d’autre part, la programmation calculable d’une répétition automatique (on nomme cela une machine) ? Il faudrait alors dans l’avenir (mais il n’y aura d’avenir qu’à cette condition), penser et l’événement et la machine comme deux concepts compatibles, voire indissociables. [26]
Au terme de « Si l’on peut penser sans corps », Lyotard ne dit pas autre chose : ce qu’il nous faut arriver à concevoir, c’est un corps « impropre », un corps proprement inhumain, « à la fois »naturel’’ et artificiel »[27] – ce que Benjamin appelle quant à lui un corps « innervé »[28] par la technique et ce que Villiers invente précisément avec le personnage d’Hadaly.

Figure 3 : Fritz Lang, Metropolis (1927).
Pour enfin braver la mort solaire, nous aurions besoin d’un organisme qui soit à même de combiner le hardware imperturbable de la machine et le corps phénoménologique de la sensation, capable à la fois d’anticiper, de calculer et de « prévoir » comme le soutient Nietzsche[29] et de rester simultanément ouvert à « ce qui arrive », sensible au devenir, à l’inarchivé voire à l’inarchivable. La notion même de « prothèse » change alors de sens. Comme le souligne Bernard Stiegler, elle ne vient pas tant pallier un manque, combler une perte ou réparer une déficience de l’organisme que s’ajouter spatialement (« devant ») et temporellement (« déjà ») à ce qui est :
Par prothèse, nous entendrons toujours à la fois : posé devant, ou spatialisation (é-loignement), posé d’avance, déjà là (passé) et anticipation (prévision), c’est-à-dire temporalisation. La prothèse n’est pas un simple prolongement du corps humain, elle est la constitution de ce corps en tant »qu’humain’’. Elle n’est pas un »moyen’’ pour l’homme, mais sa fin […]. C’est le processus de l’anticipation lui-même qui s’affine et se complique avec la technique qui est ici le miroir de l’anticipation, lieu de son enregistrement et de son inscription en même temps que surface de son réfléchissement, de la réflexion qu’est le temps, comme si l’homme lisait et liait son avenir dans la technique.[30]
Seul un corps aussi étrange et composite, prothétique plutôt que prothétisé, serait ainsi capable de transformer la violente expérience du désastre (Erlebnis) en expérience de pensée (Erfahrung) et de faire de l’événement historiquement subi l’objet construit d’une possible transmission.
II – La littérature, un étrange corpus en mouvement
Corpus : repère dispersés, difficiles, lieux-dits incertains, plaques effacées en pays inconnu, itinéraire qui ne peut rien anticiper de son tracé dans les lieux étrangers. Écriture du corps : du pays étranger, de cet étrangement qu’est le pays.
Jean-Luc Nancy, Corpus.
L’attention portée à la démonstration rhétorique ainsi qu’à la structure dramaturgique de « Si l’on peut penser sans corps » n’a rien d’anodin. En effet, le texte de Lyotard illustre de façon exemplaire le mouvement « pharmacologique » par lequel le logos se trouve insidieusement contaminé par la fiction littéraire, comme infiltré et progressivement transplanté hors de son lieu philosophique habituel, dès qu’il s’agit de traiter des rapports entre la machine, la mémoire et le vivant[31].
L’hypothèse que l’on souhaiterait esquisser ici est la suivante : et si le corpus constitué par les œuvres littéraires était le lieu privilégié de cette fameuse « innervation » ? Et si la littérature, par son pouvoir d’hybridation formelle et sa plasticité linguistique, offrait un modèle essentiel de corps prothétique, protéiforme et ouvert, conjuguant les deux mémoires distinguées par Lyotard afin de « produire autant que d’enregistrer l’événement »[32] ?
Innervation par la science-fiction
De nombreuses pistes ont déjà été ouvertes. La fiction d’anticipation littéraire explore sans relâche cet inquiétant phénomène de « peuplement » entre ce que Deleuze et Guattari appellent également « deux états du vivant » :
Il devient indifférent de dire que les machines sont des organes, ou les organes, des machines […]. L’essentiel n’est pas dans le passage à l’infini lui-même, l’infinité composée des pièces de machine ou l’infinité temporelle des animalcules, mais plutôt dans ce qui affleure à la faveur de ce passage. Une fois défaite l’unité structurale de la machine, une fois déposée l’unité personnelle et spécifique du vivant, un lien direct apparaît entre la machine et le désir, la machine passe au cœur du désir, la machine est désirante et le désir, machiné […]. Bref, la vraie différence n’est pas entre la machine et le vivant, le vitalisme et le mécanisme, mais entre deux états de la machine qui sont aussi bien deux états du vivant.[33]
Outre L’Ève future, on se reportera bien sûr à toutes les œuvres affiliées à la tradition cyberpunk (John Brunner, Norman Spinrad, Lewis Shiner, Walter Jon Williams, Samuel Delany, James Flint, Neal Stephenson) fondée au début des années 1980 par William Gibson (Johnny Mnemonic, 1981 ; Neuromancer, 1984) et Bruce Sterling (Mirrorshades: A Cyberpunk Anthology, 1986), qui développent le thème de la mutuelle « complétion » du corps et des machines en manipulant la langue anglaise[34]. À l’appui de cet incessant travail d’innervation opéré par la science-fiction contemporaine, convoquons simplement les inquiets propos de Philip K. Dick, qui font de la machine le principal modèle épistémologique au miroir duquel interroger la spécificité de l’humain :
We humans, the warm-faced and tender, with thoughtful eyes — we are perhaps the true machines. And those objective constructs, the natural objects around us and especially the electronic hardware we build, the transmitters and microwave relay stations, the satellites, they may be cloaks for authentic living reality inasmuch as they may participate more fully and in a way obscured to us in the ultimate Mind. Perhaps we see not only a deforming veil, but backwards. Perhaps the closest approximation to truth would be to say: « Everything is equally alive, equally free, equally sentient, because everything is not alive or half-alive or dead, but rather lived through”.[35]
De nouveaux « dispositifs » de mémoire
À ces grandes références de la fiction d’anticipation qui exposent des corps pleinement innervés par la technique, il faut enfin ajouter un autre type d’œuvres littéraires qui réalisent cette interaction de façon certes moins explicite mais tout aussi efficace. Que l’on songe par exemple au vaste et monstrueux « Projet » de Jacques Roubaud (notamment à l’une de ses dernières résurgences : la version « mixte » du Projet que constitue La Bibliothèque de Warburg)[36], au vertigineux roman Austerlitz de W. G. Sebald[37], à l’étonnant laboratoire de J. G. Ballard : The Atrocity Exhibition (1969-1990)[38] ou encore à l’œuvre romanesque de l’argentin Ricardo Piglia, programmatiquement intitulée Respiration artificielle (1980)[39].
Sans entrer dans le détail des textes ni viser l’exhaustivité de la démonstration, on rappellera synthétiquement les grandes problématiques offertes par cet autre corpus d’étude. Le rapport de « peuplement » entre machine et vivant, mnêmê et hypomnésis, n’est plus donné à lire au travers des personnages ou des thématiques mises en scène comme c’est le cas dans les textes de science-fiction cités précédemment. Il se joue au plan de l’architecture des œuvres ou, plus exactement, de ce qu’il conviendrait d’appeler, avec Foucault, Deleuze et Giorgio Agamben, leurs « dispositifs »[40] mémoriels. En dépit de leurs différences voire de leurs disparités, ces quatre œuvres partagent effectivement une même puissance d’invention face à la nécessité de repenser les procédures mémorielles après « l’époque de la disparition »[41]. Avec d’autres auteurs comme Georges Perec, Denis Roche ou Claude Simon, W. G. Sebald, J. G. Ballard, Ricardo Piglia et Jacques Roubaud ont en commun d’avoir pris acte des mutations historiques et techniques du XXe siècle (l’art « en tant que photographie », le « déclin de l’aura », le passage à la question de « l’exposition », la problématique de la « trace »). Ni successeurs, ni descendants, ni disciples au sens filial et traditionnel du terme, mais héritiers, au sens éthique et politique, d’une mémoire du désastre, ils interrogent notre difficulté à hériter de temps multiples – y compris du futur, comme nous y invitent Nietzsche, Lyotard et Marker.
Élevant l’écrivain au statut de « technologue » et le lecteur à celui de « mécano », chacune de leurs œuvres génère ainsi un corpus hétérogène, situé à la rencontre du programme et de l’événement sensible, de l’archive et du « mal d’archive », du « calcul » (Arno Schmidt) et du hasard, de la machination et de la « vraie pensée ». Qu’il s’agisse des circonvolutions romanesques de Jacques Roubaud où s’entremêlent la mathématique et la poésie, où l’écriture autobiographique remobilise les anciens « arts de mémoire »[42] ; qu’il s’agisse des agencements entre texte et photographies proposés par W. G. Sebald dans un sillage tout à fait benjaminien ; qu’il s’agisse de J. G. Ballard, qui transforme son roman en vaste machine à recycler la mémoire collective et l’iconographie populaire de la seconde moitié du XXe siècle – au moyen notamment de la répétition hallucinée des séquences narratives et d’un proliférant appareil de notes ; ou qu’il s’agisse encore de Ricardo Piglia, qui applique à la douloureuse mémoire argentine les préceptes du formaliste Iouri Tynianov, faisant de l’écriture romanesque un patient travail d’« ostranenie »… chacune de ces œuvres littéraires produit un type singulier de dispositif destiné à lutter contre l’oubli et offrant une manière de réponse au paradoxe énoncé conjointement par Edison, Benjamin et Lyotard : « résorber » par la technique la « réfraction interstellaire » des choses et des événements afin d’en faire non seulement l’objet d’un témoignage mais une véritable matière à connaissance.
Conclusion méthodologique
À la suite de Michel Carrouges et de Pierre Macherey, Deleuze en a fait la démonstration magistrale dans Proust et les signes : poser la question de la machine à la littérature et dans la littérature consiste non plus à interroger la signification de l’œuvre littéraire mais la complexité de son fonctionnement.
Télescope psychique pour une « astronomie passionnée », la Recherche n’est pas seulement un instrument dont Proust se sert en même temps qu’il le fabrique. C’est un instrument pour les autres, et dont les autres doivent apprendre l’usage […]. Non seulement instrument, la Recherche est une machine. L’œuvre d’art moderne est tout ce qu’on veut, ceci, cela, et encore cela, c’est même sa propriété d’être tout ce qu’on veut, d’avoir la surdétermination de ce qu’on veut, du moment que ça marche : l’œuvre d’art moderne est une machine, et fonctionne à ce titre.[43]
Est-ce que « ça marche » et comment « ça marche » ? Telles sont les questions qu’il nous faut poser aux arts de mémoire littéraires – dont les précédents exemples ne sont que les jalons d’un Atlas encore embryonnaire du XXIe siècle. Avec quels outils analyser ces nouvelles « mnémo-technographies » ? Comment rester fidèle à leurs machinations ? Comment en retranscrire le fonctionnement et s’en faire aujourd’hui les authentiques héritiers ?
Il faut à notre tour en passer par la technique. Comme on a cherché à le faire ici en confrontant Villiers à Lyotard, la littérature à la philosophie, la fiction à la théorie, l’une des façons les plus intéressantes de « traiter » ces dispositifs romanesques consiste à équiper son regard de multiples prothèses. Afin de mieux prendre en compte les phénomènes d’hétérogénéité, d’innervation, de prolifération et de possible effacement mémoriel mis en œuvre par un tel corpus littéraire, c’est la lecture elle-même qui doit être envisagée en termes d’appareillage. Issu du verbe latin apparare (préparer, apprêter, orner), l’appareillage « joue » à plusieurs niveaux : maritime (lever l’ancre), architectural (apparier les matériaux de construction), linguistique (la « prosthèse ») et médical (le supplément technique). L’appareillage, qui permet tout aussi bien de séparer que de raccorder, de détruire que d’augmenter, d’entrechoquer que de (re)monter, est un geste fondamentalement critique et comparatiste, grâce auquel la littérature s’ouvre à des domaines étrangers comme le cinéma, la philosophie, les sciences du vivant ou les arts plastiques. Reliant par isomorphie la loi de la lecture à celle des œuvres étudiées, on se donne enfin la chance de « rapprocher des choses qui ne l’avaient jamais été » (selon la formule fétiche que Jean-Luc Godard emprunte à Pierre Reverdy), de la même manière que la mémoire ne cesse de reprendre et de repriser, altérant ses archives tout en les réinscrivant dans des « constellations » de pensée toujours inédites.
[1] Auguste Villiers de l’Isle-Adam, L’Ève future, éd. N. Satiat, Paris, Flammarion, « GF », 1992, p. 125-126.
[2] Alain Resnais, Toute la mémoire du monde, 35 mm, 22 min, Les Films de la Pléiade, 1956.
[3] Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie » (1931), dans Œuvres II, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000, p. 311.
[4] Avant d’être publiée en 1886 chez M. de Brunhoff, L’Ève future était d’abord parue en feuilleton dans deux périodiques, L’Étoile française (1880-1881) et La Vie moderne (1885-1886).
[5] Jean-François Lyotard, L’Inhumain : Causeries sur le temps, Paris, Galilée, « Débats », 1988, p. 10.
[6] Le vocabulaire est directement emprunté à la théorie freudienne : « Le système a plutôt pour conséquence de faire oublier ce qui lui échappe. Mais l’angoisse, l’état d’un esprit hanté par un hôte familier et inconnu qui l’agite, le fait délirer mais aussi penser – si on prétend l’exclure, si on ne lui donne pas d’issue, on l’aggrave. Le malaise s’accroît avec cette civilisation, la forclusion avec l’information. » Ibid., p. 10. Nous soulignons.
[7] Ibid., p. 25.
[8] « Est-il même consistant de prétendre mettre en programme une expérience qui défie, sinon la programmation, du moins le programme, comme est la vision du peintre ou l’écriture ? » Ibid., p. 26.
[9] Ibid., p. 17.
[10] Ibid., p. 21. Nous soulignons. On retrouve exactement la même définition « hypomnésique » de la technique chez Bernard Stiegler : « Il faut comprendre la rupture en quoi consiste l’extériorisation comme l’émergence d’une nouvelle organisation de la mémoire, comme l’apparition de nouveaux supports de mémoire […]. C’est en se libérant de l’inscription génétique que la mémoire à la fois poursuit le processus de libération et y inscrit la marque d’une rupture – sur les cailloux, sur les murs, dans les livres, les machines, les madeleines et toutes les formes de supports, depuis le corps tatoué lui-même jusqu’aux mémoires génétiques instrumentalisées […] en passant par les mémoires holographiques que projette l’industrie informatique. » Bernard Stiegler, La Technique et le temps. I, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 1994, p. 178. « Parce que le cerveau ne suffit pas à mémoriser […], le support est donc la condition d’élaboration du savoir, et non seulement de transmission. » Bernard Stiegler, « Du jugement prothétique a priori », conférence donnée au séminaire « Les supports de la mémoire », texte mis en ligne en novembre 2005 sur le site Ars Industrialis, URL : http://www.arsindustrialis. org/activites/cr/5nov2005/dujugementprothetique. Consulté le 10 janvier 2009.
[11] Robert Aldrich, Kiss Me Deadly (En quatrième vitesse), 106 min, United Artists, 1955. Le film s’ouvre sur l’obscurité d’une route déserte où erre une fugitive (Christina) et se termine sur la lumière éblouissante jaillissant d’une boîte de Pandore radioactive. Associant les peurs d’un nouvel âge industriel à un jeu formel sur les stéréotypes du film noir, Aldrich soumet également son implacable machine cinématographique à un devoir de mémoire (le détective Mike Hammer débute en effet son enquête à partir des simples mots « Remember me » que Christina a eu le temps de lui confier avant d’être assassinée.)
[12] Chris Marker, Sans Soleil, 16 mm gonflé en 35, 110 min, Argos Films, 1982. S’il rend explicitement hommage au « soleil noir » de Gérard de Nerval, Chris Marker emprunte également ses références au film catastrophe et à la science-fiction d’après-guerre. Dans un geste esthétique très proche de celui d’Alain Fleischer, Chris Marker développe enfin une réflexion sur la puissance révélatrice du « noir ». Cf. Alain Fleischer, L’Empreinte et le tremblement / Faire le noir, Paris, Galaade, 2009.
[13] Jean-François Lyotard, op. cit., p. 17-19.
[14] Ibid., p. 18-19.
[15] Ibid., p. 20. Nous soulignons.
[16] Ibid., p. 26. Sans toutefois le citer, Lyotard fait écho à la réflexion de Deleuze sur la « violence des signes » : « Nous ne cherchons la vérité que quand nous sommes déterminés à le faire en fonction d’une situation concrète, quand nous subissons une sorte de violence qui nous pousse à cette recherche. Qui cherche la vérité ? C’est le jaloux, sous la pression des mensonges de l’aimé. Il y a toujours la violence d’un signe qui nous force à chercher, qui nous ôte la paix. La vérité ne se trouve pas par affinité, ni par bonne volonté, mais se trahit à des signes involontaires. Le tort de la philosophie, c’est de présupposer en nous une bonne volonté de penser, un désir, un amour naturel du vrai […]. Il y a peu de thèmes sur lesquels Proust insiste autant que celui-là : la vérité n’est jamais le produit d’une bonne volonté préalable, mais le résultat d’une violence dans la pensée. » Gilles Deleuze, Proust et les signes (1964), Paris, P.U.F., « Quadrige », 2e édition, 1998, p. 10 et 24-25. Nous soulignons.
[17] Jean-François Lyotard, op. cit., p. 18. Nous soulignons.
[18] « Si l’on parle d’analogique sérieusement, c’est cette expérience qu’on connote, ce flou, cet incertain, et cette foi dans l’inépuisable sensible, et pas seulement un mode de report du donné sur une surface d’inscription qui n’est pas originairement la sienne. » Ibid., p. 25.
[19] Ibid., p. 27-28. Nous soulignons.
[20] Il faut noter la gradation de l’interpellation par laquelle se conclut le dialogue entre Technique et Philosophie : l’apostrophe commence au futur (« vos machines à représenter, à penser, souffriront-elles ? »), se module au conditionnel (« il faudrait que le non-pensé leur fasse mal, fasse mal à leur mémoire, le non inscrit qui reste à inscrire, comprenez-vous ? ») avant de se muer en urgence impérative : « Il nous faut des machines qui souffrent de l’encombrement de leur mémoire. » Ibid., p. 27-28.
[21] Ibid., p. 26.
[22] Dans ce dialogue, Platon définit l’écriture (grammata) comme une drogue ambivalente (pharmakon) offerte par le dieu Theuth au roi Thamous. Le mot « pharmakon » signifiant à la fois remède et poison, l’écriture se trouve d’emblée dotée d’une double caractéristique : supplément sensible, visible et spatial de la mnêmê, elle agit du dehors comme « aide-mémoire » tout en faisant preuve d’un pouvoir maléfique d’infiltration du « dedans invisible de l’âme, la mémoire et la vérité ». Au lieu d’accroître le savoir comme l’affirme Theuth, l’écriture rend au contraire toujours « plus oublieux » : « cette connaissance aura, pour résultat, chez ceux qui l’auront acquise, de rendre leurs âmes oublieuses, parce qu’ils cesseront d’exercer leur mémoire (lethen men en psuchais parexei mnêmes amélétésiâ) : mettant en effet leur confiance dans l’écrit, c’est du dehors, grâce à des empreintes étrangères (dia pistin graphès exothen up’allotriôn tupôn), non du dedans et grâce à eux-mêmes qu’ils se remémoreront les choses (ouk endothen autous uph’autôn anamimneskomenous). Ce n’est donc pas pour la mémoire, c’est pour la remémoration que tu as découvert un remède (oukoun mnémès, alla upomnéseôs, pharmakon eures). » Platon, Phèdre, 274 e-275 b, dans Jacques Derrida, « La pharmacie de Platon », Tel Quel, n° 32, Hiver 1968, p. 34.
[23] Derrida note que l’on retrouve la même différenciation chez Hegel entre le souvenir intériorisant (die Erinnerung) et l’extériorité graphique, spatiale et technique de la mémoire-Gedächtnis. Jacques Derrida, « Actes », dans Mémoires – Pour Paul de Man, Paris, Galilée, « La Philosophie en effet », 1988, p. 108-110.
[24] Jacques Derrida, art. cit., p. 39.
[25] « Car l’archive, si ce mot ou cette figure se stabilisent en quelque signification, ce ne sera jamais la mémoire ni l’anamnèse en leur expérience spontanée, vivante, intérieure. Bien au contraire : l’archive a lieu au lieu de défaillance originaire et structurelle de ladite mémoire […]. L’archive travaille toujours et a priori contre elle-même. » Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris, Galilée, « Incises », 1995, p. 26-27.
[26] Jacques Derrida, Papier machine, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 2001, p. 34.
[27] « Et c’est ce corps-là, à la fois »naturel’’ et artificiel, qu’il faudra emporter loin de la terre avant sa destruction, si l’on veut que la pensée qui doit survivre à l’explosion solaire soit autre chose que le misérable squelette binarisé de ce qu’elle était auparavant. » Jean-François Lyotard, op. cit., p. 26.
[28] « La collectivité aussi est de nature corporelle (leibhaft). Et la phusis qui pour elle s’organise en technique ne peut être produite dans toute sa réalité politique et matérielle qu’au sein de cet espace d’images avec lequel l’illumination profane nous familiarise. Lorsque le corps et l’espace d’images s’interpénétreront en elle si profondément que toute tension révolutionnaire se transformera en innervation du corps collectif (leibliche kollektive Innervation), toute innervation corporelle de la collectivité en décharge révolutionnaire, alors seulement la réalité sera parvenue à cet autodépassement qu’appelle le Manifeste communiste. » Walter Benjamin, « Le Surréalisme », dans Œuvres II, trad. M. de Gandillac, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000, p. 134.
[29] Je me réfère à la définition de la culture exposée dans la deuxième dissertation de La Généalogie de la morale. Opposée en apparence à la saine faculté d’oubli défendue dans la Deuxième Considération inactuelle, la culture nous dote selon Nietzsche d’une faculté mnésique qui n’a plus rien à voir avec la « fièvre historienne » (historisches Fieber) qui « ébranle et fait dégénérer la vie » (zerbröckelt und entartet das Leben). Parce qu’elle nous rend responsables d’une dette envers nos semblables, la culture est présentée comme « mémoire de la volonté » (Gedächtnis des Willens), à la fois « engagement de l’avenir, souvenir du futur » et douloureux « mouvement qui s’opère dans les corps et s’inscrit sur eux, les labourant » (Deleuze) : « Pour pouvoir à ce point disposer à l’avance de l’avenir, combien l’homme a-t-il dû d’abord apprendre à séparer le nécessaire du contingent, à penser sous le rapport de la causalité, à voir le lointain comme s’il était présent et à l’anticiper, à voir avec certitude ce qui est but et ce qui est moyen pour l’atteindre, à calculer et à prévoir […], pour pouvoir finalement, comme le fait quelqu’un qui promet, répondre de lui-même comme avenir. » Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, trad. I. Hildenbrand et J. Gratien, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1971, p. 60-63.
[30] Bernard Stiegler, La Technique et le temps. Tome I : La faute d’Épiméthée, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 1994, p. 162-163.
[31] Les ouvrages de Jean-Luc Nancy en sont un autre exemple : cf. L’Intrus, Paris, Galilée, 2000 et Corpus, Paris, Métailié, 2000.
[32] L’expression est de Derrida : « La structure technique de l’archive archivante détermine aussi la structure du contenu archivable dans son surgissement même et dans son rapport à l’avenir. L’archivation produit autant qu’elle enregistre l’événement. [Elle] commande ce qui dans le passé même instituait et constituait quoi que ce fût comme anticipation de l’avenir. Et comme gageure. L’archive a toujours été un gage, et comme tout gage, un gage d’avenir. » Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris, Galilée, « Incises », 1995, p. 34-36.
[33] Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, « Critique », 1972, p. 339. Nous soulignons. En ce qui concerne le cinéma, le travail de David Cronenberg est un modèle du genre. Le « peuplement » opère de ses premiers films de série B hantés par l’obsession de la contamination (Shivers, Rabies, The Brood, Scanners) jusqu’à son adaptation du roman de J. G. Ballard, Crash ! (1996) et eXistenZ (1999), en passant par Videodrome (1982), The Fly (1986) et la fabuleuse adaptation de Naked Lunch (1991).
[34] À cet égard, la prolifération des néologismes chez William Gibson (neuromancer, cyberspace, conurb, nerve-splicing, joeboys, force-feedback, etc.) est à rapprocher du travail de réinvention de la langue française par néologismes scientifiques et préciosité lexicale chez Villiers et Roussel.
[35] « Il se peut que nous autres humains, tendres et chaleureux, le regard brillant d’une pensée profonde, soyons les vraies machines. Et il se peut que les constructions objectives autour de nous, les objets naturels autour de nous, et surtout les appareils électroniques que nous fabriquons – transmetteurs et stations de relais des micro-ondes, satellites – ne soient que les déguisements de la réalité authentique et vivante […]. Il se peut que nous voyions non seulement à travers un voile déformant, mais de plus, à l’envers. Que la meilleure approche de la vérité serait de dire : »Tout est vivant de la même manière, sensible de la même façon, car tout n’est pas vivant, à moitié vivant, ou mort, mais plutôt, tout est vécu comme passage’’. » Philip K. Dick, « Hommes, androïdes et machines », dans Si ce monde vous déplait… et autres écrits, trad. C. Wall-Romana, Paris, Éditions de l’Éclat, 1998, p. 116-117. Man, Android and Machine fut rédigé pour une convention de science-fiction à laquelle Dick ne se rendit pas et a paru pour la première fois dans l’anthologie Science fiction at Large (ed. Peter Nicholls), Londres, Gollancs, 1976.
[36] Cf. Jacques Roubaud, « Description du Projet », Mezura. Cahiers de Poétique comparée (Deuxième série : documents de travail), n° 9, Paris, INALCO, 1979 ; La Bibliothèque de Warburg : Version Mixte, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2002.
[37] W. G. Sebald, Austerlitz, München/Wien, Carl Hanser Verlag, 2001 (Austerlitz, trad. P. Charbonneau, Arles, Actes Sud, 2002, rééd. Paris, Gallimard, « Folio », 2006).
[38] J. G. Ballard, The Atrocity Exhibition (1969-1990), London, HarperCollins-Flamingo, 2001 (La Foire aux atrocités, trad. F. Rivière, Paris, Tristram, 2003).
[39] Ricardo Piglia, Respiración artificial (1980), Barcelona, Anagrama, 2001 (Respiration artificielle, trad. A. et. I. Berman, Marseille, André Dimanche, 2000). Voir aussi le labyrinthique La ciudad ausente (1992), Buenos Aires, Seix Barral, 2004 (La Ville absente, trad. F.-M. Durazzo, Paris, Zulma, 2009), qui met en scène une nouvelle « Ève future », mi-femme, mi-machine, autour de laquelle s’enchevêtrent une multiplicité de récits.
[40] Cf. Michel Foucault, « Le jeu de Michel Foucault », dans Dits et écrits III, Paris, Gallimard, 2000, p. 298-342 ; Gilles Deleuze, « Qu’est-ce qu’un dispositif ? », dans Deux régimes de fous, éd. David Lapoujade, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2003, p. 318-325 ; Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, trad. M. Rueff, Paris, Payot et Rivages, « Rivages poche/Petite Bibliothèque », 2007.
[41] Cf. Jean-Louis Déotte et Alain Brossat, L’Époque de la disparition : Politique et esthétique, Paris, L’Harmattan, « Esthétiques », 2000.
[42] Cf. Jacques Roubaud, Le Fils de Leoprepes : Poésie et mémoire, Saulxures, Circé, 1993.
[43] Gilles Deleuze, Proust et les signes, op. cit., p. 174-175. Ce questionnement, effectivement inspiré par les ouvrages de Michel Carrouges (Les Machines célibataires, Paris, Arcanes, « Chiffres », 1954) et de Pierre Macherey (Pour une théorie de la production littéraire, Paris, Maspero, 1966), trouve d’autres prolongements chez Michel Serres, (Feux et signaux de brume : Zola, Paris, Grasset, « Figures », 1975) et Italo Calvino (La Machine littérature (1984), trad. M. Orcel et F. Wahl, Paris, Seuil, « La Librairie du XXe siècle », 1993).
Photographie et machineries fictionnelles
Il fallut attendre que le phénomène, d’abord cantonné à l’avant-garde, contamine la masse au 20e siècle, pour que la compulsion photographique les rattrape à leur tour. Quelques décennies après Breton, cédant à l’invasion des images et fasciné par les médias et les images modernes, Roland Barthes intègre à son tour des photographies dans ses essais. Dans le même temps, un mouvement narratif singulier lie pratique photographique et récit de soi. Les Cahiers de la photographie désignent alors ce phénomène par un astucieux mot-valise : la « photobiographie », scellant l’alliance d’une technique à un genre littéraire propre à faire bondir Baudelaire de l’au-delà (« La poésie et le progrès sont deux ambitieux qui se haïssent d’une haine instinctive », écrivait-il dans son Salon de 1859). Ces productions longtemps restées marginales deviennent alors, dans les années quatre-vingts dix jusqu’à nos jours, un véritable raz-de-marée éditorial, au point qu’on aurait du mal aujourd’hui à recenser tous les livres d’auteur qui paraissent illustrés de photos. Des écrivains aussi divers que Jacques Derrida, Anny Duperey, Michel Houellebecq, Annie Ernaux, Marie N’Diaye, Olivier Rolin, Anne Brochet, Georg W. Sebald ou Orhan Pamuk ont cédé récemment à l’appel de l’appareil-photo. Ils insèrent leurs clichés dans leurs livres et cette « machine de vision », pour reprendre l’expression de Paul Virilio, entrée en littérature depuis longtemps (c’est un des thèmes favoris de Patrick Modiano), est désormais présente de façon concrète et visible dans bien des récits, souvent écrits à la première personne[1].
La période charnière de cette nouvelle pratique du récit de soi se situe dans les années soixante-dix. Non seulement, la littérature du moi connaît une véritable expansion, mais de surcroît, depuis 1969, des artistes français comme Christian Boltanski ou Jean Le Gac avaient délaissé la traditionnelle peinture pour préférer les outils médiatiques d’un art moyen partagé par la population (elle aussi moyenne), selon l’expression de Pierre Bourdieu. Ces artistes tissent des fils narratifs autour de leurs images, à partir de souvenirs personnels.  Et c’est au cours de cette période artistique radicale que des œuvres auto-narratives vont cristalliser chez Roland Barthes, Hervé Guibert et Sophie Calle ce nouveau rapport technique du texte et de la fiction de soi, à travers le prisme de la photographie. En entretenant chacun un rapport singulier avec l’appareil, et dans un très cours laps de temps, leurs parcours matérialisent la nouvelle fonction littéraire et identitaire de l’image mécanique.
Et c’est au cours de cette période artistique radicale que des œuvres auto-narratives vont cristalliser chez Roland Barthes, Hervé Guibert et Sophie Calle ce nouveau rapport technique du texte et de la fiction de soi, à travers le prisme de la photographie. En entretenant chacun un rapport singulier avec l’appareil, et dans un très cours laps de temps, leurs parcours matérialisent la nouvelle fonction littéraire et identitaire de l’image mécanique.
Comment l’image photographique, fille aînée de la reproductibilité technique, génère-t-elle dans leur cas une nouvelle forme de récit de soi, entre évocations de souvenirs textuels et images documentaires ? Après avoir interrogé la possibilité d’un « genre » photo-narratif hybride, nous étudierons le cas de cet étrange triptyque : Calle, Guibert et Barthes, à la même époque, se sont racontés de façon fragmentaire autour de photographies familières, amateur ou publiques. Comment définir leur pratique narrative de l’illustration, leurs fantasmes liés à la photographie et surtout, cette construction éparse d’une « mythologie individuelle » ? Face à ces récits hybrides, la compulsion catégorisante de l’exégète est vite déçue par la trop grande labilité formelle de ces textes. En comparant quelques éléments biographiques et leurs différentes versions rapportées, nous tenterons de voir comment la mythologie moderne, telle que Roland Barthes l’a appliquée à sa contemporanéité, peut avantageusement se substituer aux catégories établies pour les genres littéraires et redéfinir l’autobiographie à l’ère des images.
Déceptions génériques et hybridation moderne.
Le récit photographique est généralement considéré comme étant à la marge des genres nobles, comme si la photographie appauvrissait le texte. Il existe pourtant une quantité mirobolante d’ouvrages illustrés, très divers, qui vont du photoreportage au livre documentaire. Ceux qui nous intéressent relèvent d’une production particulière, à la fois littéraire et esthétique. Mais dans ce domaine encore, les montages éditoriaux ne manquent pas, l’édition massive de beaux livres ayant été rendue possible par la baisse des coûts de reproduction dans les années soixante. Force est toutefois de constater que les ouvrages photolittéraires de l’époque proposent généralement des suites de photographies insipides accompagnées d’envolées pseudo-lyriques d’écrivains, poètes et journalistes. Le résultat aléatoire montre que la forme reste mal maîtrisée par les uns et les autres, en raison d’une méconnaissance des ressorts propres à ce dispositif hétérogène[2]. D’autres textes, entièrement conçus par l’auteur, intègrent par contre à leur trame les illustrations de façon essentielle, développant un nouvel usage de la photographie dans le livre, dont les reportages de Raymond Depardon marquèrent un pas décisif. Malheureusement, ces textes novateurs qui mêlent plusieurs formes sont bien souvent rangés dans les sections fourre-tout de la paralittérature. Et l’intuition qu’un récit illustré avec des photographies possède des qualités intrinsèques bien différentes des textes simplement agrémentés de planches dessinées ou peintes n’a jamais été clairement poussée jusqu’à son terme. Il en ressort que les tentatives de circonscriptions du genre se sont globalement révélées décevantes. La liste de tous les termes employés pour désigner cet assemblage entre photo et texte témoigne de cette indétermination : phototextualité, photo-essay, photo-poème, récit-photo, iconotexte, etc., des termes apparus à la suite de la vague de production des années soixante-dix.
Deux tendances fortes de cette époque, photographie et récit de soi, se sont donc rencontrées à l’intersection des pratiques artistiques et littéraires. Un terme inventé par Gilles Mora, photographe et directeur des Cahiers de la photographie, a eu une certaine fortune critique, la « photobiographie ». Mais lui-même est revenu sur ce terme à l’occasion d’un colloque Traces photographiques, traces autobiographiques en 2003 en dénonçant la piètre qualité des liens entre photo et texte : « En finir avec la photobiographie, […] c’est reconnaître […] l’extrême rareté, voire l’absence d’œuvres photobiographiques suffisamment fortes, impossibles à confondre avec des productions mineures fondées sur une utilisation biographique simpliste de la photographie »[3].
L’insertion d’une technique moderne, la photographie, en tant qu’élément narratif, dans un genre littéraire identifié comme l’autobiographie a profondément troublé les classifications génériques et a soulevé de véritables difficultés dans la manipulation même de cet élément étranger au texte. Sans nous attarder trop longtemps sur cette double question, qualitative et générique, il est cependant bon de replacer cette forme narrative en perspective de la typologie originelle des genres que Käte Hamburger propose dans son ouvrage devenu un classique, Logique des genres littéraires. Son chapitre consacré aux « formes mixtes » est éclairante de la lacune méthodologique propre à l’étude littéraire : elle traite en effet l’hétérogénéité du texte, mais systématiquement sur un plan infra-textuel[4], sans tenir compte du fait que la photographie fait justement éclater cette coquille textuelle pour produire une autre forme narrative signifiante. En remontant aux sources théoriques du genre, on aurait pu penser que Käte Hamburger, qui amorce une réflexion sur la fiction cinématographique, avait perçu une possible frontière entre récit textuel et récit en image, puisqu’elle déclare : « La photographie est au film ce que la narration est au roman et la mise en forme dialogique au drame »[5]. Mais ce questionnement tourne autour de la temporalité du film, ce qui lui permet juste de faire un parallèle entre film et roman. Et selon elle, « ce n’est pas l’image photographique en tant que telle qui permet de comparer le film aux arts littéraires, mais l’image photographique en mouvement. »[6] Käte Hamburger ne propose donc pas de nomenclature pour les récits illustrés de photographies qui imposent pourtant un régime de lecture résolument moderne, marqué par l’alternance, la syncope et le fragmentaire. Les tentatives ultérieures de typologie, nous allons le voir dans le cas précis de l’autobiographie, perpétuent globalement cet ostracisme visuel.
Si les genres littéraires sont manifestement aveugles à la photographie, les artistes ont eux commencé, à utiliser texte et photographie pour élaborer des œuvres conceptuelles et narratives depuis le mouvement Dada. Un des premiers auto-reportages célèbres d’artiste fut certainement celui qui fut réalisé sur Fountain, le ready-made signé R. Mutt. Canular monté par Marcel Duchamp, cette fontaine-urinoir ne doit son succès qu’à la légende bâtie par la photographie d’Alfred Stieglitz et le texte-défense de Duchamp, tous deux publiés dans la revue The Blind Man en 1917. À leur suite, nombres d’artistes ont utilisé textes et photographies comme des outils d’authentification et de médiatisation d’expériences artistiques réalisées dans un cercle restreint. Ils ont, nous allons le voir, travaillé à faire de la figure de l’artiste le centre d’une représentation artistique à part entière, et cette tendance se répercute dans les récits autobiographiques illustrés de trois auteurs, Roland Barthes, Hervé Guibert et Sophie Calle à la charnière des années soixante-dix et quatre-vingt. Ces écrivains et artistes franchissent en effet, chacun dans des contextes différents (critique, fictionnel ou artistique), les frontières du genre littéraire pour utiliser ces dispositifs texte et image déjà présents chez des artistes conceptuels (Joseph Kosuth, Vito Acconci, Duane Michals, Victor Burgin ou Richard Long). L’usage de la photographie confère une dimension scientifique, précise et authentique à la représentation : elle montre les objets en transparence. La photo ne fait pas écran entre l’objet et le spectateur, comme si une simple glace était posée entre eux. Dans les récits autobiographiques illustrés, la mise en scène de soi se déroule selon des modalités objectives similaires : elle tend à replacer la représentation du réel, sans filtre, au plus près du regard mais aussi du texte, remettant en question la relation traditionnelle non seulement entre récit et image, mais entre récit de soi et image de soi.
En plus de ce dispositif visuel qui illustre le texte, le statut autobiographique du texte pose question, notamment dans sa dimension authentifiante (il induit un pacte de vérité implicite). « Biographie (histoire d’une vie particulière) de l’auteur faite par lui-même » d’après Le Robert, l’autobiographie répond toutefois à des critères plus précis établis par Philippe Lejeune en 1975 dans son Pacte autobiographique et qui depuis continuent, malgré les codicilles et autres repentirs, à faire autorité. La définition admise de l’autobiographie correspond au « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité »[7]. La première objection d’importance vint de Serge Doubrovsky avec la parution de son récit Fils en 1977. Il avait alors décidé d’occuper la case aveugle que le tableau de Lejeune avait laissé dans sa définition du pacte de vérité qui liait l’auteur et le lecteur, « inventant » ainsi l’autofiction. Fils scelle un pacte romanesque avec nom d’auteur identique au personnage[8]. Mais la fortune critique de l’autofiction a malheureusement une fois de plus occulté l’élément intrusif que représente la photographie dans ce type de texte qui trouble, à l’aide de l’image, la question de la vérité narrative.
Quand Jacques Lecarme semble consacrer la fonction de l’image dans le récit à travers un chapitre de son ouvrage L’Autobiographie, elle reste en fait « aux marges » ou témoigne de « renouvellements », condamnée à rester un inducteur de mémoire, un trésor familial pour l’auteur ou un élément du paratexte comme le portrait de l’auteur sur la couverture, souvent du seul fait de l’éditeur[9]. Éternellement condamnée à être « l’humble servante des arts »[10], pour reprendre le terme de Baudelaire, sa présence dans les récits, autobiographiques ou romanesques, reste toujours une apposition au texte. Elle semblerait n’avoir aucune influence notable sur la réception ou la structure même du récit. Cet aveuglement face à l’image occulte toutefois, nous allons le voir, l’importance fondamentale du médium photographique dans la constitution de l’identité narrative de ces auteurs à la première personne.
Mais, et l’autoportrait ? Dans le champ pictural, on peut considérer que l’équivalent visuel de l’autobiographie est l’autoportrait, un genre pictural très bien identifié par les historiens de l’art. Pascal Bonafoux montre dans son ouvrage de référence, Moi ! Autoportraits du 20e siècle, la diversité de la mise en scène de l’artiste par lui-même, souvent dans son propre rôle[11]. Mais quelle valeur a un autoportrait dans l’économie générale de l’œuvre ? Que dit-il de son auteur ? S’il s’agit d’un tableau peint, il témoigne encore d’un style, d’une touche et d’un certain sens de la construction picturale. La photographie, pour sa part, produit une vue achéïropoïétique (non faite de main d’homme), directe et parfaitement réaliste d’un individu : l’appareil atteint un niveau de réalisme jamais atteint, habité par un démon de l’analogie enfin accessible. Toutefois, l’œuvre photographique a quelque chose de stérile et précisément d’inhumain. L’autoportrait, par ailleurs, ne construit pas le récit personnel de l’artiste, il ne raconte rien, ne faisant que signaler des traits physiques de l’auteur. Si l’on met cette pratique en perspective avec l’usage commun de la photographie d’identité, on se rend vite compte qu’elle ne renvoie finalement qu’à une identification redondante, une sorte de tautologie identitaire mécanisée que les sérigraphies warholiennes singeaient déjà dans les médias[12]. Pour remédier à la platitude répétitive de ces représentations, les artistes et les auteurs ont développé des réflexions, à tous les sens du terme, sur le statut de ces images de soi. Alors que ces dernières sont au centre des préoccupations occidentales dans les années soixante-dix, dans le même temps, le corps et l’image de l’auteur (son « je », encore amplifié par l’image) se mettent à occuper le devant de la scène et à devenir un enjeu autant esthétique que narratif.
Dans cette perspective, les textes photographiques que nous présentent Barthes, Guibert et Calle apparaissent comme le pur produit d’une modernité qui tend à hybrider technicité et objectivité avec une création de soi qui flirte avec la fiction. Le corps mutant de l’auteur, sous l’effet de la machine photographique, se transfigure dans des textes eux-mêmes mutants, à la frontière du réalisme de l’image et de la fiction narrative.
Petites machineries fictionnelles.
 À la fin des années soixante-dix, Roland Barthes, Hervé Guibert et Sophie Calle, alors toute jeune artiste, vivent dans un petit milieu intellectuel et artistique qui permet, si ce n’est de véritables rencontres, tout du moins des rapprochements significatifs[13]. Afin de clarifier les relations entre les trois protagonistes et de replacer leur travail dans une perspective commune, reprenons quelques points biographiques : si Roland Barthes a fréquenté Hervé Guibert en 1977 et si ce dernier a connu Sophie Calle à partir de 1984, Roland Barthes et Sophie Calle ne se sont jamais rencontrés. Peut-être à l’extrême rigueur se sont-ils entr’aperçus, alors que l’un était un intellectuel parisien en vogue et l’autre une exilée désoeuvrée de retour à Paris en 1979. Mais rien n’atteste d’un lien entre eux en dehors de lectures ou d’échos formels, si ce n’est Hervé Guibert, lui-même, écrivain et photographe, qui joue le rôle de maillon entre Barthes et Calle.
À la fin des années soixante-dix, Roland Barthes, Hervé Guibert et Sophie Calle, alors toute jeune artiste, vivent dans un petit milieu intellectuel et artistique qui permet, si ce n’est de véritables rencontres, tout du moins des rapprochements significatifs[13]. Afin de clarifier les relations entre les trois protagonistes et de replacer leur travail dans une perspective commune, reprenons quelques points biographiques : si Roland Barthes a fréquenté Hervé Guibert en 1977 et si ce dernier a connu Sophie Calle à partir de 1984, Roland Barthes et Sophie Calle ne se sont jamais rencontrés. Peut-être à l’extrême rigueur se sont-ils entr’aperçus, alors que l’un était un intellectuel parisien en vogue et l’autre une exilée désoeuvrée de retour à Paris en 1979. Mais rien n’atteste d’un lien entre eux en dehors de lectures ou d’échos formels, si ce n’est Hervé Guibert, lui-même, écrivain et photographe, qui joue le rôle de maillon entre Barthes et Calle.
Par quel concours de circonstances biographiques ces faux couples se sont-ils formés ? Et comment la fiction marque-t-elle leur relation commune à l’image ? Sur les conseils d’un ami en 1977, Guibert avait glissé un exemplaire de son premier livre La Mort propagande dans la boîte aux lettres de Barthes. Il venait d’entrer comme critique de photographie au journal Le Monde, le premier dans ce journal qui résista longtemps à l’illustration photographique. Ralph Sarkonak et d’autres biographes racontent comment la relation a commencé par une correspondance entre Barthes, alors éminent professeur et Guibert, apprenti écrivain. L’année 1977 est cependant marquée par une suite de quiproquos (un prétendu chantage libidineux en échange d’une préface) ou d’attentes déçues (un baisemain jamais obtenu). Cette succession de rendez-vous manqués et de malentendus trouve son épilogue dans une lettre, « Fragments pour H. »[14], écrite par Barthes le 10 décembre 1977, que Guibert publiera en 1986. Bien après la mort de Barthes en 1980, les écrits de Guibert resteront le lieu d’un régulier tribut au maître avec lequel la conversation continue par-delà la mort, non sans se ménager quelques règlements de compte à l’occasion.
Commençant à jouir d’une petite célébrité dans le monde de l’art pour ses extravagances, Sophie Calle apparaît dans la vie d’Hervé Guibert en 1984 à l’occasion d’un portrait pour Le Monde. Installée à Paris depuis 1979, elle a déjà publié dans la collection « Ecrits sur l’image », Suite vénitienne et vient de sortir L’Hôtel, deux récits de filatures et d’aventures à Venise, augmentés des photographies de l’auteur[15]. De rebondissements (une photographie perdue, une porte claquée au nez, un bain au Japon) en citations réciproques, Guibert et Calle vivront une suite de rencontres réelles ou textuelles que chacun rapportera sous couvert de fiction chez l’un ou d’« histoire vraie » chez l’autre, pour reprendre le titre d’un recueil de Sophie Calle[16]. Ainsi, dans le faux roman À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Guibert raconte des scènes vécues avec une Sophie qui porte désormais le nom d’Anna, tandis qu’elle raconte à son tour dans Douleur exquise, ces mêmes aventures au Japon sous la forme d’une lettre adressée à son amant mais étrangement restée dans ses archives[17].
C’est à travers ce même dialogue, dans le silence et la perte de vue, que plus tard Sophie Calle ressuscitera les traces guibertiennes comme autant d’hommages à « un ami dont elle n’a pas pu sauver la vie », regret qu’elle exprime au début de son film No sex last night (1991) lorsqu’elle décide de prendre son avion vers les États-Unis malgré l’état critique de Guibert. Elle dit naïvement espérer réussir, par son départ, comme si de rien n’était, à conjurer sa mort. Son film répond à celui qu’il était en train de tourner, son journal intime vidéo, alors qu’il était au stade terminal de sa maladie[18]. Calle évoquera à plusieurs reprises dans ses œuvres ces « images fantômes » du jeune écrivain qu’elle n’a pas su garder parmi les vivants[19]. Catherine Mavrikakis raconte ces « r-v » avec Hervé et les multiples légendes qui entourent ces deux personnages à fort potentiel autofictif[20]. L’une d’elles voudrait qu’ils se soient rencontrés lors d’un dîner chez Michel Foucault : Sophie Calle, qui déclare depuis quelques années avoir une très mauvaise mémoire, ne s’en souvient pas. Quant aux deux autres protagonistes, ils n’ont jamais évoqué ces circonstances et ne sont plus là pour donner leur version des faits. Le flou autour de la rencontre nimbe d’un premier brouillard leur relation, qui sera jalonnée d’autres moments forts dont chacun choisira de faire le récit tout subjectif. Une anecdote a été ainsi réciproquement narrée. Guibert était allé rencontrer Calle en 1984 pour la sortie de son second livre aux Editions de l’Etoile, L’Hôtel. À la suite de l’entretien, il demande une photographie de l’artiste pour illustrer son article. Alors qu’elle avait stipulé qu’elle tenait au cliché comme à la prunelle de ses yeux, il s’attire les foudres de l’artiste lorsque la photo d’enfance fétiche est déclarée perdue à la rédaction du Monde. L’image sera plus tard miraculeusement retrouvée, après que Calle a eu le temps de harceler Guibert comme il se doit dans les intrigues les plus passionnelles, et rendue à l’occasion d’une rencontre au Japon. Ce même séjour au Japon verra le journaliste et l’artiste réunis dans une chambre d’hôtel, rencontre qui sera également racontée dans deux versions divergentes. Malgré des orientations sexuelles différentes, la chambre devint le théâtre d’une expérience érotique inédite qui faillit se solder par l’assassinat de Calle par un Guibert à son tour mis hors de ses gonds par l’artiste « chichiteuse[21] ». Les récits, loin d’être authentifiés par les photographies, sont troublés par les distorsions de la fiction et la confrontation des différentes versions.
L’appareillage photographique produit alors une documentation qui fonctionne à rebours de son usage habituel. Elle n’est pas utilisée pour attester des faits, puisque l’authenticité des clichés ne garantit manifestement pas celle des récits. À la différence des reportages ou des filatures que Calle affectionne pourtant, les clichés ne disent rien des actions qui se sont déroulées : les faits n’apparaissent pas dans leur criante vérité comme dans les journaux, les photos ne provoquent pas de « choc » visuel ni n’apportent d’informations supplémentaires. La photographie apporte une documentation au statut ambivalent, puisque l’impression d’authenticité se trouve régulièrement remise en question par des indices contradictoires qui jettent le trouble sur la vérité des récits.
Mutations du texte.
Ces auteurs, au moment de leurs rencontres respectives, ont tous déjà à leur actif une pratique très personnelle de la photographie. Roland Barthes a publié plusieurs textes illustrés dans un corpus qui va du Message photographique (1961) à La Tour Eiffel (1964). Son premier ouvrage illustré autobiographique, L’Empire des signes, sort en 1970 : on y découvre le premier portrait de l’auteur, sous le masque d’un conférencier « japonisé, les yeux élongés, la prunelle noircie par la typographie nippone »[22]. Ce livre sera suivi cinq ans plus tard du Roland Barthes par Roland Barthes, à la demande de Denis Roche, alors responsable de la collection « Microcosmos – Écrivains de toujours » aux Éditions du Seuil. Enfin, en 1980, La Chambre claire, et tout particulièrement la seconde partie dédiée à la mémoire de sa mère, se présente sans fards comme un fragment autobiographique dont les images tracent un parcours anachronique et scénarisé dans la fiction du récit[23]. La plupart de ces textes, dont on peut dire qu’ils sont auto-narratifs peut-être plus qu’autobiographiques (ils ne retracent pas exactement la vie de l’auteur) procèdent d’une relation plus ou moins étroite avec l’image photographique, une relation qui avait débuté vingt ans avant sa disparition prématurée en 1980.
 La pratique de la photographie chez Hervé Guibert accompagne également très tôt ses aspirations d’écrivain, marquées par le patronage barthésien : après La Mort propagande, il commence en 1978 à photographier ses grands-tantes, Suzanne et Louise dont il fera une première exposition à la galerie La Remise du Parc[24]. Ces photographies qui dessinent une chronique familiale autour de deux vieilles dames et de leurs relations avec leur jeune neveu, seront compilées en un « roman-photo » dont la publication précède d’un an L’Image fantôme. Ce livre, une suite de courts textes sur des photographies absentes, disparues ou invisibles, préfigure les motifs barthésiens du fragment et du photographique, des thèmes récurrents dans ses travaux ultérieurs, même cinématographiques. Ainsi L’Image fantôme apparaît comme une citation du dispositif préféré de Barthes, et comme pour répondre à La Chambre claire, le livre de Guibert ne contient aucune image[25]. L’hommage se révèle par ailleurs explicite dans le court chapitre « La photo, au plus près de la mort » dans lequel Guibert raconte avoir souhaité photographier la mère de Barthes, ce dernier désigné simplement par ses initiales : « R.B., l’écrivain ». Guibert explique cependant qu’il ne pourra en aucune manière prendre en photo celle que Barthes appelait affectueusement « mam », la mort l’ayant emportée avant même qu’il ne puisse formuler sa requête. Et comme Barthes avait déjà jugé inutile de montrer dans La Chambre claire la photographie du Jardin d’Hiver – « Pour vous, elle ne serait rien d’autre qu’une photo indifférente[26] » – personne ne verra donc jamais cette mystérieuse image de la mère. Elle reste tout aussi invisible chez Guibert qui raconte comment il a manqué la seule séance de pose qu’il avait réussi à obtenir de sa mère en oubliant de charger l’appareil avec une pellicule[27] : une figure à nouveau fantomatique, disparue avant même d’avoir pu être capturée par l’appareil photographique. La photographie, tant pour Barthes, Guibert ou Calle, est comparable à une manifestation de l’antimatière, comme si les reflets du réel ouvraient les portes de l’invisible.
La pratique de la photographie chez Hervé Guibert accompagne également très tôt ses aspirations d’écrivain, marquées par le patronage barthésien : après La Mort propagande, il commence en 1978 à photographier ses grands-tantes, Suzanne et Louise dont il fera une première exposition à la galerie La Remise du Parc[24]. Ces photographies qui dessinent une chronique familiale autour de deux vieilles dames et de leurs relations avec leur jeune neveu, seront compilées en un « roman-photo » dont la publication précède d’un an L’Image fantôme. Ce livre, une suite de courts textes sur des photographies absentes, disparues ou invisibles, préfigure les motifs barthésiens du fragment et du photographique, des thèmes récurrents dans ses travaux ultérieurs, même cinématographiques. Ainsi L’Image fantôme apparaît comme une citation du dispositif préféré de Barthes, et comme pour répondre à La Chambre claire, le livre de Guibert ne contient aucune image[25]. L’hommage se révèle par ailleurs explicite dans le court chapitre « La photo, au plus près de la mort » dans lequel Guibert raconte avoir souhaité photographier la mère de Barthes, ce dernier désigné simplement par ses initiales : « R.B., l’écrivain ». Guibert explique cependant qu’il ne pourra en aucune manière prendre en photo celle que Barthes appelait affectueusement « mam », la mort l’ayant emportée avant même qu’il ne puisse formuler sa requête. Et comme Barthes avait déjà jugé inutile de montrer dans La Chambre claire la photographie du Jardin d’Hiver – « Pour vous, elle ne serait rien d’autre qu’une photo indifférente[26] » – personne ne verra donc jamais cette mystérieuse image de la mère. Elle reste tout aussi invisible chez Guibert qui raconte comment il a manqué la seule séance de pose qu’il avait réussi à obtenir de sa mère en oubliant de charger l’appareil avec une pellicule[27] : une figure à nouveau fantomatique, disparue avant même d’avoir pu être capturée par l’appareil photographique. La photographie, tant pour Barthes, Guibert ou Calle, est comparable à une manifestation de l’antimatière, comme si les reflets du réel ouvraient les portes de l’invisible.
Longtemps on n’aura retenu des récits photographiques de Sophie Calle que le caractère spectaculaire de l’autobiographie fragmentée qu’elle exhibe dans les expositions et ses petits livres publiés chez Actes Sud. Pourtant, elle a beaucoup utilisé le récit illustré de photographies, forme presque exclusive de ses œuvres, pour pointer des absences. Sophie Calle commence son travail d’artiste en 1979 dans Paris et tout de suite s’impose à elle un dispositif double composé de photos et de textes : « [sa] marque de fabrique », dit-elle[28]. De retour d’un séjour de sept ans à l’étranger, elle décide de suivre des gens dans la rue, les prenant en photos et consignant dans ses carnets leurs faits et gestes, ajoutant toujours les clichés de ses filatures et ses impressions personnelles. Repérée par Bernard Lamarche-Vadel l’année de la mort de Barthes, elle expose ses œuvres à la XIe Biennale des jeunes artistes à Paris. Elle poursuit ensuite ses filatures entre Venise et Paris, élabore des récits autobiographiques qu’elle compilera dans Histoires vraies, tourne un film pendant lequel elle se marie réellement (No sex last night (Double Blind), 1992, 76’) ou travaille avec des aveugles à l’instigation de Guibert qui intervient régulièrement à l’Institut des jeunes aveugles de Paris[29]. Mais quels que soient les masques que revête la voix de Sophie Calle, elle se met de façon systématique en scène dans ses œuvres, parfois au premier plan comme dans Douleur exquise, ou plus à distance, comme pour les séries qu’elle réalise dans les musées ou à Berlin-Est autour d’œuvres ou de monuments disparus[30].
Ainsi, malgré l’écart qui persiste entre les récits de Roland Barthes, d’Hervé Guibert et de Sophie Calle, émergent quelques similarités formelles, comme la récurrence de l’association entre texte et photographie et la permanence de la première personne du singulier. On constate également un même attrait pour l’image de l’absence, pour la photographie de l’invisible, soit parce qu’elle est in-montrable (celle de la mère chez Barthes ou chez Guibert) soit parce qu’elle est fantomatique. Pour Calle aussi, les images sont comme des « Fantômes », lorsqu’elle intitule ainsi une de ses séries sur les œuvres de musée absentes, reprenant le nom du cartel qui remplace temporairement les objets déplacés. Enfin, la mise en scène de soi dans des fictions théoriques ou documentaires forme le ciment majeur entre ces scénaristes qui distillent leurs clichés-souvenirs dans des récits autobiographiques. Par-delà ces points communs, on admettra qu’il y a un lien séduisant, bien qu’incongru, dans ce trio improbable qui réunit l’écrivain, le critique et l’artiste. Leur fréquentation assidue de la photographie, leur goût des petites histoires et du fragment finissent par mettre en scène des « sujets autobiographiques » dont les routes se croisent, parfois dans leur vie quotidienne.
Et si notre définition générique lacunaire, évoquée en introduction, pouvait prendre un chemin de traverse pour s’intéresser à ces textes hybridés ? Chez chacun d’eux persistent en effet et se développent comme des champignons en chambre noire ce que Barthes appelle des « biographèmes » et qui constituent petits bouts par petits bouts, ce qui n’est ni un genre ni un thème mais une forme avant tout artistique : les « mythologies individuelles ».
La reprise des « mythologies individuelles »
Que sont ces mythologies individuelles et en quoi cette dénomination peut nous faire sortir de l’impasse générique dans laquelle semble nous mener ces textes mixtes[31] ? Afin de montrer en quoi les récits illustrés de photographies participent de l’élaboration d’une mythologie personnelle, les écrits de Roland Barthes nous fournissent deux notions utiles : le biographème et la mythologie. Déjà exploités depuis le début des années soixante-dix dans les pratiques artistiques, leur coalescence forme ce qui a été identifié très rapidement comme une production de « mythologies individuelles » dont le mécanisme répond presque point par point à la définition latente qu’en avait faite Barthes[32].
Tout d’abord, pour rappel, la notion de biographème est introduite par Barthes dans son étude sur Sade, Fourier et Loyola, où il dévoile un peu de ses fantasmes autobiographiques :
Si j’étais écrivain et mort, comme j’aimerais que ma vie se réduisît, par les soins d’un biographe amical et désinvolte, à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des « biographèmes » dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher, à la manière des atomes épicuriens, quelque corps futur, promis à la même dispersion ; une vie « trouée », en somme.[33]
La trouée autobiographique correspond bien au parcellement que les photographies imposent dans la vie d’un auteur dont quelques scènes se jouent en effet par « tranches » toujours partielles. Roland Barthes dans La Chambre claire fera un rapprochement explicite entre photographie et biographème lorsqu’il déclare que « la photographie est à l’histoire (avec un petit h) ce que le biographème est à la biographie »[34]. Ainsi, toute photographie aurait le pouvoir d’incarner un fragment d’une « histoire », qu’elle soit collective ou individuelle et fonctionnerait comme un équivalent du biographème. L’appareil photo débite en petit morceau ce qui va former la matière première du nouveau dispositif historique, tant pour la collectivité que pour l’individu.
Ce processus de biographème photographique participe dans un second temps à la fabrication des mythologies appliquées à une personne, en lieu et place des traditionnels objets ou valeurs qui font des cultures collectives. Barthes s’appuie, lorsqu’il commence à rédiger ses chroniques « petites mythologies du mois » sur des pratiques informatives et médiatiques présentes dans la presse illustrée où il puise la plupart de ses exemples[35]. Sémiologue de son temps, Barthes formalise et réactualise le principe de mythologie dans des pratiques sociales et imaginaires : ses supports peuvent être des objets, des pratiques quotidiennes mais aussi et surtout, des répertoires iconographiques et narratifs. Ainsi, dans la mesure où il existe une mythologie de l’Abbé Pierre, pourquoi l’auteur (ou l’artiste) ne pourrait pas s’en constituer une propre ? Du moment qu’il dispose d’un accès aux mêmes dispositifs que ceux qui ont élevé le généreux quidam au rang de mythe, cela ne semble pas très difficile. « Image simplifiée et souvent illusoire que l’on élabore au sujet d’un individu ou d’un fait »[36], la mythologie barthésienne s’appuie sur une version dégénérée du mythe qui se rétrécit jusqu’à atteindre le cercle de l’individu et son histoire personnelle. La mythologie, par ailleurs, se définit par son polymorphisme :
Le mythe est une parole […] Cette parole est un message. […] Elle peut être formée d’écritures et de représentations : le discours écrit, mais aussi la photographie, le cinéma, le reportage, le sport, les spectacles, la publicité, tout cela peut servir de support à la parole mythique.[37]
On remarque que la photographie est située après le discours écrit, en première place avant le cinéma, puisque de l’une découle l’autre. L’élaboration d’une mythologie personnelle répond au même processus que la mythologie moderne, si ce n’est que le resserrement du mécanisme dévoilé par Barthes s’applique à une personne, un sujet. Cette miniaturisation du mythe autour du moi doit, pour atteindre son statut mythologique, passer par le décanteur de l’image qui le sublimera, telle une pierre philosophale.
Cette opération magnifiante de l’image de soi par la technique photographique a débuté peu de temps après la parution des Mythologies en 1957, notamment dans le cercle privé, avec la popularisation de l’album de famille. En 1972, lors de la mythique Documenta V de Kassel, la mythologie se fait officiellement « individuelle ». Le commissaire d’exposition Harald Szeemann avait alors baptisé une section « Individuelle Mythologien »[38], qui présentait des œuvres de Christian Boltanski et de Jean Le Gac, mettant en scène leur vie, avec une distance critique manifeste, dans des saynètes comiques, des reconstitutions de faux souvenirs d’enfance et des fragments de récits autobiographiques illustrés[39]. Ainsi, lorsque Barthes, Guibert et Calle à la fin des années soixante-dix intègrent des photographies dans leurs récits personnels, ils s’inscrivent en fait dans une tradition artistique déjà instituée dans les milieux de l’art. Les œuvres illustrées de photographies y sont donc clairement identifiées, alors que les études littéraires se trouvent toujours embarrassées à leur accorder une légitimité, comme si le texte ne pouvait connaître une profonde mutation sous l’effet d’une vulgaire machine à reproduire des images.
Conclusion : l’antichambre des mondes virtuels
Pour conclure, l’autobiographie illustrée de photographies se présente comme l’antichambre (noire) des pratiques contemporaines de la mythologie de soi. Désormais, ce n’est plus dans un livre et avec un appareil photo que se crée cet univers imaginaire du moi idéal, mais sur les écrans d’ordinateurs. En faisant l’archéologie de cette pratique, on constate clairement que la photographie, loin d’authentifier les propos de l’autobiographe, participe à la dispersion d’une identité en fragments, et par conséquent à sa déréalisation, comme si elle court-circuitait à la fois le travail d’illusion narrative et le pacte de vérité autobiographique. Les images entretiennent une relation de référence au réel qui donne une sensation de déjà-vu au spectateur : une photographie de famille ressemble à n’importe quelle photo de famille, un paysage d’enfance à un autre paysage, une maison familiale à une autre maison. Cette familiarité entre de plein pied dans le cadre de la mythologie barthésienne : la platitude des images que l’on reconnaît par exemple dans les clichés du Roland Barthes par Roland Barthes ou de Sophie Calle participent efficacement à l’élaboration d’un univers mythique moderne dans lequel tout le monde peut se reconnaître. L’identité de l’auteur devient à son tour une « œuvre à l’ère de la reproductibilité technique », soumise au même régime que l’œuvre d’art moderne. L’indistinction entre vérité et fiction reste, bien entendu, irrésolue, et seule l’aura mythologique parvient encore à singulariser cette identité.
La photographie, matrice originelle des nouveaux médias actuels, insère un élément de modernité technique dans le texte, rendant la représentation du réel par la narration encore plus problématique, en particulier dans la littérature de soi. La figure de la métalepse, développée par Gérard Genette, offre une intéressante clef d’analyse. On peut ainsi se demander in fine si, tour à tour personne réelle sur les photographies, puis sujet fictif dans la narration, l’auteur ne glisserait pas d’un univers à l’autre comme un personnage en effet mythique, dont nous seraient livrés quelques légendes et traits particuliers. Ce personnage aurait alors ce pouvoir enviable de muter et de passer au travers des formes – texte puis photo et vice versa – mais aussi à travers les murs du genre, pour fonder sa propre mythologie dans le monde virtuel moderne.
Bibliographie photonarrative indicative :
Bernard Comment et Jacques Belat (photographies), Entre-deux : une enfance en Ajoie (Originaires, Biro, 2007).
Anny Duperey, Le Voile noir, photographies de Lucien Legras (Paris : Le Grand livre du mois / Le Seuil, 1992).
Annie Ernaux et Marc Marie (photographies), L’Usage de la photo (Gallimard, 2005).
Colette Fellous, Plein été, (Gallimard, 2007).
Pierre Guyotat, Coma (Traits et portraits, Mercure de France, 2006).
Michel Houellebecq, Lanzarote (Paris, Flammarion, 1999).
Camille Laurens et Rémi Vinet (photographies), Cet absent-là (Léo Scheer, 2004).
Marie N’Diaye, Autoportrait en vert (Paris, Mercure de France, 2005).
Orhan Pamuk, Istanbul, souvenirs d’une ville, trad. du turc par Savas Demirel, Valérie Gay-Aksoy et Jean-François Pérouse (Du monde entier, Gallimard, 2007).
Olivier Rolin, Bakou, derniers jours (Fiction et Cie, Seuil, 2010).
Georg Winfried Sebald, Vertiges [1990], trad. de l’allemand par Patrick Charbonneau (Folio, Gallimard, 2001)
– Les Émigrants [1992], trad. de P. Charbonneau (Paris, Gallimard, 2003)
– Les Anneaux de Saturne [1995], trad. de l’allemand par Bernard Kreiss (Folio, Gallimard, 1999)
– Austerlitz, [2001], trad. de P. Charbonneau (Arles, Actes Sud, 2002)
[1] Voir en bibliographie pour une sélection d’ouvrages photonarratifs.
[2] Je renvoie, à titre d’exemple, à Michel Tournier et Edouard Boubat, Vues de dos (Paris, Gallimard, 1981) ou Robert Doisneau et François Cavanna, Les Doigts pleins d’encre (Paris, Hoëbeke, 2003) ou encore avec Robert Doisneau et Jacques Prévert, Rue Jacques Prévert (Paris, Hoëbeke, 1999). En 1980, les Cahiers du cinéma et les éditions de l’Etoile lancent toutefois une collection qui fera date dans le récit illustré de photographies, Ecrits sur l’image. Raymond Depardon, Denis Roche, Sophie Calle, Gilles Mora et Pierre Nori publieront dans cette collection leurs « récits » à la première personne illustrés de photographies.
[3] Gilles Mora, « Pour en finir avec la photobiographie », Traces photographiques, traces autobiographiques, Danièle Méaux et Jean-Bernard Vray dir. (Saint Etienne, Lire au présent, Publications de l’Université de Saint Etienne, 2004) 116.
[4] Elle considère ces « formes mixtes » au regard de la variété des genres impliqués dans le texte même, comme par exemple une insertion épistolaire dans un récit.
[5] Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, trad. de l’all. par Pierre Cadiot (1957, Paris, Poétique, Seuil, 1986) 189.
[6] Pour Käte Hamburger, la fiction s’incarne dans le mouvement, produisant l’illusion de la vie humaine, ce qu’Aristote appelait dans la Poétique les drôntas (actions) et qui, arrangés ensemble, formaient les dramata (drames).
[7] Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, éd. revue et augmentée (1975, Paris, Poétique, Seuil, 1996), 14.
[8] Serge Doubrovsky, Fils (Paris, Galilée, 1977) : « Autobiographie ? Non. Fiction, d’événements et de faits strictement réels. Si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un langage en liberté. », quatrième de couverture.
[9] Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone, L’Autobiographie (Paris, U – Lettres, Armand Colin, 1999) chapitre « Autobiographie et image », 253-261. Il faut toutefois mentionner deux ouvrages qui mentionnent ce type de textes, sans pour autant leur donner le statut de « genre » : Thomas Clerc, Les Écrits personnels (Paris, Ancrages Lettres, Hachette Supérieur, 2001) ; Sylvie Jopeck, Photographie et (auto)biographie (Paris, La Bibliothèque, Gallimard, 2004).
[10] Charles Baudelaire, « Le Public moderne et la photographie » [Salons de 1859], Critique d’art, suivi de Critique musicale, éd. établie par Claude Pichois [1976] et présentée par Claire Brunet (Paris, Folio Essais
[11] Pascal Bonafoux, Moi je, par soi-même : l’autoportrait au XXe siècle, catalogue de l’exposition Moi ! Autoportraits du 20e siècle, Musée du Luxembourg (Paris, Selliers, 2004).
[12] Gabriel Bauret, « Autobiographie littéraire et autobiographie photographique », Les Cahiers de la photographie, n°13, La Photobiographie, Jean-Claude Lemagny dir (Laplume, ACCP, 1984), 11-14. Autoportraits photographiques, 1898 – 1981, catalogue de l’exposition Autoportraits au MNAM, 8 juillet – 14 septembre 1981, commissariat d’Alain Sayag, avec une préface de Denis Roche (Paris, Centre Georges Pompidou/Herscher, 1981). Michel Beaujour, dans son livre de référence, Miroirs d’encre, rhétorique de l’autoportrait (Paris, Poétique, Seuil, 1980) étend l’autoportrait à sa forme textuelle. Toutefois, il ne considère pas l’ajout direct de photographies dans le texte.
[13] Sophie Calle n’a pas connu Roland Barthes ou Hervé Guibert à ses débuts. Toutefois, elle connaît Denis Roche, éditeur de Barthes, mais aussi poète et photographe, et le suit dans la rue en 1979. Voir Sophie Calle, À suivre (Arles, Actes Sud, 1997).
[14] Roland Barthes, « Fragments pour H. », Œuvres complètes. 1977 – 1980, t. 5, Eric Marty dir. , 2e éd, (Paris, Seuil, 2002) 1005-1006. « Et de lui à moi : il acceptera désormais, sans essayer de la critiquer, de s’en plaindre ou de la forcer, cette « politesse un peu lasse » qui est un deuil : le deuil, insistant, irréparable, du corps de l’autre. », 1006. La lettre fut publiée le 19 mars 1986 dans L’Autre journal.
[15] Sophie Calle, Suite Vénitienne, suivi de Jean Baudrillard, Please, follow me (Paris, Ecrits sur l’image, l’Etoile – Cahiers du cinéma, 1983) et Sophie Calle, L’Hôtel (Paris, Ecrits sur l’image, l’Etoile, 1984).
[16] Sophie Calle, Des Histoires vraies (Arles, Actes Sud, 1994).
[17] Sophie Calle, Douleur exquise (Arles, Actes Sud, 2003), « Mon amour, tu te souviens d’Hervé Guibert ? Je ne le connaissais pas. Il souhaitait faire mon portrait pour Le Monde. Il est venu chez moi. Il a d’abord demandé ma date de naissance. J’ai dit que j’étais née le 9 octobre 1953. « Eh bien, continuez ! » a-t-il ordonné. […] J’ai parlé cinq heures, sans interruption. Il prenait des notes. Il souriait. […] » 72. La lettre aurait pu être écrite après coup, pour les besoins de l’exposition en 2003.
[18] Hervé Guibert, La Pudeur ou l’impudeur, 58’, Paris, 1991, diffusé en janvier 1992 sur TF1.
[19] Sophie Calle, Disparitions (Arles, Actes sud, 2000), 9.
[20] Catherine Mavrikakis, « Quelques r-v avec Hervé », Filer (Sophie Calle), Intermédialités, Maïté Snauwaert et Bertrand Gervais dir. (Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2006) 127 – 138.
[21] Hervé Guibert, « Suite Vénitienne de Sophie Calle – Les chichis de Sophie », La Photo, inéluctablement (Paris, Gallimard, 1991 ; Minuit, 1999) 377 : la rencontre a lieu en 1984 pour la chronique sur Suite Vénitienne et L’Hôtel, publiés aux Editions de l’Etoile, collections Ecrits sur l’image, Paris. Parce que Sophie Calle avait une baignoire japonaise en bois, Guibert lui avait demandé de l’utiliser. Il s’était baigné dans l’eau du bain de Calle. Cette dernière lui aurait fait des avances insistantes qui auraient agacé Guibert au point qu’il se jette sur elle pour l’étrangler. Calle raconte l’anecdote dans Douleur exquise.
[22] Roland Barthes, L’Empire des signes [1970], Œuvres complètes, t. 3, Éric Marty dir. (Paris, Seuil, 2002), 420.
[23] C’est à la même période que Barthes entreprend un séminaire sur La Préparation du roman (1977-1979) un projet fictionnel mais aussi sur les photographies de Proust. La Chambre claire marque donc, pour reprendre les termes d’Eric Marty, son entrée en écriture. Voir Roland Barthes, La Préparation du roman, I et II, Cours et séminaires au Collège de France (1978 – 1979 et 1979 – 1980), sous la direction d’Eric Marty et présenté par Nathalie Léger (Paris, Seuil – IMEC, coll. Traces écrites, 2003).
[24] D’autres clichés étaient présentés sous le titre Les Coulisses du Musée Grévin.
[25] Voir Pierre Saint-Amand, « Mort à blanc : Guibert et la photographie », Au jour le siècle 2. Le Corps textuel d’Hervé Guibert, Ralph Sarkonak dir (Paris, Lettres Modernes, Minard, 1997) 81 – 112.
[26] Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie [1980], Œuvres Complètes. 1977 – 1980, t. 5, (Paris, Seuil, 2002) 849.
[27] Parallèlement à ses activités liées à la photographie,
Guibert développe un travail sur
son image que ce soit dans ses « romans faux » (ou d’autofiction), ses photos ou son journal intime filmé qui décrit à la fin de sa vie sa déchéance physique.
[28] Sophie Calle et Fabio Balducci, En Finir (adapté du film Unfinished) (Arles, Actes Sud, 2005) 55.
[29] Les œuvres de Guibert et Calle ont à cette époque une inspiration d’une similarité troublante : quand Guibert écrit son roman Des Aveugles, Paris, Gallimard, 1985, Calle intitule une série Les Aveugles (1986) où elle questionne des aveugles de naissance sur leur perception de la beauté puis un autre La Couleur aveugle (1991) où elle confronte des peintures monochromes au regard d’aveugles.
[30] Sophie Calle, L’Absence, coffret de trois ouvrages comprenant, Souvenirs de Berlin-Est, Fantômes et Disparitions, (Arles, Actes Sud, 2000).
[31] La critique québécoise, sous l’égide du C.R.I. « Centre de Recherche sur l’Intermédialité » de l’Université de Montréal, a développé ce concept calqué sur le modèle du terme « intertextualité » pour éclairer les usages de différents médias dans les textes. Cependant, la terminologie reste là encore limitée à un champ géographique et ne semble pas s’étendre à l’usage, pour l’heure, hors du Québec.
[32] Cet argument est le propos central de ma thèse de doctorat qui démontre comment le concept de « mythologie individuelle » permet l’intégration de différents médias dans le récit. Echappée du pur texte, la mythologie englobe des formes polymorphes de représentation de l’identité, tout au long au 20e siècle, voir Magali Nachtergael, Esthétique des mythologies individuelles : le dispositif photographique de Nadja à Sophie Calle, sous la dir. d’Eric Marty (Université Paris 7-Diderot, juin 2008).
[33] Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola [1971], Oeuvres Complètes, t. 3, (Paris, Seuil, 2002) 706.
[34] Roland Barthes, La Chambre claire, note sur la photographie, 811.
[35] Ces articles sont publiés dans Les Lettres nouvelles entre 1954 et 1956.
[36] Définition du Petit Robert de la langue française, Alain Rey et Josette Rey-Debove dir. (Paris, Le Robert, 2007).
[37] Roland Barthes, Mythologies [1957], Oeuvres Complètes, t. 1, (Paris, Seuil, 2002) 824. Les « petites mythologies du mois » paraissent régulièrement entre 1954 et 1956 dans la revue Les Lettres nouvelles.
[38] Harald Szeemann et Marlis Grüterich dir., Documenta 5. Befragung der Realität, Bildwelten heute, catalogue de l’exposition, 30 juin au 8 octobre 1972, (Kassel, Neue Galerie, Schöne Aussicht et Museum Fridericanum, Friedrichplatz, 1972). Voir aussi Harald Szeemann, Individuelle Mythologien (Berlin, Merve Verlag, 1985).
[39] Déjà en 1964, à l’ARC, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, une première exposition avait mis en scène les « mythologies quotidiennes », fortement marquées par l’esthétique du Pop’art. En 1977, une seconde édition sera présentée dans les mêmes lieux, avec une forte présence des peintres de la figuration narrative, à ne pas confondre avec le Narrative art mais aussi de la photographie et des films Mythologies quotidiennes 2, catalogue de l’exposition du 28 avril au 5 juin 1977, ARC 2, Musée d’art moderne de la ville de Paris, commissariat de Gérald Gassiot-Talabot, Jean Louis Pradel, Bernard Rancillac et Hervé Télémaque (Paris, MAMVP, 1977).
Shelley Jackson : femme-machine.
Shelley Jackson : femme-machine. L’imaginaire cyborg de Patchwork Girl (1995) et My Body & A Wunderkammer (1997).
Plan de l’article
1. « You will have to feel your way in ».
2. « Cannot a phantom limb also have also a phantom person?”
3. « What happens to the cells I don’t visit ? »
« A cyborg exists when two kinds of boundaries are simulaneously problematic : 1) that between animals (or other organisms) and humans, and 2) that between self-controlled, self-governing machines (automatons) and organisms, especially humans (models of autonomy). The cyborg is the figure born of the interface of automaton and autonomy »[1]
Donna Haraway
« Avec les télétechnologies, le présent vivant se divise entre sa vie et sa survie : il n’y a archive ou image que s’il se spectralise »[2]
Jacques Derrida
La figure de la machine ne cesse de renvoyer à la question de l’humain à laquelle elle s’oppose traditionnellement, et soulève plus particulièrement celle d’un avenir post-humain désincarné. Directement reliée au cerveau, la machine permet de transcender les limites du corps en l’effaçant et de décupler la force de l’esprit. Cependant, dans la lignée de Donna Haraway et de son célèbre essai « A Cyborg Manifesto », Shelley Jackson s’inscrit en faux contre une vision posthumaniste héritée de Descartes qui renforce le dualisme corps/esprit, prônant le triomphe d’un esprit désincarné — « a mind-in-a-vat »[3] selon l’expression de Bruno Latour. Elle revendique à l’inverse un cybermatérialisme qui replace le corps au centre de toute expérience cognitive, étendant le sensorium commune que La Mettrie situe dans le cerveau à l’ensemble de l’organisme. Shelley Jackson récuse l’unité du sujet[4], ensemble composite et mobile, traversé de liens qui se prolongent hors des frontières du corps propre. A la menace de déshumanisation traditionnellement associée à la machine, la théorie du cyborg oppose une resubjectivation par le machinique selon une esthétique « cyberterratologique » placé sous le signe de l’artifice et de l’hybridation. Par son excès radical, cette monstruosité revendiquée permet en effet de dépasser les binarismes sur lesquels se fonde la logique occidentale. A travers l’étude de deux cyberfictions, Patchwork Girl (1995) et My Body & A Wunderkammer (1997), le présent article se propose d’analyser la manière dont Shelley Jackson interroge la triple articulation du corps, du texte et de la machine. Or, le patchwork, objet composite s’il en est, renvoie, tout comme la chambre des curiosités, à l’hétéroclite et au joyeux désordre qui subvertissent les raisonnements taxonomiques et font voler en éclats l’unité du sujet. Shelley Jackson cherche en effet à déjouer tout binarisme, s’ingéniant plus particulièrement à déconstruire la dichotomie sujet/objet en multipliant les greffes textuelles.
Les corps-textes composites et mobiles de Shelley Jackson ne peuvent fonctionner sans recourir à diverses interfaces machiniques couplées à l’action du lecteur devenu cyborg : My Body nécessite un navigateur Web capable de décoder le script HTML sous-jacent qui régit le comportement des textes et des images de l’œuvre, tandis que le logiciel Storyspace Reader est indispensable pour faire tourner pour ainsi dire, et l’image de la boucle n’est pas fortuite, Patchwork Girl. Ces deux interfaces régissent et façonnent notre expérience du texte dans une relation récursive qui induit la coopération de l’homme et la machine selon une logique communicationnelle héritée de la cybernétique. Il s’agit en effet de réduire le bruit potentiellement croissant qui parasite le flux informationnel, selon la loi de l’entropie, par des ajustements d’ordre récursifs visant à maintenir la communication que ne cessent d’interrompre les sauts hypertextuels et autres mises en relation. Le dispositif machinique de contrôle qui préside à notre lecture témoigne d’une volonté de résistance à l’illisible généré par la dimension potentiellement aléatoire de notre navigation. En d’autres termes, l’action combinée de l’homme et de la machine doit permettre la production d’un sens, processus qui nécessite la prise en main de l’interface par le lecteur, selon un certain nombre de règles et de contraintes imposées par l’auteur, mais aussi, par les limites même de l’interface dont il lui faudra comprendre la logique tout en déjouant les pièges que n’aura pas manqué de semer Shelley Jackson pour enrayer la belle mécanique et échapper ainsi au systématisme.
Cependant, on s’intéressera moins au fonctionnement de la machine informatique proprement dite qu’à la manière dont le discours technique informe l’imaginaire de l’œuvre et façonne la représentation du corps-texte qui la compose. Pas plus que la métaphore horlogère dont se sert La Mettrie dans l’Homme-machine ne débouche sur une description technique détaillée, les femmes-machines cybertextuelles que Shelley Jackson livre à notre lecture ne donnent-elles lieu à une évocation précise de leurs rouages internes. L’auteur privilégie au contraire le mystère quant aux aspects techniques de l’assemblage. Les créatures cyborgs que l’on rencontre dans Patchwork Girl et My Body appartiennent plutôt à la catégorie des chimères biologiques qu’à celles des hybrides technologiques, mi-femmes, mi-machines, et si l’on trouve encore quelques références au medium électronique dans Patchwork Girl, My Body en est entièrement dépourvu et propose d’entrée de jeu au lecteur une interface anatomique. Or, comme l’analyse fort bien Donna Haraway, la biologie participe, comme tout autre discours scientifique, à l’élaboration de nos représentations du corps, elles-mêmes modelées par la machine, et c’est ce processus qu’il conviendra également d’interroger ici à l’aune du texte de Shelley Jackson :
Organisms emerge from a discursive process. Biology is a discourse, not the living world itself. But humans are not the only actors in the constructors of the entities of any scientific discourse; machines (delegates that can produce surprises) and other partners (not « pre- or extra-discursive objects”, but partners) are active constructors of natural scientific objects.[5]
« You will have to feel your way in ».
A l’instar de la première page de Patchwork Girl, My Body & A Wunderkammer nous invite à explorer la carte du corps prétendu de l’auteur comme s’il s’agissait d’une chambre des merveilles, ce lieu de l’intimité où s’expose une collection d’objets et d’êtres hétéroclites fortement teintés d’exotisme, fœtus monstrueux et autres queues de sirènes, lesquels nous font entrer de plain pied sur les territoires de l’imaginaire. Le dessin du corps fragmenté de l’auteur renvoie aux planches anatomiques de Patchwork Girl qui déclinent sous différentes formes les fragments épars ou recomposés du corps du monstre femelle inspiré du Frankenstein de Mary Shelley, lesquels constituent autant de points d’entrée dans le corps du texte qui se compose de cinq sections respectivement intitulées « body of text », « journal », « crazy quilt », « story » et « graveyard ». De même que chacune des lexies arborescentes qui constituent le corps de Patchwork Girl recèlent quelques bribes d’expériences passées, chaque espace de My Body & A Wunderkammer recèle un souvenir fragmentaire, inséparable d’un organe ou d’une zone corporelle illustrée par un dessin de l’auteur. Le corps du texte de My Body se présente dès l’abord comme un espace muséal interactif à explorer, chaque lexie fonctionnant comme une chambre autonome et pourtant reliée par des liens hypertextuels à d’autres parties du corps. Shelley Jackson propose en effet une réinterprétation du genre autobiographique sous forme hypertextuelle, et de fait parcellaire, où la mémoire serait non plus localisée dans une zone du cerveau, traditionnellement perçu comme le siège de la conscience et la subjectivité, mais redistribuée entre les différentes parties du corps.
Cependant, l’imaginaire qui préside à la représentation du corps comme un cabinet de curiosités évoque métaphoriquement une architecture hypertextuelle impossible, celle d’une œuvre rhizomatique, sans bords ni limites, où chaque point serait potentiellement lié à tous les autres[6], comme l’illustre le passage suivant tiré de la lexie intitulée « cabinet »[7] :
In the course of writing these reminiscences, I increasingly began to conceive of my body as a great cabinet of curiosities. (…) There are slips of paper referring you to other drawers, unlabelled keys (you may despair of finding the locks they fit), and there are drawers within the drawers, behind sliding panels or false bottoms. I have found every drawer to be both bottomless and intricately connected to every other drawer, such that there can be no final unpacking. But you don’t approach a cabinet of wonders with an inventory in hand. You open drawers at random. You smudge the glass jar in which the two-headed piglet sleeps. You filch one of Tom Thumb’s calling cards. You read page two of a letter; one and three are missing, and you leave off in the middle of a sentence.
Ce guide de lecture renforce une vision idéale de l’environnement hypertextuel envisagé comme un espace de liberté où le lecteur peut circuler à sa guise, sans tenir compte de la contrainte imposée par l’architecture sous-jacente. Si la notion de clôture diffère en effet de celle du récit classique car indépendante de la résolution d’une quelconque intrigue, le lecteur n’en est pas moins soumis aux contraintes du dispositif hypertextuel, comme l’illustrent plusieurs parcours qui finissent par tourner en boucle, la seule échappatoire possible passant par un recours aux fonctions du logiciel de navigation, et non plus de l’hypertexte lui-même. La frustration produite par ce type d’impasse démontre l’ineptie de toute tentative d’inventaire ou de hiérarchisation : la lecture hypertextuelle privilégie le parcours à l’exhaustivité, le cabinet de curiosités se présentant ici comme l’avatar d’une base de données dont il convient d’apprendre la logique. Une fois la structure spatiale de l’œuvre maîtrisée, on peut estimer, à l’instar de Janet Murray, le processus de lecture achevé[8].
La vision mécaniste, et non dénuée d’érotisme, de ce dispositif dotés de leviers et de verrous n’est pas sans évoquer une version plus complexe de la description que donne Vannevar Bush de son Memex[9], interface optique servant de support mnémonique et précurseur de l’hypertexte électronique, imaginée à l’époque même où Norman Wiener développait sa théorie cybernétique. Le cabinet de curiosités apparaît comme un impossible dispositif mécanique qu’il convient de mettre en branle, différant en cela d’une machine autonome (et menaçante) qui pourrait se défaire de tout agent humain. Le corps-texte se confond avec le médium qui le constitue, et fonctionne de fait comme un appareil technique d’enregistrement et de conservation de la mémoire, sur le plan métaphorique tout au moins. Or, brouillant les limites entre le corps, le texte et le monde, Shelley Jackson propose de transformer son œuvre en un étrange dispositif mécanique qui viendrait dédoubler son corps-texte dont les variations typographiques symbolisent ici la spatialité et rappellent la matérialité du médium.
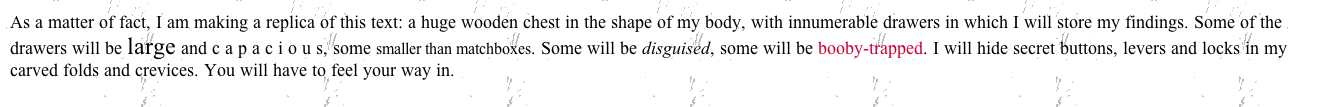
Shelley Jackson replace l’objet livre dans une perspective historique : il s’agit d’un dispositif technologique d’inscription et de visualisation au même titre que l’instrumentation, ou tout au moins la technique médicale et l’étayage discursif qui la sous-tend, associant de fait la main qui palpe à celle qui écrit, agissant l’une et l’autre selon une herméneutique qui façonne l’expérience de soi et du monde. L’auteur cherche à résister à la perte de la dimension tangible qui frappe son œuvre numérique en convoquant un imaginaire du toucher métaphorisé, entre autres, par le membre fantôme dont elle revendique l’existence à plusieurs reprises. En insistant sur la persistance en creux du tracé qui imprime sa marque sur la page de son carnet, elle tente d’inverser l’« effet fantomal » engendré par la nature même du trait du dessin évoqué dans son texte et reproduit sans épaisseur à l’écran : le trait atteste en effet d’une présence en bordure du texte qui me regarde et qui me touche, mais dont l’œil demeure invisible et dont le corps demeure intouchable, car toujours déjà en retrait[10] : « A blind person could trace my drawings with her fingertips three pages down in my notebook »[11]. Or, dans un environnement numérique, la chaîne des transformations se complique, et l’écran ne conserve de l’empreinte matérielle du style sur la fibre du papier qu’une image de synthèse dont l’artifice ainsi modélisé jette le doute sur l’existence incarnée du modèle.
« Cannot a phantom limb also have also a phantom person?”
La nature fantasmatique du membre fantôme interroge l’inscription (ou la production) d’une subjectivité dans (ou depuis) un corps autre dont les limites excèdent celles du corps biologique. L’évocation ludique du membre fantôme dans My Body esquisse un corps augmenté ambivalent, tantôt prothèse inanimée, tantôt lutin facétieux doué d’une volonté propre qui échapperait dès lors au contrôle conscient du sujet et à son emprise sur le monde.
My phantom limb tires fast, but is very strong. I can’t run on it, the choreography would be too confusing, but it is handy when I go rollerskating as a sort of sideboard motor or a brake. There are many other uses for it, in fact it has thousands, as lever, probe, and truncheon. But it is more ( or maybe less) than helpmeet. Though my native tendency is to avoid conflict, with my phantom limb I have kicked, tripped, goosed, tweaked, rabbit-punched, poked, pulled, pinched and pried. Once, bored at dinner, I came to attention to discover that my phantom limb had slid up under the skirts of the woman opposite, a writer of whom I was rather in awe, and was paddling with its phantom toes in her august parts. She seemed to approve, but I was mortified. My phantom limb has kicked people, then tucked itself up and left me to run away on my own; it is an irresponsible limb, a gadfly and a turncoat[12].
L’évocation du membre fantôme renvoie non seulement à la problématique post-cartésienne de la construction mentale d’un corps et d’un monde illusoires, mais soulève également le problème du caractère prosthétique de la machine dont nous nous servons pour lire et agir par procuration sur l’œuvre qui s’affiche à l’écran. Le membre fantôme suggère une continuité entre le corps propre et le monde, rendant manifeste un engagement physique avec les objets qui l’entourent. Cette situation n’est pas sans rappeler le rapport du lecteur/utilisateur à la machine qui lui permet d’explorer le monde virtuel de l’hypertexte électronique. En effet, à l’instar des jeux vidéos, le lecteur manipule le texte à travers la souris qui autorise et réduit tout à la fois son champ d’action : le corps augmenté est paradoxalement un corps amputé dès lors qu’il se trouve interfacé avec la machine. A l’inverse, le texte incorpore le geste qui l’anime et déclenche l’exécution des lignes de codes sous-jacentes : l’immersion du lecteur passe par sa capacité d’agir sur l’œuvre, ce qui induit une présence corporelle tout à la fois imaginaire et physiquement impliquée[13] dans l’espace du texte, même si le phénomène projectif se situe encore en deçà de la manipulation d’objets en trois dimensions telle qu’elle se pratique dans les jeux vidéos. S’il ne s’agit pas d’habiter le corps numérique de Shelley Jackson comme un joueur s’incarne dans son avatar virtuel, le lecteur se projette néanmoins dans un univers spatialisé dont la carte mobile se confond avec les membres de la figure auctoriale dans My Body, ou avec les disjecta membra du monstre femelle inspiré du Frankenstein de Mary Shelley dans Patchwork Girl. A travers l’exercice de la navigation conçue comme une exploration, le lecteur confère une certaine épaisseur sensorielle au pointeur de la souris : la visée noétique s’articule sur un rapport haptique[14] qui met effectivement en jeu le corps physique de l’utilisateur selon des règles prescrites en amont par l’auteur. En ce sens, les cybertextes de Shelley Jackson illustrent la définition que donne Espen J. Aarseth de la littérature ergodique, laquelle présuppose la perspective cyborg qui nous préoccupe ici : le texte est conçu comme une sorte de machine issue de l’alliance symbiotique du signe, de l’opérateur et du médium[15].
Afin d’être en mesure d’appréhender l’œuvre comme un quasi-objet, l’utilisateur se branche sur la machine pour constituer un circuit cybernétique avec elle : ni le corps, ni le sentiment proprioceptif n’apparaissent plus dès lors comme des entités prédéfinies et invariables, mais comme des processus dérivés d’interactions récursives complexes[16]. A ce titre, la question que soumet le monstre femelle de Patchwork Girl à une spiritiste dans la section intitulée « story » est éclairante en ce qu’elle met indirectement l’accent sur le brouillage des frontières de la subjectivité impliqué par ce rapport à la machine : « If a person can have a phantom limb, cannot a phantom limb also have also a phantom person?” (story/seance/lives and livers). Cette hypothèse paradoxale inverse la relation au corps propre dans un mouvement qui partirait de la périphérie vers le centre, déplaçant de fait le siège de la conscience traditionnellement associé au cerveau. La situation d’interface avec la machine transforme non seulement le corps de l’utilisateur, mais il modifie également le rapport qu’il établit avec lui. Le corps n’existe pas en chair et en os, mais demeure pourtant visible à travers ses actions sur le texte qui s’affiche à l’écran. Selon cette configuration paradoxale, le corps fantôme habite un sujet spectralisé[17], différant de lui-même en tant qu’il est hanté par la mémoire (ou la projection) d’un membre absent qui ne cesse de le transformer sur le mode de la boucle récursive comme l’indique l’adresse du monstre au lecteur dans la lexie intitulée « think me » :
I am predictable, but neither am I random. (…) so if you think you’re going to follow me, you’ll have to learn to move the way I do, think the way I think ; there’s just no way around it. And then, my pursuers, when you are thinking my thoughts, my battle is almost won, because you’ll begin to have trouble telling me apart from yourself, you too will start lifting the flyers to look for hidden mikes, and when you see me, you’ll wonder if I am chasing you » (body of text/think me).
Corps, texte et esprit se trouvent pris dans une boucle récursive qui les remodèle tour à tour au fil de la navigation. La reconstitution du corps-texte démembré s’apparente ici à un jeu de piste calqué sur le modèle du roman d’espionnage : la lecture consiste moins en la résolution d’une énigme ou d’une intrigue qu’en l’apprentissage des règles du jeu jusqu’à ce que l’espace du texte soit enfin maîtrisé. Selon un modèle cybernétique, l’utilisateur s’adapte à la logique du programme qui réagit à son tour les instructions transmises par l’intermédiaire de la souris ou du clavier à tel point que le lecteur/utilisateur incorpore le texte ainsi codé, exécute un programme[18] pour ainsi dire, ce qui soulève une fois encore la question du déterminisme. Quelle liberté reste-t-il en effet au lecteur/utilisateur ? Le clic est justement à la fois ce qui fait événement en interrompant la répétition machinique, entraînant une rencontre potentiellement « monstrueuse » entre deux lexies, et ce qui renforce ce même caractère machinique puisqu’il entraîne l’exécution d’une ligne de code programmée. Le clic ne revêt un caractère subversif que si l’on explore l’hypertexte spatial des cartes fournies par l’auteur dans Patchwork Girl, et, dans une moindre mesure, des planches anatomiques et autres croquis hyperliés dans My Body. Les interfaces graphiques autorisent la circulation du lecteur hors des séquences prédéfinies par les hyperliens qui doublent le texte des lexies puisque l’on peut choisir n’importe quel point d’entrée dans le corps du texte. Les lexies de la section intitulée « Crazy Quilt » ne comportent aucun lien sortant : la seule navigation possible passe par l’interface graphique et autorise toutes les combinaisons. Comme par un effet de miroir, le lecteur spectralisé se projette dans un texte aux frontières mobiles façonné à l’image d’un corps dont les limites sont sans cesse renégociées selon une logique récursive dont la programmation comporte une part aléatoire.
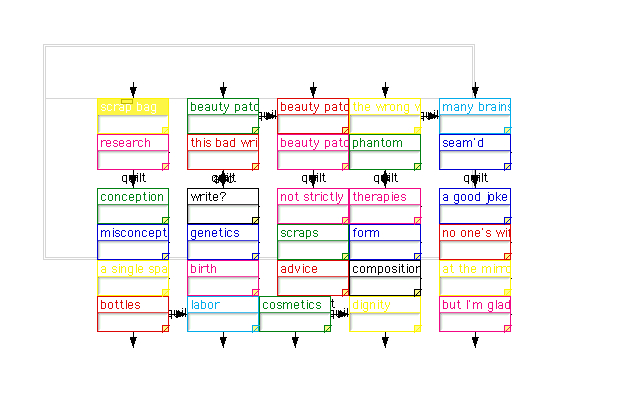
« What happens to the cells I don’t visit ? »
Si l’influence de la cybernétique informe manifestement l’imaginaire de Patchwork Girl et My Body, en ce que le corps humain est envisagé sous l’angle de processus informationnels, la textualisation du corps ne débouche pas pour autant sur un modèle désincarné, mais reflète une vision propre aux théories biotechnologiques. Comme le montre Eugene Thacker, contrairement à la cybernétique, la biotechnologie s’intéresse moins à l’interface de l’homme avec la machine qu’à la reconfiguration des processus biologiques selon un modèle informatique[19]. Le corps matériel peut être compris comme et régulé par l’information : il devient potentiellement programmable et reprogrammable à l’infini. L’idéologie matérialiste sous-jacente soulève une fois encore la question du déterminisme, et rappelle le déni du libre-arbitre[20] propre à La Mettrie, lequel dépeint un être humain assujetti à son corps, et de fait, à ses passions, entendues comme le fonctionnement matériel de son propre organisme[21]. Selon cette même logique (qui n’est pas sans poser de nombreux problèmes théoriques), le code génétique devient traduisible en code informatique, le génome humain fonctionnant comme une vaste base de données peuplée de fantômes qui diffractent l’unité du sujet et ouvre l’identité sur le multiple et le mouvant :
Our bodies are haunted as well as our minds. We are haunted by our uncle’s nose, our grandfather’s cleft palate, our grandmother’s poor vision, our father’s baldness. There are ghosts in the form of recessive genes, that never show themselves to us, but might appear to our children, to the seventh son of the seventh son. Red hair, suddenly, out of a clear blond lineage (story/seance/body ghosts)
Shelley Jackson complique l’analogie qu’elle établit entre corps et corpus en y greffant la métaphore du cabinet de curiosités dans My Body, et celle de la mosaïque ou du patchwork dans Patchwork Girl. Le corps est dépositaire de la mémoire d’un sujet pluriel, hanté par les spectres d’un patrimoine génétique en sommeil. Cependant, les différentes parties du corps et de l’œuvre ne se résument à la somme de leurs parties : il s’agit d’un corp(u)s en devenir, pris dans une dynamique de flux, et de fait soumis à un processus de recomposition permanente. L’œuvre telle que nous la lisons résulte de la résurrection (interrogation centrale dans Patchwork Girl) de textes hétéroclites qui composent une partie de l’ensemble du corpus sous-jacent. Shelley Jackson n’hésite pas à recourir à une double métaphore qui inscrit son œuvre dans une problématique chrétienne (le terme « visitation » comporte une connotation marquée) qui semble entrer en contradiction avec la notion d’un pur fonctionnement machinique en ce qu’elle réintroduit l’idée d’une âme, souffle de vie :
I align myself as I read with the flow of blood that as it cycles, keeping moist and living what without it stiffens into a fibrous cell. What happens to the cells I don’t visit ? I think maybe they harden over time without the blood visitation, enclosures of wrought letters fused together with rust, iron cages like ancient elevators with no functioning parts » (body of text/blood)
Loin de s’inscrire dans un cadre théorique prédéfini, Shelley Jackson interroge à partir d’un imaginaire de la technique, plus que de la machine proprement dite, le rapport entre le corps, le texte et l’esprit, en revenant sans cesse à la question de l’incarnation[22]. Le corps chez Shelley Jackson est toujours déjà pris dans un processus d’écriture qui signe à la fois sa disparition et son inscription dans le monde sous la forme de récits ou de discours scientifiques : « You could say that all bodies are written bodies, all lives pieces of writing” (body of text/all written). Cependant, l’écriture est prise dans un double régime, à la fois machinique et mécanique. Les processus combinatoires qui gouvernent la lecture du corps-texte de l’œuvre relèvent d’un imaginaire plus mécanique que machinique en ce qu’une telle métaphore induit un fonctionnement aléatoire dépendant néanmoins de l’action d’un agent humain, fonctionnement qui échappe à la régularité maîtrisée de la machine[23]. Le machinique proprement dit appartient aux dispositifs de contrôle sous-jacents, à savoir les différents codes informatiques qui régissent les programmes, rendant possible la lecture/performance de l’œuvre. L’hypertexte électronique se situerait de fait à l’interface entre l’homme et la machine, dès lors que le corps propre de l’utilisateur se double d’un corps spectral qui n’a pas (de) lieu et se confond avec l’hypertexte duquel émerge une pensée sans penseur, d’après la définition qu’en donne Shelley Jackson dans « Stitch Bitch » :
Hypertext blurs the distinction between subject and object, matter and the absence of matter. We no longer know whether it does its thinking, or what it is driving at. (It’s no one and no-place, but it’s not nothing.) Instead, there is a communicating fabric spread out over a space without absolute extent, a place without placement.[24]
L’inscription de la subjectivité excède non seulement les frontières du corps pour générer des chimères, mais la pensée elle-même implique des actants non humains. Or, c’est cette part de monstruosité en puissance qui garantit l’irréductibilité d’un corp(u)s en excès, ouvert sur une infinité de branchements et d’hybridations possibles, garants d’une subjectivation redistribuée, à l’inverse de la perte d’identité et à la déshumanisation d’ordinaire associée au corps-machine de l’automate ou du robot. Telle une machine vouée à la transformation des éléments qu’on lui soumet, Patchwork Girl recycle et recompose d’autres textes à l’instar de ces citations empruntées en différents endroits de l’essai de Donna Haraway, A Cyborg Manifesto, dont les mots rassemblés dans la lexie intitutilée « identities » (body of text/mixed up/identities) se disséminent tout au long de l’œuvre, engendrant à leur tour d’autres greffes monstrueuses :
« Identities seem contradictory, partial and strategic. »
« There is not even such as state as ‘being’ female », or « being » monster, or « being » angel.
« We find ourselves to be cyborgs, hybrids, mosaics, chimeras. »
Aarseth, Espen J. Cybertext. Perspectives on Egodic Literature. Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1997.
Bush, Vannevar. « As We May Think”, The Atlantic Monthly Magazine, juillet 1945. URL: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-may-think/3881/, Consulté le 4 juillet 2010.
Deleuze, Gilles et Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris : Les Editions de Minuit, 1980.
Derrida, Jacques et Bernard Stiegler, Echographies de la télévision, Paris : Galilée-INA, 1966.
Haraway, Donna. Primate visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science. New York and London: Routledge, 1989.
—. « The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others”, Cultural Studies. Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paul A. Treichler eds., New York : Routledge, 1992, 295-337.
Hayles, N. Katherine. « Flesh and Metal: Reconfiguring the Mindbody in Virtual Environments”, Configurations 10. 2002, 297–320.
Jackson, Shelley. My Body & A Wunderkammer. URL: http://www.altx.com/thebody/ (Consulté le 1er mai 2010).
—. Patchwork Girl. Watertown, MA: Eastgate Systems, 1995.
—. « Stitch Bitch: The Patchwork Girl”. URL: http://web.mit.edu/comm-forum/papers/jackson.html (Consulté le 1er mai 2010).
Krzywkowski, Isabelle. Machines à écrire. Littérature et technologies du XIXe au XXIe siècles. Grenoble : Ellug, 2010.
Latour, Bruno. Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, MA : Harvard UP, 1999.
Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard, 1945.
Murray, Janet. Hamlet on the Holodeck. New York : The Free Press, 1997.
Regnauld, Arnaud. « Interrupting D: Patchwork Girl’s Syncopated Body”, RFEA 121, Paris : Belin, 2010, 72-83.
Thomson, Ann. « La Mettrie, Machines, and the Denial of Liberty”, Graduate Faculty Philosophy Journal, Vol. 22, Number 1, 2000, 71-86.
—. « Déterminisme et passions”, Matérialisme et passions. Pierre-François Moreau et Ann Thomson dir., Paris : ENS Editions, 2004, 79-95.
Thacker, Eugene « Data Made Flesh: Biotechnology and the Discourse of the Posthuman”, Cultural Critique 53. Winter 2003, 72-97.
Weissberg, Jean-Louis. Présences à distance. L’Harmattan Communication, Paris : 1999.
[1] Donna Haraway, Primate visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science, New York and London, Routledge, 1989, p.139.
[2] Jacques Derrida, et Bernard Stiegler, Echographies de la télévision, Paris, Galilée-INA,1966, p.61.
[3] Bruno Latour, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge, MA, Harvard UP, 1999, p.130.
[4] N. Katherine Hayles, « Flesh and Metal: Reconfiguring the Mindbody in Virtual Environments”, Configurations 10, 2002, pp.297–320.
[5] Haraway, « The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others”, Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paul A. Treichler éds., Cultural Studies, New York, Routledge, 1992, p.298.
[6] Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille Plateaux, Pairs, Les Editions de Minuit, 1980, pp.32-33.
[7] URL : http://www.eliterature.org/collection/1/works/jackson__my_body_a_wunderkammer/cabinet.html
[8] Janet Murray, Hamlet on the Holodeck, New York, The Free Press, 1997, p.174.
« (…) electronic closure occurs when a work’s structure, though not its plot, is understood. This closure involves a cognitive activity at one remove from the usual pleasures of hearing a story. The story itself has not resolved. It is not judged as consistent or satisfying. Instead, the map of the story inside the head of the reader has become clear. Such a map does not necessarily feel inevitable or appropriate, the way the solution to a puzzle does.”
[9] Vannevar Bush, « As We May Think”, URL: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1969/12/as-we-may-think/3881/. Consulté le 4 juillet 2010.
[10] Derrida et Stiegler, op.cit., p.171
[11] URL : http://www.eliterature.org/collection/1/works/jackson__my_body_a_wunderkammer/eyelid.html
[12] URL : http://www.eliterature.org/collection/1/works/jackson__my_body_a_wunderkammer/phantom_limb.html
[13] Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p.97.
« Avoir un bras fantôme, c’est reste ouvert à toutes les actions dont le bras seul est capable, c’est garder le champ pratique que l’on avait avant la mutilation. Le corps est le véhicule de l’être au monde, et avoir un corps c’et pour un vivant se joindre à un milieu défini, se confondre avec certains projets et s’y engager continuellement ».
[14] Jean-Louis Weissberg, Présences à distance, Paris, L’Harmattan Communication, 1999, p.222.
[15] Espen J. Aarseth, Cybertext. Perspectives on Egodic Literature, Baltimore and London,The Johns Hopkins University Press, 1997, p.55.
[16] Hayles, op.cit, p.304.
[17] Derrida et Stiegler, op.cit., pp.129-130
[18] Murray, op.cit., p.174.
Dans son analyse du fonctionnement du jeu d’aventure textuel Zork, Janet Murray met en évidence la nécessité de prévoir les actions du joueur, et de fait de programmer un ensemble de requêtes possibles, qui revient à intégrer le joueur dans le programme : « The lesson of Zork is that the first step in making an enticing narrative world is to script the interactor ».
[19] Eugene Thacker, « Data Made Flesh: Biotechnology and the Discourse of the Posthuman”, Cultural Critique 53, « Posthumanism », Winter 2003, p.94.
[20] Ann Thomson, « La Mettrie, Machines, and the Denial of Liberty”, Graduate Faculty Philosophy Journal, Vol. 22, Number 1, 2000, pp.71-86.
[21] Thomson, “Déterminisme et passions”, Matérialisme et passions, Pierre-François Moreau et Ann Thomson dir., Paris, ENS Editions, 2004, pp.79-95.
[22] Arnaud Regnauld, “Interrupting D: Patchwork Girl’s Syncopated Body”, RFEA 121, Paris, Belin, 2010, pp.72-83.
[23] Isabelle Krzywkowski, Machines à écrire. Littérature et technologies du XIX e au XXI e siècles, Grenoble, ELLUG, 2010, p.174.
« Il y a (…) une «’écriture mécanique’ avant que n’émergent les possibilités d’une ‘écriture machinique’, écriture dont les ‘constituants hors langue’ paraissent être ceux que Tibor Papp réserve à la littérature électronique, «’le temps, la topographie et le mouvement’ ; et les procédés ‘en langue’, ceux que l’on associe au mécanique : la concision, la combinatoire et l’objectivité ».
[24] Shelley Jackson, “Stitch Bitch: The Patchwork Girl”. URL: http://web.mit.edu/comm-forum/papers/jackson.html. Consulté le 14 juillet 2010.